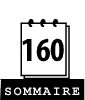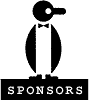|







|
|
MICHEL DE GHELDERODE ET LE RÊVE RÉVOLUTIONNAIRE
«Ma mère me donna le jour en un siècle qui n'est pas le mien, ce dont j'ai moult enragé[1]», écrit Michel de Ghelderode à une époque où, depuis longtemps déjà, il s'est tourné vers le passé, situant toutes ses œuvres dramatiques dans une Flandre du temps jadis, plus imaginaire que réelle. Il oublie alors, et le public d'aujourd'hui, qui le connaît surtout à travers ses chefs d'œuvre «flamands», tels Magie rouge ou Hop Signor!, tend à oublier aussi que dans une période antérieure, plus précisément tout au long des années vingt, Ghelderode a bien été un homme de son temps, dont il a partagé les préoccupations, dans sa vie comme dans son œuvre. On venait de traverser la première guerre mondiale et d'assister, fût-ce de loin, à la révolution d'octobre et à l'instauration d'un régime communiste en Russie; on assistait de plus près à la naissance de partis révolutionnaires dans la plupart des pays d'Europe. De tels bouleversements et les mouvements de pensée qu'ils révélaient et qu'ils engendraient, ne pouvaient laisser personne indifférent, notamment dans les milieux littéraires fréquentés par Ghelderode. Indignation devant l'injustice sociale, velléités de révolte, projets plus ou moins désavoués d'un changement radical, tout cela hante son œuvre narrative et dramatique au cours de cette décennie.
LES RÉVOLTES INUTILES

Dans sa jeunesse, l'écrivain a fréquenté des milieux anarchistes, sans pour autant s'inféoder à leur mouvement. En juillet 1921, il donne un conte au Bulletin Libertaire, mais n'assiste guère aux réunions du groupe qui imprime cette feuille. N'a-t-il eu comme but que de publier l'une de ses œuvres? Plus tard, pourtant, vers la fin de 1927, il se rapproche suffisamment des partis révolutionnaires pour signer l'Appel des intellectuels de Belgique lancé par le «comité belge du 10e anniversaire de la révolution soviétique», et pour donner à la revue anarchiste Haro!, sous le pseudonyme de Babylas, trois articles où il vitupère «contre tout et tout le monde», comme dit Roland Beyen qui a consacré un chapitre de son livre Michel de Ghelderode ou la hantise du masque à l'attitude sociale de Ghelderode[2]. Mais dès 1928, à la grande indignation de ses amis anarchistes ou communistes, on voit l'écrivain pactiser avec cette société honnie : il accepte une décoration officielle, «l'Ordre de la Couronne»; il ne refuse pas non plus, au cours de la même année, les deux prix littéraires qui lui ont été attribués. Ses velléités de révolte semblent avoir fait long feu. On l'a accusé de n'avoir affiché des «idées d'avant-garde» que pour paraître à la page.
Il est sincère pourtant, les accents de son œuvre en témoignent durant toute cette période, dans son émotion devant le malheur des pauvres, ses protestations contre l'injustice sociale, ses attaques contre l'égoïsme des nantis, contre l'hypocrisie des bourgeois ou des «calotins»; mais, comme l'observe encore Roland Beyen, sa révolte n'est qu'un «mouvement d'indignation résignée», «une révolte "tombante" : à peine est-elle exprimée qu'elle s'avoue vaincue et inutile». Au cours du conte Au Pays de Laermans, publié dans Le Bulletin Libertaire, on peut lire : «Rue des Potences…potences pour ceux qui crient leur faim et leur colère, potences pour ceux qui brisent leurs chaînes…»; ce texte reparaîtra l'année suivante dans le recueil La Halte catholique, avec notamment Paysage attristé, évocation d'un monde de miséreux, où revient par trois fois l'allusion au «cœur du pauvre», comme un refrain douloureux : «Des lanternes palpitent – comme l'amour au cœur du pauvre (…) Le vent a des rugissements soudains – comme la révolte au cœur du pauvre (…) La lampe s'éteint – comme l'espoir au cœur du pauvre[3]…»; de ce conte, il tirera en 1928
la pièce Un
soir de pitié : elle se déroule dans un cabaret, d'où l'on entend les rumeurs d'une fête organisée par des ouvriers - «Entends-tu ça? Ils crèvent de faim et ils dansent!»- mais voilà que de ce côté on aperçoit des flammes, un incendie, on entend des cris : «Ce sont les joyeux ouvriers», dit l'un. «Non, répond l'autre, ils crient, menacent. Le ciel est en feu» . Le patron du cabaret avait prévu cela : «Braves gens! Pas si sûr! Si encore, ils buvaient!» Car ce patron, nommé Bacchus, ne connaît aux souffrances des pauvres, et aux violences qu'elles peuvent engendrer, d'autre remède que l'alcool. Le cabaret fermé, il n'y aura plus de remède[4].
L'inutilité de toute forme de révolte est soulignée par l'écrivain à maintes reprises, dans des contes publiés isolément, tels Le Seul Amour — «…j'étais pauvre, et ma raison me disait obscurément l'inutilité de la révolte des pauvres»[5] —, ou L'Idole pourrie — «rien ne sera fait jamais pour que cela change.(…) ce sont les faibles et les pauvres qui écopent (…) je sens se réveiller de vieilles et inutiles colères»[6]. On retrouve un écho affaibli de ce pessimisme dans le long conte philosophique intitulé Kwiebe-Kwiebus, à propos du massacre des innocents : «il songea que toujours les innocents seraient massacrés par les puissances inquiètes»[7]. Innocents, les hommes le sont-ils? Voilà qui est mis en doute dans les contes du recueil L'Homme sous l'uniforme, où il s'agit surtout des guerres : «J'ai peut-être autant d'anarchie que vous dans l'âme!», dit le narrateur du premier récit, Les Hommes de la classe, «J'ai horreur du meurtre, je ne crois ni aux patries, ni à l'honneur, ni à l'intelligence, ni à la civilisation (…) Nous ne serons jamais libres!… Les peuples marcheront toujours au pas… Et quand ils se croiront délivrés, il se trouvera encore quelqu'un pour les remettre au pas!… Et puis quand même la liberté serait possible, l'homme ne la mériterait pas… Il est trop mauvais!…» Un autre conte du même recueil, Petit-Cœur, le confirme : «L'homme est mauvais : mauvais nous l'étions tous, ou nous le devenions si vite»[8].
C'est à partir de 1926 que Ghelderode collabore avec la troupe flamande et catholique du Vlaamsche Volkstooneel, pour laquelle il écrit sur commande des drames sur des sujets religieux, notamment Images de la vie de saint François d'Assise, et deux ans plus tard Barabbas. C'est l'occasion pour lui d'exprimer encore une révolte contre le mal présent en ce monde, et de lui trouver une issue : ses héros se tournent vers le Christ. Pour François, qui a vécu l'horreur de la guerre et qui est apporté en scène sur une civière, en proie à la fièvre et en plein délire, la rencontre avec «l'idée du Christ» survient très tôt, et d'emblée change sa vie. Il abandonne sa carrière militaire et son milieu bourgeois pour s'en aller prêcher par les chemins, vêtu en vagabond; bientôt accusé d' «indiscipline, révolte, anarchie», il est mis en jugement comme «ennemi de l'ordre» : «Vous dites que faire la guerre, c'est faire œuvre d'assassinat», lui crie le juge, « vous dites que la fortune, le capital sont méprisables (…) que la société sent mauvais (…) et vous prêchez l'égalité…la fraternité…l'abolition des castes…la suppression de la propriété…Tout comme si ces utopies allaient se réaliser demain! (…) Quel est le mystificateur qui a fait de vous un communiste?…» «Christ!», répond François. Et «tous bondissent» (selon une didascalie), sur quoi, assurément, le public applaudit[9]. Mais ce prétendu «communisme» du saint ne saurait se réaliser sur terre, si ce n'est au sein d'une communauté monastique. Il ressemble à l'anarchisme de Ghelderode en ce qu'il n'aspire pas réellement à changer le monde; le saint s'en détourne pour se vouer à la contemplation et connaître l'extase mystique.
Barabbas, lui, ne découvrira le Christ que progressivement, et n'accueillera son message qu'à la fin de la pièce; jusque-là, il est un véritable anarchiste, qui se proclame «ennemi de la société»; c'est l'injustice sociale, dont il est une victime parmi tant d'autres, qui a fait de lui un criminel : «Nous sommes criminels parce que l'injustice gouverne la troupe immense des hommes. Et je ne sais, en vérité, si les plus monstrueux des crimes sont bien les nôtres!». Lui aussi, comme les malheureux évoqués dans Un soir de pitié, cherche un soulagement dans l'alcool, en attendant de changer le monde, ou de le tenter. Il voit en Jésus une sorte de rival, puis un «camarade», auquel il attribue le désespoir qui est le sien devant le monde tel qu'il est : «Comme moi, ce Jésus fut un chef de bande, un insurgé…Il n'eut que le tort de vouloir s'y prendre par la douceur quand il fallait la violence». Que n'auraient-ils réalisé à eux deux, si Jésus s'était allié à lui! Sa libération, aux dépens de Jésus qui est condamné à sa place, est loin de le satisfaire; au contraire, elle lui inspire comme un remords, et accroît en lui le sentiment de révolte contre l'injustice. Il voudrait venger Jésus, qui, dit-il, «aimait le peuple dont il incarnait
la révolte. Il
est mort pour les idées qui sont les nôtres. Il est mort pour le peuple et pour tous les peuples. (…) Camarades; en avant! (…) Vive l'anarchie!» C'est au dénouement, quand il vient de recevoir un coup de couteau, que Barabbas agonisant comprend enfin le message chrétien : «Hé! Jésus? Je saigne aussi. Immolé le même jour… (…) Mais toi, tu es mort pour quelque chose. Moi, je meurs pour rien. C'est quand même à cause de toi…pour toi…Jésus. Si tu veux… Et si je pouvais… te donner la main… et te voir sourire… Jésus… Mon frère…» Et il meurt «en regardant vers le Calvaire[10]». Dans la première version de la pièce, Marie, de retour sur la scène, le regardait et disait à l'apôtre Jean : «Ferme-lui les yeux, Jean!… C'est peut-être un chrétien[11]…»; l'auteur a renoncé à cette fin trop explicite, mais la pièce n'en a pas moins montré une lente conversion de son héros anarchiste à la non-violence et aux valeurs chrétiennes. Aux yeux de Ghelderode, c'est en vain qu'un simple humain se sacrifie pour changer quelque chose au mal qui régit le monde terrestre; Barabbas «meurt pour rien».
Parallèlement à toutes ces inutiles révoltes, qui ne trouvent d'issue que hors de ce monde, Ghelderode a imaginé à la même époque des tentatives révolutionnaires, aussitôt avortées, qui éveillent en lui quelque sympathie, et que pourtant il désavoue et tourne volontiers en ridicule.
LES RÉVOLUTIONS AVORTÉES

L'écrivain a daté de 1923 son petit «sketch pour clowns» intitulé La Transfiguration dans le cirque; sans doute en a-t-il eu l'idée à cette date, bien qu'il n'ait réalisé ce projet que quatre ans plus tard, comme en témoignent ses agendas. Le cirque est à la mode au cours des années vingt : les peintres, tels Rouault ou Picasso, s'en inspirent, comme d'ailleurs le cinéma, avec notamment Chaplin, ainsi que le théâtre, avec Salacrou, Cocteau ou Marcel Achard : ce dernier, dans Voulez-vous jouer avec moâ?, a déjà montré des clowns qui ne voulaient pas travailler, parce qu'ils étaient tous amoureux de la même jeune artiste du cirque, laquelle leur préférait un «monsieur Loyal» d'autant plus impassible qu'il était en bois. Si Ghelderode n'a pu voir ni lire dans l'immédiat cette pièce créée à Paris le 18 décembre 1923, il est vraisemblable qu'il en a connu le sujet par la presse, ce qui a pu lui inspirer la première idée de son sketch clownesque. Mais il lui donne une tout autre dimension, en attribuant à ses clowns des visées révolutionnaires; quant à «la blanche écuyère» dont ils sont tous amoureux, elle personnifie la révolution; elle s'appelle Luna : autant dire qu'ils cherchent la lune, à savoir l'inaccessible.
«Monsieur Clown» est le meneur. On peut reconnaître en lui le traditionnel clown blanc, vêtu et maquillé comme un Pierrot, qui a pour fonction de mystifier et de tourmenter son partenaire; celui-ci, auquel le fard dessine un nez rouge et un grand rire, et qui est grotesquement vêtu – veste trop large et pantalon trop court, lavallière voyante et chapeau écrasé – se nomme, non moins traditionnellement, Auguste. Ici, il y a en quelque sorte cinq «Auguste», l'un d'eux seulement portant ce nom, les autres nommés Babylas, Picolo, Dudule et Casimir, et dominés aussi par Monsieur Clown. Tout se passe avec force plaisanteries énormes, gesticulations exagérées, recours à divers ustensiles bizarres, mais ce spectacle de cirque n'en développe pas moins les différentes phases d'une révolution. Monsieur Clown a commencé par «tuer» le directeur du cirque, sur quoi l'on fait une sorte de grève — «notre travail est de ne rien faire» —, le chef fait un discours — «on ne fait pas la révolution sans discours» —, on s'empare de la caisse, on se partage d'avance le pouvoir : «je vous nomme tous ministres». Chacun sera utilisé selon ses compétences, le «clown musical» étant ministre des beaux-arts, l'acrobate sur fil de fer ministre des affaires internationales, l'avaleur de sabres ministre de la guerre, et celui qui gesticule inutilement pendant que les autres travaillent, sera ministre du travail. Le chef sait faire briller l'espoir : «Camarades clowns, la Révolution est déclarée. Prolétaires du cirque, esclaves du plaisir public, c'est l'aurore qui se lève», et il sait agiter des menaces : «Celui qui n'est pas d'accord, je lui concasse le zitrouillard! En conséquence, criez : Vive la liberté et les clowns en liberté!» Ayant ainsi obtenu la fidélité de ses troupes, il fait une proclamation radiodiffusée : «Les clowns sont maîtres de
la situation. Clowns
de toutes les nations, unissez-vous. Assassinez les directeurs. L'univers est aux clowns. Être clown ou la mort!» Quant aux «imbéciles», à savoir la population du globe, exception faite des clowns, on les enfermera dans les cirques, et l'on se propose de les «trucider» presque tous, après leur avoir ôté leur portefeuille. Mais ce projet recouvre des ambitions personnelles : les clowns n'obéissent au chef que sous la menace de sa matraque, et comme lui chacun d'eux essaie de s'entendre avec Luna, qui est la Révolution, pour devenir empereur et faire d'elle son impératrice.
Or, cette révolution sera manquée, Luna n'ayant guère hésité à tomber dans les bras du directeur du cirque, qui n'était pas mort, et à prendre le parti de la réaction. «Massacrez les clowns!… C'est la fin des gugusses!», s'écrie le directeur; Luna fait chorus : «Vive le sang! À bas les clowns sentimentaux!», et c'est après une fusillade qu' «aux barres et aux trapèzes, les six clowns, ailés, aériens, voltigent comme des esprits, des anges en larmes dans une clarté bleuâtre», justifiant enfin le titre du sketch : il s'agit bien d'une «transfiguration». Le mot de la fin sera dit par Luna : «Les clowns jolis dans les nuages! Mais je préfère les pistes terrestres, et ta moustache cirée, ô mon beau directeur[12]!» Cette apothéose des clowns peut surprendre, car ils ont accompli des actes, et surtout montré des motivations qui n'avaient rien d'angélique; mais en suggérant qu'ils sont massacrés, Ghelderode est allé au bout de son propos, et la «transfiguration» est substituée à un dénouement trop attristant pour un spectacle de cirque. Et peut-être aussi que l'auteur exprime par là un reste de nostalgie pour le rêve révolutionnaire, même s'il est voué à l'échec du fait que «l'homme est mauvais»; il reste que Luna était belle, à demi irréelle avec ses «immenses prunelles d'azur[13]», et que ceux qui l'ont aimée et perdue participent, à la fin, de cette grâce et de cette irréalité.
*
Ghelderode a traité de tout autre façon le thème de la révolution avec le personnage de Pantagleize, qui figure dans un conte de 1925, Pantagleize qui trouvait la vie belle[14]. Ce Pantagleize, autrement complexe et ambigu que «Monsieur Clown», est un philosophe sceptique, adonné à la méditation; comme on lui a prédit qu'à l'âge de quarante ans — son âge — il «entrerait sur la scène sociale pour y jouer un rôle prépondérant», il se met en tête d'annoncer «une vérité» aux hommes, et, persuadé que «tout est vrai, rien n'est vrai», il choisit parmi d'autres cette révélation : «La vie est belle!». Il ne savait pas que cette phrase était le signal attendu par des conspirateurs, et c'est donc par hasard qu'il déclenche
la révolution. Dès
lors, on le voit déambuler dans un monde devenu chaotique, où ce ne sont pas seulement les hommes qui entrent en transes, mais les choses : «Tout chancela — la ville — la foule — le ciel. Le réverbère tanguait. Le sol se fendait. Les autobus explosaient—». Ghelderode donne une étonnante description, d'inspiration surréaliste[15], de ce monde pris de folie. Pantagleize semble porté par les événements, se trouvant dans tel ou tel lieu comme dans un rêve, sans savoir comment il y est venu. Une femme l'entraîne, une juive qui attend de cette révolution la justice et le bonheur. Il ne sait pas le nom de cette femme, il ignore même quelle révolution il est en train de vivre : «Quelle révolution? Nul n'en savait rien : ni ceux qui fuyaient, ni ceux qui tuaient, ni ceux qui tombaient.»
C'est par hasard encore que, réfugié dans une banque, il y trouve des valises pleines d'or, qu'il emporte; et par hasard, qu'il échoue à l'Objektif Bar, où se tient le gouvernement provisoire. Acclamé par les «ministres» et nommé ministre lui-même, parmi d'autres, apparemment des médiocres et des ratés «que les événements avaient distingués», Pantagleize devient lui aussi révolutionnaire. «Submergé de champagne» et pris «d'un amour immense», il débite des propos cyniques et nihilistes qui «lui venaient il ne savait d'où». «Buvez, mangez, forniquez, pillez, il y a des dieux muets qui vous approuvent (…) Parce que nous sommes mauvais et couards et menteurs de toute éternité, vivons selon nous-mêmes (…). Abolissez ce qui ne fut jamais : la justice, la beauté, la bonté, l'intelligence. Rendez la terre aux bêtes!»
Survient alors «une phase nouvelle» des événements, qui n'est autre que l'entrée en jeu de la contre-révolution : irruption de soldats, fusillade de toutes parts, suicide de la femme qui l'avait aimé, nouveau chaos sanglant. «Le monde allait finir.» Paradoxalement, Pantagleize, «qui avait découvert la beauté de la vie», «dansait sur des décombres et hurlait de bonheur. Il allait rebâtir le monde à sa fantaisie (…) lui, Pantagleize, ministre des événements …». Il est encore «infiniment heureux» devant les juges, et ne semble rien entendre de la sentence, non plus qu'il ne comprend pourquoi on le pousse vers un mur, pourquoi les autres tombent. Au moment de mourir, il revoit comme en rêve son amie pendue, et «c'était l'Humanité»; de sa bouche sort une banderole, qui porte des «paroles d'or, merveilleuses et intraduisibles»[16].
Que comprendre en effet, sinon que le rêve révolutionnaire repose sur un espoir, immense autant que vain, de changer la vie, et ne conduit qu'à créer le chaos, les hommes, animés ou non d'un tel espoir, étant irrémédiablement mauvais; il reste que le rêve était merveilleux, qu'il les a soulevés d'un bonheur éphémère, avant de les faire sombrer dans le néant.
*
Ce conte comportait assez d'événements pour fournir à Ghelderode le canevas du «vaudeville attristant» qu'il compose en 1929, pour la troupe du Vlaamsche Volkstooneel. Mais ce n'est plus seulement à travers le regard embrumé du héros que nous voyons les événements : l'aventure n'a plus rien d'onirique, tout est clair, le personnage est devant nous, et la révolution aussi. L'intérêt de l'auteur se porte moins désormais sur des considérations philosophiques, et bien davantage sur ce qui passionne ses contemporains, donc le public du théâtre : il précise que l'action se déroule «dans une ville d'Europe, au lendemain d'une guerre et à la veille d'une autre[17]». Le héros ne cherche plus à annoncer une vérité aux hommes, mais il émet seulement une banale constatation, inspirée par le temps qu'il fait : «Quelle belle journée!» Sur quoi, tout – ou presque tout – sera comique, jusqu'au sinistre dénouement. Ghelderode a multiplié les coïncidences : l'anniversaire de Pantagleize, la fête du Premier Mai avec ses cortèges, ses chants et ses drapeaux, enfin une éclipse solaire qui oblige tout le monde à porter des lunettes noires; tout cela va se muer en une agitation révolutionnaire qui n'est que brièvement visible en scène, mais demeure présente à l'arrière-plan, tandis que les personnages principaux s'adonnent à leurs comiques gesticulations.
Pantagleize, ici, est plus ambigu encore que dans le conte : il se présente toujours comme un philosophe sceptique, mais l'aventure montrera qu'il est loin d'être détaché des biens de ce monde. Et pourtant c'est un naïf, une sorte de Candide, et la pièce a été créée dans une traduction néerlandaise de Jan Boon, sous le titre de Een onnoozel hart in de Wereld, «Un cœur innocent dans le monde». De plus, Ghelderode qui vient d'écrire sa Transfiguration dans un cirque a voulu que son héros soit habillé comme un clown, d'un pantalon trop court et d'une veste à carreaux : il en a fait une sorte d'Auguste destiné à être pris pour dupe, et s'est réclamé explicitement de l'exemple de Charlie Chaplin; Pantagleize passera aux yeux des autres pour «un imbécile», et son entrée devant le Conseil de Guerre étonne le Généralissime qui le préside : «Vous devez vous tromper? C'est un clown[18]!» Un tel personnage, qui à la scène se prête à des interprétations opposées, comiques ou pathétiques, a été très diversement défini par les critiques et par l'auteur lui-même dont l'opinion sur sa créature a curieusement évolué, comme l'a montré Roland Beyen; Ghelderode a pu voir en lui une «incarnation du Poète» inadapté à la réalité, et admettait qu'il avait avec lui-même «des affinités singulières[19]»…
Au groupe indistinct des révolutionnaires que l'on voyait dans le conte, Ghelderode a substitué dans la pièce quelques figures dessinées, ou plutôt caricaturées d'après des modèles vivants, ses propres amis anarchistes, qui avaient fondé Le Bulletin Libertaire et plus tard Haro! , et s'étaient amusés avec lui en 1927 à créer l'Ordre de la «Gidouille» (terme emprunté à l'anarchiste Alfred Jarry). Le barman Innocenti, qui est le seul à échapper au ridicule, était le journaliste Gabriel Figeys; le poète dada Lekidam, (d'abord nommé Luisekam, peigne à poux) était René Baert[20]; quant au barbu Bergol, nommé d'abord Cent-et-un par allusion à sa boiterie, c'était le portrait de Daenens, l'éditeur de Haro!, qui avait un pied bot, et n'a jamais pardonné à Ghelderode de s'être moqué de lui et de son infirmité[21]. À ces trois personnages empruntés à la réalité, l'auteur en a joint deux autres, imaginaires : Bam-Boulah, le cireur de bottes noir qui est au service de Pantagleize et qui parle un «petit-nègre» mêlé d'anglais, et la femme juive dont s'éprend le héros, déjà présente, quoique anonyme, dans le conte où elle est «petite, rousse et laide»; elle est devenue belle dans la pièce, et désormais elle porte un nom : Rachel Silberchatz.
Nous avons accès aux motivations respectives de ces révolutionnaires, tant par leurs échanges au cours de l'action que par leurs réponses à l'interrogatoire, lors du procès final : ceux qui sont en butte au racisme attendaient de cette révolution une revanche; Bam-Boulah, qui au début rêve d'égalité et espère qu'«on blanchira les nègres», va jusqu'à réclamer d'être président «parce que moi bon nègre», et se révélera au tribunal d'une insigne lâcheté; quant à Rachel, absente du procès puisqu'elle a été assassinée un peu plus tôt, elle espérait venger son peuple d'une manière qui ne laissait pas d'être inquiétante : «Ah, race d'Israël, ton jour est venu! Peuple persécuté, tu commanderas aux peuples et tu persécuteras à ton tour!» Les autres sont-ils des idéalistes? Ce n'est pas si certain : le poète Lekidam, le plus inoffensif, espère surtout, semble-t-il, assister à des événements prodigieux, et finira par avouer piteusement : «je voulais m'amuser», mais on a pu voir qu'il n'était pas dénué d'ambition, se voyant ministre des arts et lettres; quant à Bergol, aussi grossier que violent, on ne sait ce qui l'attire, sinon l'argent; il veut être ministre des finances. Il sera aussi l'un des plus courageux au tribunal, puisqu'en guise de défense, il n'a d'autre réponse que le cri «merde!» maintes fois répété[22].
Le cas d'Innocenti est plus complexe : on peut voir en lui, au début, un prolétaire parmi d'autres, qui déteste son travail d' «esclave en habit noir. L'esclave des imbéciles qui ont soif»; mais la suite donne une autre dimension au personnage, qui devient une sorte de porte-parole de l'auteur. Il est le seul lucide, au moment où les autres se partagent d'avance le pouvoir, il sait que la partie n'est pas gagnée, que la foule est encore en ébullition; mieux, il sait même que «la révolution ne devait pas éclater ce matin», et que tout est venu d'un «tragique malentendu.» «Ce n'était pas cette révolution-là qu'il fallait faire (…) Vous être des amateurs (…) Des illusionnaires, des pochards, des irresponsables, des lecteurs de brochures. Votre révolution? C'est du music-hall.» On apprendra au cours du procès que, sous la fausse identité de ce barman se cache un intellectuel, ancien professeur d'université; bien que n'ayant aucune illusion sur cette révolution-là, qu'il trouvait «odieuse et bouffonne», et d'ailleurs vouée à l'échec, il y a participé «par principe», parce que la révolution est son «unique idéal». Il demande lui-même à partager le sort de ses «camarades», qu'il «méprise un peu tout en les aimant beaucoup», et le plus surprenant est son autocritique finale : «Empli de haine, je suis indigne de travailler à la révolution idéale. Il vaut mieux que je disparaisse avec ma haine, car de cette haine sortira l'œuvre haineuse, la révolution destructrice et inhumaine. Le règne des esprits ne viendra jamais[23].» N'est-ce pas l'auteur encore qui parle par sa bouche? Il semble bien qu'aux yeux de Ghelderode, la révolution doive demeurer un idéal, qu'il est bien vain de chercher à réaliser.
Armés de ces motivations, désir de revanche ou envie de vivre des événements extraordinaires, ambition ou cupidité, ou encore haine de tous et de tout, les révolutionnaires de Pantagleize se saoulent de discours, se traitent de «camarades», évoquent «le grand soir», les «prolétaires», «la lutte finale[24]». Certains d'entre eux, Rachel et peut-être Innocenti, ont dû contribuer à préparer cette révolution qu'ils attendent. Le peuple, rassemblé tant à cause de la fête du travail que pour assister à l'éclipse du soleil, gronde et agite des drapeaux noirs, mais on guette un signal, qui apparemment doit venir d'ailleurs et de plus haut. Rachel semble mieux renseignée que les autres, elle possède des plans de la révolution : «La révolution était mûre, travaillée dans le détail. Quelle nuit! C'était pour ce matin, à la faveur des rassemblements»; elle avoue pourtant : «ce qu'on savait, c'est que nous étions flambés, les plans révélés. Les mouchards. À preuve ces patrouilles, la mobilisation de l'armée. Mauvais, mauvais.» On s'apercevra plus tard qu'Innocenti, le plus intelligent du groupe, en savait assez, lui aussi, pour comprendre vite l'échec et pour critiquer la logorrhée de ses camarades : «Alors, quoi? On fait des discours pour faire la révolution, et on fait la révolution pour faire des discours[25]?» (On a entendu de même les clowns de la Transfiguration déclarer : «On ne fait pas la révolution sans discours.»)
Mais comme on croit aisément à ce que l'on souhaite, Rachel et Innocenti, les plus avertis, se sont laissés entraîner dans l'hallucination générale lorsque le signal attendu a été involontairement lancé par Pantagleize. Mieux, ce dernier lui-même, obéissant à Rachel dont il est tombé amoureux, accomplit le seul exploit notable de ce soulèvement révolutionnaire, en allant s'emparer du trésor de la Banque grâce au mot de passe, qu'il a encore trouvé par hasard (de même, les clowns de la Transfiguration volaient la caisse du cirque). On entendra ensuite le héros tenir des discours incendiaires, grisé qu'il est par les applaudissements et le champagne, et préconiser l'usage de la guillotine, puis montrer ce qu'il faut attendre de cette révolution, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'apportera pas le bonheur. «Faudrait une guillotine, c'est si décoratif. (…) Et guillotinons les critiques d'art, les propriétaires et les pédicures. Les autres, nous les mettrons à poil, puis nous leur distribuerons à tous un même costume. Ensuite, pour les régénérer, ils feront de la gymnastique, des mouvements collectifs.» Un peu plus tard, il s'occupe de la religion : «Nous détruirons le seul vrai Dieu et créerons des idoles en caoutchouc et en triplex. Je suis pour les faux dieux.» Et, après avoir annoncé : «nous ordonnerons des actes si saugrenus qu'ils seront irréparables de toute éternité», il revient au peuple, qu'il faudra «inventer» : «Quand il aura été inventé et que nous aurons expérimenté sa résistance à la dynamite et à nos discours, nous lui donnerons des pyjamas, des motocyclettes et trois livres de saucisson international par tête. (…) Nous stockerons des béquilles et des œillères, des civières et des cercueils; nous stockerons l'intelligence et toute la prose des sociologues. Puis fabriquerons cœurs pneumatiques, cerveaux à répétition et culs à ressorts pour recevoir la botte des maîtres nouveaux[26].»
De tels aperçus de l'avenir ne sauraient être attribués à quelque enthousiasme révolutionnaire, même si l'on songe que Pantagleize est ivre; ils ne peuvent être qu'ironiques, dans la bouche de ce philosophe sceptique. Et ils sont de la part de Ghelderode un franc désaveu de la révolution prolétarienne, un rejet violent de ce qu'elle peut entraîner, une méfiance extrême à l'égard de tout collectivisme, de toute pensée unique. On ne saurait dire pourtant que Ghelderode a pris le parti des puissants; les forces gouvernementales sont, elles aussi, et plus encore que les comploteurs, tournées en ridicule. Le policier Posaune, toujours attaché aux pas de Pantagleize, comme Javert aux pas de Jean Valjean, est comique sous ses déguisements variés, et dans ses gesticulations; le général Mac-Boum est un imbécile, de la lignée des matamores poltrons, et la scène qu'il domine est très drôle; le Généralissime qui préside le Conseil de Guerre surgit du sol comme une marionnette, avec son casque «follement emplumé»; à sa vue, les «six conseillers», qui rappellent les personnages d'un jeu de massacre et portent tous le même masque, «s'effondrent en arrière et l'avocat se couche à plat ventre. Le généralissime lève le bras. Tous se redressent. Roulement de tambour[27].» Bref, si les révolutionnaires se conduisent souvent comme des pitres, les représentants de la loi sont des pantins. À n'en pas douter, «l'homme est mauvais», quelque cause qu'il défende.
La seule issue évoquée par le héros est la fuite, loin de
la civilisation. Il
veut garder pour lui le trésor dont il s'est emparé, et s'en aller vivre dans une île déserte ou peuplée de sauvages, pour y mener une existence proche de la nature, avec Rachel, ou, puisqu'elle est morte, avec les rares survivants du désastre. «Je dépenserai mes trésors à élever la pensée de ces misérables, et ma récompense sera de revoir, luisant dans mon sommeil, les yeux de cette femme qui rêvait d'un amour universel, (…) le mien ne lui suffisant pas, sans doute». Ce projet de Pantagleize, utopique autant que la révolution qui vient d'échouer, n'en est pas moins significatif : tout ce qui demeure de son aventure, c'est le souvenir de son amour pour Rachel, et d'un grand espoir, celui d'un «amour universel» et d'une «révolution idéale» qui aurait apporté le bonheur; mais l'un et l'autre n'auront duré qu'un jour. Il peut soupirer en mourant : «Quelle belle journée[28]!»
*
Toutes les révoltes ou révolutions imaginées par Ghelderode n'aboutissent qu'à l'échec et illustrent la même conviction : si l'injustice et l'oppression règnent dans le monde où nous vivons, c'est parce que «l'homme est mauvais», et nous ne pouvons pas espérer changer ce monde, pour la même raison. La révolte de Barabbas a fait de lui un criminel, la révolution que Pantagleize a déclenchée est à l'origine d'un chaos sanglant, et si elle avait réussi, elle n'aurait engendré que le malheur. Face au mal qui règne ici-bas sans recours possible, la seule issue ne peut être qu'individuelle : on songe à se retirer de ce monde, les chrétiens se tournant vers Dieu et l'au-delà, d'autres choisissant la mort, Pantagleize voulant s'en aller loin de
la civilisation. Et
pourtant, la plupart de ces histoires de tentatives révolutionnaires s'achèvent sur des notes de regret nostalgique; le rêve, certes, a pris fin, il n'était pas viable et n'a que peu duré, mais il était merveilleux : «quelle belle journée!»
Ghelderode n'est guère différent de ses héros, lui qui préfère désormais se détourner du monde où il lui faut vivre, et se plonger en imagination dans un «jadis, en Flandre» historique ou légendaire, un temps qui n'était pas meilleur, sans doute, mais qui n'était plus, pour lui, porteur de menaces : «le passé qui me consolait, dira-t-il, qui me donnait tant de certitudes alors que l'avenir ne m'apportait que des inquiétudes et des incertitudes[29]». C'est peu après la création de Pantagleize qu'il «se retire du théâtre actif[30]»; déçu par le déclin et la scission du Vlaamsche Volkstooneel, très frappé aussi par le décès prématuré de l'acteur qui vient d'incarner son héros, il n'écrira bientôt plus sur commande, ni pour un public déterminé. Il cultivera ses propres goûts et ses fantasmes; avec Magie rouge commence, dès 1931, la série des chefs-d'œuvre situés presque toujours dans une Flandre des temps médiévaux ou renaissants, et bien rarement dans le présent, troublé et générateur d'angoisses, ce vingtième siècle dont Ghelderode a dit un jour qu'il n'était pas le sien.
RÉFÉRENCES

[1] «Paraphrase» de Mes Statues (1943), Cf. rééd. Le Cri, Bruxelles, 2001, p. 9-10.
[2] R. Beyen, Michel de Ghelderode ou la hantise du masque, Bruxelles, Palais des Académies, 1980, p. 403-408.
[3] La Halte catholique (1922) a reparu avec. L'Homme sous l'uniforme en 1999 (Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises). Citations, p. 70 et 51.
[4] Un soir de pitié figure dans Théâtre IV, Paris, Gallimard, 1955. Citations, p. 16 et 19.
[5] Homo, 15/01/1923, p. 56.
[6]
La Flandre Littéraire
, mai 1924, p. 422.
[7] Kwiebe-Kwiebus, Bruxelles, La Renaissance d'Occident, 1928, p. 71. Dans l'édition définitive de ce conte, intitulé désormais Voyage autour de ma Flandre (Bruges, Stainforth, 1947), l'auteur écrira «les puissants inquiets», p. 127. ( cf. réédition Bruxelles, Les Éperonniers, 1988. Citation, p. 69.)
[8] L'Homme sous l'uniforme, op. cit., p.169 et 271.
[9] Images de la vie de saint François d'Assise, pièce créée puis éditée dans une traduction néerlandaise, n'a été publiée dans la version française originale qu'en 1995. (Lansman, Carnières-Morlanwelz, Wallonie-Belgique) Citations, p. 58-59.
[10] Barabbas/Escurial, rééd. Bruxelles, Labor, 1984. Citations, p. 47, 55, 57, 126-128.
[11] Barabbas, Louvain, Opbouwen – Bruxelles, La Source, 1949, p.135.
[12] Transfiguration dans un cirque, in Théâtre oublié, Paris, Honoré Champion, 2004. Citations, p. 122, 124, 132-135, 145-146.
[13] Op. cit., p. 126.
[14] Ce conte a été publié partiellement, sous le titre Pantagleize, dans
La Flandre Littéraire
, le 15/06/1925. Il n' a été édité dans sa version intégrale et sous son titre original, qu'en 1992, Bruxelles, La Pierre d'Alun.
[15] On retrouve la même inspiration dans La Corne d'Abondance et L'Homme à la moustache d'or.
[16] Pantagleize qui trouvait la vie belle, op. cit. Citations, p. 16, 18, 37-38, 48-53, 55-62, 69-72.
[17] La pièce date d'ailleurs de 1929, à mi-parcours entre les deux guerres, comme si l'auteur avait prévu la seconde! Elle a été composée du 8 juin au 5 août 1929, donc antérieurement à la crise financière qui a surpris tout le monde en octobre de la même année.
[18] Pantagleize, Bruxelles, Labor, 1998, p. 121.
[19] Roland Beyen, «Ghelderode et Pantagleize», in Études de Littérature française de Belgique, offertes à Joseph Hanse, Éditions Jacques Antoine, Bruxelles, 1978, p. 287-301.
[20] C'est ce que dit Gabriel Figeys (voir note suivante), mais Marc Quaghebeur a rapproché Lekidam de Paul Nougé, dans sa «Lecture» de Fragments, Bruxelles, Labor, Espace-Nord, n° 7, p. 254, note 66.
[21] Cf. Gabriel Figeys, «Michel de Ghelderode de ma jeunesse», in Espaces, documents XXe siècle, 1975, n° 1, Bruxelles, Henry Fagne., p 20-27. Figeys ne doute guère que Pantagleize lui-même ne soit un autoportrait de son ami Michel. Voir les notices que Roland Beyen a consacrées à Baert, Daenens et Figeys, dans Correspondance de Michel de Ghelderode, tome 1, Bruxelles, Labor, 1991, p. 362, 387, 405.
[22] Op. cit. Citations, p. 15, 78 (Bam-Boulah), 62 (Rachel), 114 (Lekidam), 117-118 (Bergol.)
[23] Op. cit. Citations, p. 23, 81, 119-120.
[24] Op. cit., p. 27,39, etc. (camarades), p. 13, 108 (grand soir), 51, 53, etc. (prolétaires), 43, 54, etc. (lutte finale).
[25] Op. cit., p. 63 (Rachel), 79 (Innocenti).
[26] Op. cit., p. 86, 89, 90.
[27] Op. cit., p. 110.
[28] Op. cit., p. 101, 132.
[29] Jean Stevo «Entretiens avec Michel de Ghelderode», diffusés par l'INR (nov.-déc. 1953) et publiés dans Synthèses, n° 95, avril 1954.
[30] Éphémérides publiées avec les Entretiens d'Ostende, Paris, L'Arche, 1956.
Copyright © Jacqueline Blancart-Cassou, 2009
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|