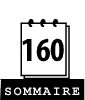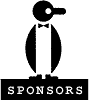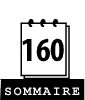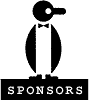|







|
|
GLORIA
MADAGASCAR, VENDREDI 3 MARS 2000

Gloria est sur nous, une tempête qui suit le cyclone Éline de deux semaines, et qui déverse des trombes d'eau toute la nuit. Le matin, nous nous retrouvons dans une embarcation immobile. Autour de la maison, une trentaine de centimètres d'eau recouvrent la cour et j'y barbote jusqu'en haut des mollets pour gagner les WC. J'en ressors trempé – le toit fuit de partout et, même si ce n'est plus l'averse furieuse de la nuit, il pleut encore. Il est temps d'improviser, autour d'un café, un numéro de capitaine responsable et capable de naviguer au coeur des intempéries. Nous partons à Toamasina cet après-midi pour rentrer lundi.
Il me reste à envoyer quelques messages aux personnes qui ont besoin de connaître à peu près mon emploi du temps, à boucler un sac léger, c'est parti!
Comme prévu, la circulation dans le centre est presque à l'arrêt. Le taxi pointe le capot dans une rue, renonce, essaie une autre plus loin, une autre encore… pour revenir dans la masse des véhicules frileusement serrés les uns contre les autres. À force de klaxon, de percées audacieuses dans d'étroits interstices, on avance quand même pour tomber, près d'Andravoahangy, sur un spectacle étonnant : la rue est devenue rivière, et le gué n'est pas en vue. Le flot est franchi laborieusement mais avec succès. Et nous sommes à la gare une heure avant le départ. Pour apprendre que le minibus où nos places étaient réservées ne partira pas : il est en panne. C'est un car, un Boeing comme on dit, qui nous transportera. L'histoire de la panne est vraisemblable mais très probablement fausse. Sans doute restait-il des sièges libres dans le car et le transporteur n'aura-t-il pas vu la nécessité d'affréter un véhicule supplémentaire quand tous les passagers peuvent entrer dans un seul. En échange, il nous remboursera dix mille francs, le billet de car ne coûtant que vingt-cinq mille contre trente pour le minibus. De notre côté, nous voyagerons plus lentement mais c'est sans importance puisque nous ne sommes pas attendus. En fait, il vaut même mieux arriver au petit matin qu'au milieu de la nuit, sans compter le fait que le car est plus confortable.
C'est donc sur la perspective d'un voyage sans autres histoires que nous avalons une soupe chinoise et une bière dans un hotely de la gare. Le patron y est plutôt de bonne humeur : la pluie de cette nuit a épargné son restaurant, tandis qu'Eline avait noyé jusqu'au moteur de son congélateur.
À six heures et demie, le soir est tombé, le car se met en route. Il reste encore quelques rares sièges vides, nous sommes une bonne quarantaine de passagers. Le chauffeur louvoie avec prudence dans une circulation devenue fluide. Les embouteillages de la journée auront poussé de nombreux conducteurs à rentrer chez eux plus tôt que d'habitude, aggravant du même coup les encombrements jusqu'au moment où ils ont fini par se dissiper – maintenant. Mais, à peine sortis de Tana, la RN2 devient plus statique que l'était le centre-ville tout à l'heure. Il est sept heures et demie, huit heures, huit heures et demie, rien ne bouge. Le convoyeur, qu'on appelle aide-chauffeur, est parti aux nouvelles et revient avec une information qui ne nous dit rien du temps que cela va durer : un pont s'est écroulé, ou presque, et on est en train de le réparer. Nous apprendrons, mardi matin, que le président en personne s'est déplacé pour suivre les travaux — magie d'un pays où la présence du premier personnage de l'État, qui n'a bien sûr aucune vocation à transporter des planches ou à boulonner des éléments métalliques, semble requise pour que quelque chose arrive; magie d'un pays où, contre toute attente, quelque chose arrive en effet dans ce cas de figure. En attendant, le chauffeur grogne et propose de rebrousser chemin, sous prétexte que la route est dangereuse plus loin. La patience est une des grandes vertus du peuple malgache et il ne sera pas dit qu'on la prendra en défaut ce soir. Donc, on attend que quelque chose arrive, dans l'ignorance à ce moment de la proximité où nous sommes du grand homme qui presse lentement le mouvement. On attend ainsi jusqu'à minuit, moment auquel le convoi s'ébranle avec nonchalance. Nous avons pris, le temps de franchir l'insignifiante rivière Ampasimbe, au PK13, quatre heures et demie de retard sur l'horaire. Quel horaire?
Je somnole jusqu'à Moramanga, traditionnelle première étape sur la route de l'est, environ au tiers de la distance totale jusqu'à Toamasina, où nous aurions pu (dû?) être déjà : il est trois heures du matin. Arrêt sakafo dans une gargote où on sert, d'autorité, une assiette de riz et du poulet mal cuit. La comparaison avec le repas de midi est douloureuse. Mais il est loin, déjà, le repas de midi. Christine se bat un quart d'heure pour commander un café, finit par l'obtenir, le boit du bout des lèvres. Il n'est pas bon. J'ai réussi, de haute lutte, à acheter une bière, je ne suis pas peu fier de mon exploit. Tout le monde termine, on se réinstalle dans le car. En route…
Pour quelques centaines de mètres. Le chauffeur se gare. Il a décidé de dormir. Il semble bien peu décidé à rouler vers Toamasina et doit garder à l'esprit son envie de faire demi-tour. La digestion et la fatigue font le reste, jusqu'au lever du jour où nous émergeons, pour découvrir que nous étions arrêtés devant une boîte de nuit, déjà fermée sans doute quand nous sommes arrivés.
SAMEDI 4 MARS

C'est l'heure du premier café, après lequel il me semble revivre. Pas tout à fait cependant puisque je dois être encore dans les brumes du sommeil : croyant reconnaître un vazaha qui se dirige vers un téléphone, espérant qu'il pourrait être véhiculé par un 4x4 qui nous rendrait la suite plus facile s'il nous prenait comme passagers, confiant donc pour une fois dans les vertus du progrès… je dois constater en arrivant près de lui qu'il ressemble bien peu à la personne que je m'attendais à voir. D'ailleurs, le téléphone qu'il voulait utiliser ne fonctionne pas. Pas d'autres commentaires, un deuxième café suffit pour l'instant puisqu'on ne semble pas pressés de repartir. Ça parlemente entre le chauffeur et quelques passagers. Le sujet de la conversation n'est pas difficile à imaginer.
Les passagers l'ont emporté : à sept heures et demie, le Boeing reprend son élan, vite interrompu deux kilomètres après la sortie de Moramanga quand quelques personnes, mieux éveillées que les autres, se rendent compte qu'il manque un couple dans le car. Demi-tour dans un endroit impossible, où la route est manifestement trop étroite pour la manoeuvre… qui réussit cependant. Et, avant de rentrer à Moramanga, voici, marchant plein d'énergie sur le chemin, les deux passagers manquants. On s'arrête, ils montent, tout le monde rigole. Jusqu'où auraient-ils marché? La question ne se pose pas. Ils se sont contentés de faire confiance, sachant qu'on viendrait les rechercher en constatant leur absence, quel que soit le temps nécessaire à cela. Et ils avaient raison de faire confiance. Bref, nouveau demi-tour pour se replacer dans la bonne direction, cette fois c'est reparti. Qu'on croit.
Il ne faut pas une heure avant l'arrêt suivant. À 212 kilomètres de Toamasina, tout est stoppé. Nous comme les autres. Nous moins bien que les autres : au-dessus de l'endroit où nous nous sommes garés dans la queue, quelqu'un découvre en levant les yeux un arbre à demi déraciné qui menace de s'écraser sur le car pour peu que la terre gorgée d'eau coule encore un peu vers le bas. On se replace à un endroit moins menacé, cent mètres plus loin, entre deux autres véhicules. Et on attend, en émettant des suppositions sur la raison de cet arrêt. Avant d'en arriver là, nous avons déjà contourné des amas de terre, de rochers et d'arbres qui ne fermaient pas tout à fait la route au trafic. Il faut bien imaginer que c'est pire cette fois-ci. Et, à force de n'avoir rien à faire, nous nous décidons à aller de l'avant, à pied, voir ce qui se passe.
Une petite colline barre la chaussée et, si elle n'a rien à faire là, elle s'y trouve bien malgré les pelles étroites maniées à bout de bras qui tentent de lui faire un sort. Mais déplacer une colline, même la foi n'y suffira pas, aidée de pelles et de bras. La situation est bloquée, l'heure est grave, la caravane s'organise à défaut de passer. Le pain se vend à 1.500 francs malgaches, plus de deux fois son prix à Tana, mais on trouve aussi des mangues à 250 Fmg. Renseignements pris, le point de ravitaillement le plus proche, vers l'avant, se trouve à Beforono, sur l'éloignement duquel les avis divergent, de treize à dix-sept kilomètres. Aurons-nous davantage de chance vers l'arrière? Un petit village, Soarano, s'offre à moins d'un kilomètre. Sauvés! Sauvés? Que nenni! Il n'y a pas la moindre épicerie sur place, il faut marcher deux kilomètres de plus pour en trouver une. Sur le trajet, un bulldozer est arrêté, en panne de carburant. Et voici l'épicerie, d'où nous ressortons avec quelques produits de première nécessité : eau, pain, cigarettes. Le moral remonte, il ne pleut pas et une voiture bâchée nous épargne de refaire le chemin à pied pour revenir au car. Plus tard, dans un indescriptible bruit de ferraille, le bulldozer aperçu à l'arrêt remonte la longue colonne immobile, en route pour déplacer la colline. Le carburant plutôt que la foi, décidément…
Le temps passe et met à l'épreuve même la patience des Malgaches. Quelques passagers ont fait demi-tour, en quête d'un véhicule pour rentrer à Tana. Quelques autres ont tenté leur chance vers l'avant, imitant en cela des piétons croisés tout à l'heure, marchant vers Beforono, ses treize ou dix-sept kilomètres, chargés au-delà de toutes les limites. Curieusement, le chauffeur ne parle plus de faire demi-tour — peut-être parce que les seuls qui auraient pu le soutenir ne sont déjà plus là et que les autres, Christine et moi compris, avons décidé d'aller jusqu'au bout de l'aventure, quel que soit le temps nécessaire. Certains n'ont peut-être pas le choix. Nous l'avons, cependant. Mais j'ai de plus en plus envie de voir ce qui va arriver. De toute manière, débarrassé d'une partie de ses occupants, le car est devenu tout à fait confortable et on imaginerait bien y camper définitivement. Seul le ravitaillement risque, à plus long terme, de poser un véritable problème.
Mais le bulldozer a bien travaillé. À la nuit tombante, presque vingt-quatre heures après avoir quitté Tana, un abominable fracas se fait entendre, un concert de moteurs presque joyeux d'avoir à remplir de nouveau leur office. Le nouveau départ se fait sans allant, on avance avec une lenteur exaspérante. Ce n'est pas parce que le plus gros de l'éboulis est rasé que le passage est facile et, au-delà, on slalome pour rester sur les portions de bitume accessibles. Dans la lueur des phares, de loin en loin — de près en près, dirait-on si ça se disait —, la RN2 prend des reliefs incongrus, couleur terre. On ne va d'ailleurs pas bien loin. Le convoi de hasard a encore stoppé, au coeur de la nuit, au coeur d'on ne sait où. Beforono? À quoi servirait de savoir, quand l'obscurité empêche probablement tout travail de déblaiement? Une seule chose est sûre : nous sommes devant un autre éboulis, condamnés à passer une deuxième nuit dans le car en attendant le dimanche matin.
DIMANCHE 5 MARS

Et c'est un matin bien pluvieux qui se lève. La fatigue se fait sentir chez tout le monde, on sent aussi des odeurs de vêtements mouillés qui, tendus un peu partout dans le Boeing, n'ont pas séché. Cette fois, nous sommes en rade dans un endroit moins désert. Je trouve du café à moins de cent mètres, il y a d'autres maisons plus loin, quelques épiceries, une vraie vie de village qui n'est déjà plus Beforono, laissé derrière nous grâce aux quinze kilomètres couverts hier soir. Mais un village quand même, qui s'organise pour l'accueil d'une population aussi provisoire qu'inattendue. Il y a même du rhum, on peut le savoir sans en avoir bu, grâce à l'état dans lequel se trouve l'aide-chauffeur, endormi dans l'herbe et sous la pluie à côté du car. Le chauffeur, quand il le découvre, l'aide à monter pour cuver sur la banquette arrière, c'est-à-dire qu'il le tire et le pousse car il est sans réaction. Ses premiers mouvements, un peu plus tard, seront des spasmes qui obligeront le chauffeur à lui faire repasser vivement la porte dans l'autre sens pour qu'il vomisse à l'extérieur. Bref, il y a du café et du rhum, tout n'est pas perdu.
Tout requinqué par un état des lieux plus favorable aux naufragés de la route, je décide une promenade jusqu'à l'obstacle. Un bien bel obstacle ma foi, plus important que celui d'hier. Et auquel, comme hier, on travaille à la pelle. Bonne chance, me dis-je en tentant la mienne pour trouver à manger. Et je trouve une sorte de miracle, un excellent vary amin'anana accompagné d'un morceau de poisson sec. De quoi redonner le moral à la troupe. Une troupe plutôt dépenaillée par ailleurs. Tout le monde est sale, et ils sont nombreux à profiter d'une rivière pour se baigner en groupes, tantôt des hommes, tantôt des femmes qui font aussi de la lessive. Comment cela se met en place, c'est un mystère. Toujours est-il que cela fonctionne sans heurts et que les gens ont même l'air rigolard. Le temps ne compte guère ici, en voici la plus belle preuve depuis deux ans et demi que j'en ai rencontré d'autres. En outre, le long convoi de véhicules, surtout constitué de camions, et qui s'étire sur au moins deux kilomètres, devient progressivement une communauté, certes de circonstance mais où les signes de reconnaissance se multiplient.
Pendant que tout le monde vague à ne rien faire, un camion se fraie un chemin à travers les véhicules rangés un peu n'importe comment, en double ou triple file parfois, dans l'espoir assez vain et même, à y réfléchir, assez sot, de repartir plus vite — alors que personne ne sait quand on pourra repartir. Sur la plate-forme du camion qui avance malgré tout, un bulldozer dont tout le monde aurait intérêt à ce qu'il gagne sans tarder le lieu de son travail. Bon, acceptons que la bêtise humaine nous fasse perdre une demi-heure de plus, au point où nous en sommes, ce n'est pas cher payé.
Voici enfin l'engin à pied d'oeuvre, sous les yeux émerveillés d'une foule qui guette sa délivrance. À pied d'oeuvre, ou presque. Il ne lui reste qu'à descendre avec une lenteur majestueuse de la plate-forme où il était perché. Il commence à descendre. Bien. Mais ne penche-t-il pas un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Le bel outil de terrassement vacille et finit la descente en manquant une marche, si bien qu'il se retrouve sur le flanc, avec l'air le plus bête qu'on ait jamais vu à un bulldozer. Les grosses chenilles tournent dans le vide, c'est digne d'une tortue sur le dos, gigotant des pattes en ignorant son impuissance à se rétablir. Il faut une intervention extérieure pour remettre la tortue sur ses pattes. Le bull ne s'en sortira pas tout seul non plus. Mais il est plus lourd… Question à mille francs (malgaches) : ça pèse combien, un bull? Au moins, et sans doute plus… Personne ne sait si, une fois redressée, la machine à chenilles acceptera encore de travailler. Mais c'est devenu presque un détail : le monstre abattu se trouve très exactement dans le chemin que les pelles et les bras avaient commencé à creuser et il faudra bien l'évacuer, malgré la bonne volonté que mettent aussitôt les bras à manier les pelles pour dévier le passage. Avec un début de résultat puisqu'un semblant de piste se dessine progressivement sur le monticule informe.
Pendant ce temps, on s'active autour du bulldozer. On cherche, et trouve, un cric. Je crois rêver… Des gens entreprenants s'imaginent relever ça avec un cric? Il est glissé sous le bulldozer qui daigne s'incliner un peu sous la poussée. Quelques tout petits degrés. Il reste du chemin à faire. La remontée se poursuit, dans une fébrilité de ruche. Des planches sont glissées à des endroits bien choisis. Au bout d'un moment, le cric est enlevé, d'autres planches posées, quelques centimètres de cric encore… La ruche fait un travail de fourmis. Certains vont chercher des nouvelles planches, d'autres les scient parce qu'on a besoin d'épaisseur plus que de longueur, d'autres encore attendent de voir la masse s'élever quelque peu pour la caler avec des bouts de bois qui, en la circonstance, semblent des brindilles. Et il y en a un qui est là, sous le bulldozer, au risque de le recevoir sur le crâne (ça pèse combien, un bull?), à pomper pour faire monter le cric et, dans le même mouvement, tout ce qui le menace de son énorme poids. Ils n'y arriveront jamais, me dis-je, mais que l'effort est beau, et la confiance, et l'inconscience!
Et puis, car on a beau être au bout du monde, on n'en est pas moins bénéficiaire du progrès, un attelage de trois camions se met en place, l'un derrière l'autre, l'un destiné à tirer l'autre, et l'ensemble, à redresser le bulldozer. Cela paraît plus sérieux, un combat moins inégal : trois camions contre un bull qui résiste. Un gros câble est enroulé autour de la machine, les moteurs ronflent, tout est prêt pour le dernier acte. C'est tout juste si quelqu'un ne frappe pas un tambour pour les roulements qui précèdent le saut périlleux. Sinon qu'on a beau être bénéficiaires du progrès, on n'en est pas moins à Madagascar. Et, pour mettre toutes les chances de notre côté — du côté des camions —, il convient de pratiquer selon les règles. Un personnage qui a l'air important — nous serions une armée, je dirais qu'il est le plus haut gradé sur les lieux — a en main une bouteille de rhum que la foule s'est cotisée tout à l'heure pour acheter (je croyais que les travailleurs avaient demandé du rhum pour poursuivre, qui la tranchée, qui le rétablissement du bulldozer sur ses chenilles) et des feuilles qu'il a cueillies lui-même à l'instant près de moi. Il crie quelque chose, lève la main, le silence se fait. En un instant, la foule est passée d'une excitation sauvage à un respect profond. Le porteur de la bouteille et des feuilles s'approche du bulldozer, et je ne vois plus rien parce qu'un cercle s'est fait autour de lui. Au centre, il accomplit une petite cérémonie d'invocation aux ancêtres, c'est évidemment à cela que devait servir le rhum. À Madagascar, les ancêtres boivent peut-être plus que nos contemporains. Puis tout le monde s'éloigne, dans un cercle plus large, parce qu'il y a un risque de coup de fouet si le câble se rompt brusquement, bien qu'il soit en acier, et les moteurs qui s'étaient tus sont remis en marche. Les camions entament une lente marche arrière, le câble se tend, tout vibre, le bull glisse un peu mais au moins il bouge, la foule trépigne, le temps de comprendre que, brin par brin, le câble est en train de céder. Pas de coup de fouet, mais une lamentable chose amorphe et inutile. Quand au bull, il est retombé à côté des planches qui le soutenaient. Tout est à refaire, nous avons du temps devant nous. Le temps, pour moi au moins, de faire une promenade jusqu'à Beforono en compagnie d'un vieux vazaha installé à Madagascar depuis je ne sais quand — il parle, il parle, je ne l'écoute guère. Christine voudrait que je lui ramène de l'eau et du chocolat, j'ai de mon côté envie d'une bière — denrées devenues introuvables près de la caravane.
Après deux kilomètres dans la boue, Beforono. Un gros village, où on ne trouve ni eau ni chocolat. Mais bien de la bière et du rhum. Le temps de boire un coup, je reviens au car en abandonnant sur place mon encombrant compagnon, non sans lui avoir conseillé un petit restaurant où je me suis arrêté un jour de l'an dernier, retour de Toamasina, et où la cuisine était succulente. J'espère pour lui que ça n'a pas changé entre-temps.
À mon retour, rien n'a bougé. Mais j'ai repéré, pour Christine et moi, un endroit où manger, à moins de trois cents mètres du car.
Entre celui-ci et le restaurant où nous nous rendons, une voiture bâchée nous dépasse, d'où émergent les bouts de sortes de sacs. Il émane de l'ensemble une odeur pestilentielle. Il y a là deux informations. La première est rassurante : la voiture vient de Brickaville, nous dit-on, et a donc réussi à passer tous les obstacles. La seconde est moins réjouissante : dans les sacs, qui sont des linceuls improvisés, il y a quatre corps, les victimes d'un accident de la route, jeudi, au plus fort de Gloria. L'odeur s'explique par tes trois jours écoulés depuis. Il devrait y avoir un cinquième corps, on ne l'a pas retrouvé. Il doit pourrir en paix au fond d'une ravine…
Au restaurant, on trouve, il fallait s'y attendre, à peine la moitié des plats annoncés sur l'ardoise accrochée au mur. On prend ce qu'il y a, après une longue attente. La cuisine est débordée, on le serait à moins. Notre aide-chauffeur a émergé entre-temps, pas avec les meilleures intentions du monde. Toujours ivre — il a dû cultiver sa cuite au cours de la matinée —, il serre de près, l'expression est faible, une petite serveuse qui doit avoir au moins treize ans et qui tente en vain, dans l'indifférence générale, de le repousser quand ses gestes se font trop précis. Elle est au bord de la crise de nerfs, elle hurle, s'écroule sans cesser de crier, tremble. La scène est pathétique. Le chauffeur, qui se trouve aussi dans la salle, intervient enfin, un peu tard, pour pousser le responsable dehors, puis nous demande de n'avoir rien vu, rien entendu, au moment où un militaire armé d'un fusil entre voir ce qui se passe. Depuis un moment, il y a en effet des militaires partout, pour prévenir on ne sait quoi. Celui qui vient d'entrer considère longuement la fille prostrée sur le sol et, explication reçue ou non, ressort tranquille pendant que nous mangeons, sans appétit pour ma part, à côté de cette enfant qui n'a pas trouvé d'autre moyen de défense et que tout le monde laisse tranquille. Dans le meilleur des cas, pour lui laisser le temps de récupérer. Dans le pire, parce que tout le monde s'en fout.
En début d'après-midi, je retourne au spectacle permanent près de l'éboulis. Pendant qu'on s'affaire toujours près du bulldozer, le cric, les planches et l'huile de bras ayant repris du service, une tranchée approximative a été creusée, où se risquent quelques véhicules légers ou des 4x4. Avec l'aide d'une dizaine de pousseurs, et moyennant une contribution financière à l'effort, ils passent un à un, plus ou moins difficilement. Un 4x4 de l'Unicef reste embourbé une demi-heure. Tout le monde rit — et il y a du monde. Plus fort encore quand un vazaha, à pied, glisse et tombe. Il salue la foule en se relevant, il a été un instant le héros de la fête improvisée. Des applaudissements crépitent, en revanche, quand un motard réussit à franchir l'obstacle d'un seul élan, ou presque. Les heures s'écoulent ainsi, où tout est sujet de distraction.
On en oublierait presque de surveiller le bulldozer qui pendant ce temps, a continué à se redresser lentement, à la main, jusqu'à retrouver son assise. Je n'y croyais plus. En outre, apparemment, il fonctionne, il ne reste qu'à attendre la stabilisation des niveaux d'huile, un peu secoués dans l'aventure, pour le mettre au travail. Ce qui finit par arriver. Le bull entreprend d'élargir et d'approfondir la piste de fortune tracée par des ouvriers laborieux — et il se dit que le Malgache est paresseux! Après tout ça, je mets mon poing dans la gueule du premier que j'entends encore répéter cette ânerie!
Le soir tombe, nous sommes partis depuis quarante-huit heures et tout va bien… Dans une petite maison, nous trouvons du riz et de la viande en sauce, avec un verre de toaka gasy. Et puis, le bruit désormais plein de sens des moteurs qui démarrent. Nouveau départ. La longueur de l'étape, cette fois, est limitée à un kilomètre et demi. On s'arrête, la troisième nuit commence. Depuis vendredi soir, la moyenne est légèrement supérieure à trois kilomètres/heure, elle va tomber sous ce chiffre avant le matin. Je pense aux marcheurs de fond qui couvrent aisément plus de 162 kilomètres en vingt-quatre heures…
LUNDI 6 MARS

Quand le jour se lève, nous sommes en pleine campagne. Avec la certitude de n'être pas trop éloignés du village où nous avons passé la journée d'hier. D'ailleurs, très vite, les campagnards — surtout les femmes, en fait — longent le convoi avec du café, des beignets, de la soupe… Le ravitaillement vient à nous. Une camionnette arrive de l'arrière, avec du pain vendu 750 francs malgaches pièce. Christine en trouve, un peu plus loin, fourré d'une omelette onctueuse. Les choses pourraient être pires et, dans le car, la bonne humeur règne. Trois petites filles de cinq à sept ans, avec leurs mamans, ont décrété que j'étais leur papa vazaha. Ce n'est plus une communauté, c'est une famille, et je me sens adopté, fier de l'être.
Cela n'empêche pas la curiosité. Puisque ce voyage, bien que compromis, doit se faire, il se fera, mais il vaut la peine de se renseigner sur les conditions qui nous attendent encore. Je repatauge un bon kilomètre dans la boue où une de mes sandales rend l'âme, aspirée par la terre d'où mon pied essayait de l'extirper. Je n'ai sauvé que la lanière!
La récompense est à la hauteur de l'effort : au terme de la promenade achevée en clopinant, je contemple le plus beau, le plus formidable, le plus impressionnant éboulement que nous avons rencontré depuis nos débuts laborieux. Il y a là vingt à trente mètres de terre, sur au moins la hauteur d'un conteneur puisqu'il y en a un au milieu de ce fatras qui a charrié des rochers et des arbres, englouti sur toute sa largeur — il est couché sur le côté. Mais deux bulldozers sont déjà sur place à s'activer pour dégager la route.
Heureux d'avoir des informations à distribuer, j'explique au vazaha impatient, retrouvé sur la route, qu'ils en auront terminé dans deux ou trois heures. À midi cependant, quatre heures plus tard, rien n'a encore bougé et je repars sur les lieux de l'action, pieds nus cette fois. L'obstacle a considérablement diminué, à défaut d'être complètement nivelé, et trois bulls y patinent lourdement mais avec une énergie qui fait de leur ballet une sérieuse source d'espoir pour la suite. D'autant que, s'il faut en croire des rumeurs confirmées par la longue queue de véhicules qui s'étire de l'autre côté, ce serait le dernier obstacle à nous bloquer vers Toamasina. On ne demande qu'à le croire, même s'il est devenu difficile de croire quoi que ce soit. Par ailleurs, on dénombre maintenant quelques morts dans le convoi — de mort naturelle, précise-t-on immédiatement, de peur de voir l'ombre du choléra s'étendre sur nous.
De retour au car, j'ai à peine le temps de profiter de la proximité du village pour y acheter des cigarettes que nous repartons, par petites avancées prudentes d'une dizaine, parfois d'une centaine de mètres. Il faut faire passer des véhicules dans les deux sens et la chicane pratiquée dans l'éboulis est très moyennement praticable. Une fois celle-ci franchie, un passager comptera près de deux cents véhicules bloqués en sens inverse. Ce devait être comparable de notre côté…
Un peu plus loin, un conteneur de 20 pieds s'est renversé dans un fossé. Trois kilomètres encore, puis un passage difficile, où il faut choisir la bonne trajectoire sous peine de s'embourber à coup sûr. Comme de bien entendu, un camion le fait devant nous. Une nouvelle demi-heure perdue, on n'est pas regardants. Puis c'est un conteneur de quarante pieds basculé dans une rivière. Et, avant un pont, une nouvelle queue se forme, les moteurs une fois encore silencieux. Tout recommence… Il est presque quatre heures de l'après-midi, un petit ruisseau coule à côté du car, l'occasion de se débarbouiller. Cela fait, et puisque les activités proposées sont limitées, nous partons à quelques-uns vers l'avant. Au-delà du pont, un camion est resté planté dans la boue, pas moyen de l'en faire sortir. D'autres passagers nous ont rejoints, il y a une épicerie, fournie en bière. Après la bière vient une envie de rhum. «Misy rhum? – Tsisy. – Misy toaka gasy? – Misy!»
Et c'est le quatrième soir… Dans l'obscurité, le camion qui bloquait tout s'est enfin libéré du piège, les autres véhicules suivent, parmi lesquels le car que nous attrapons au vol car la gendarmerie lui interdit de s'arrêter. Et pourquoi d'ailleurs s'arrêterait-on maintenant que c'est enfin le bon départ? Plus personne ne pisse, plus personne ne boit, plus personne ne mange — sinon les dernières provisions acquises à l'occasion de cet ultime incident de parcours. Il ne reste «que» cent cinquante kilomètres, à parcourir d'un trait, sans plus perdre de temps, chacun tendu vers le but — atteint à dix heures du soir, septante-cinq heures et demie après le départ.
Copyright © Pierre Maury, 2005.
|