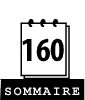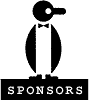|







|
|
MOI ET MAX (suite)
Max me manquait. Je ne savais comment m'arranger ni à qui m'adresser pour retrouver sa trace. J'étais sans nouvelles de lui, ce qui laissait supposer qu'il avait été déporté. Les deux années que je venais de passer m'avaient coupé de tout. À l'université, je croisais d'anciens camarades d'athénée, mais nous osions à peine nous reconnaître. Un fossé nous séparait. L'ivresse de la Libération passée, j'ai vécu les semaines qui suivirent avec le sentiment parfois intolérable de l'absence de mon ami. Le vide qu'il laissait se combinait à l'incertitude où j'étais de son sort. Cette incertitude m'était plus pénible que son absence. Je n'avais plus d'ami, ne désirais pas en avoir.
Plus le temps passait, plus m'apparaissait l'évidence de sa disparition. Je n'avais pas la preuve qu'il avait été déporté, mais s'il ne se manifestait pas, c'est qu'il avait disparu. La vérité sur les camps nous était révélée, et d'imaginer Max transformé en un de ces squelettes qui les avaient peuplés m'était proprement intolérable. Nous avions appris qu'il y avait eu 28 convois. Avait-il fait partie des premiers, des derniers? Je me disais que s'il avait fait partie des derniers, il aurait peut-être eu l'occasion d'en réchapper. Mais cette dernière espérance s'effilochait avec le temps. En plus, je commençais à être atteint par le mal du survivant. Ce que j'avais subi me semblait dérisoire en comparaison de tout ce qui était révélé et au soulagement d'avoir été épargné se mêlait la culpabilité de ne pas avoir partagé.
Oh! Max…de mes quatorze à mes dix-neuf ans tu fus à mes côtés. Pendant ces années tu as participé à ma vie, tu étais là et nous étions amis, tu m'apportais ce que tu avais à me donner et je t'apportais ce que j'avais à te donner. Dans ce partage tu fus le plus honnête de nous deux car tu m'apportais ce que tu étais, et moi, ce que tu imaginais de moi. Mais Max, je puis te le dire, jamais tu ne fus aussi présent qu'en ces jours où tu n'étais pas là.
Le 28 décembre 1945 à sept heures du soir, au moment où nous nous mettions à table, on sonna. C'était Max.
Nous nous sommes embrassés. Nous l'avons invité à partager notre repas. Nous ne savions ni ce que sa famille ni ce que lui étaient devenus depuis juillet 1942. Cette incertitude s'installa à notre table, tel un convive censurant chacun de nos propos. Aucun n'osait poser des questions à Max. À un moment donné, comme il portait la fourchette à la bouche, Max l'a redéposée et a dit :
– Je crois qu'il est préférable que je vous dise immédiatement que j'ai été déporté à Auschwitz.
Il nous a montré son bras et a souri.
– Eh bien, cette formalité remplie, je suis sûr que nous nous sentirons plus à l'aise.
J'étais plongé dans la brume. Il est banal de dire qu'on se trouve «devant un fantôme». Il était cela Max, un spectre renaissant de nos vies antérieures… Il revenait en même temps de deux mondes. Celui de mon deuil et celui des camps. J'étais paralysé. Je n'éprouvais nulle joie de le revoir. C'était simple : je n'éprouvais rien. Toutes les pensées, toutes les images, toutes les résignations, toutes les révoltes qui s'étaient accumulées en moi s'agglutinaient en un bouchon qui obstruait le passage à une émotion quelconque.
Max avait empâté et rien dans son aspect ne faisait penser à un de ces déportés dont les actualités au cinéma, les journaux, les magazines nous donnaient une image insupportable, ni à un de ces rapatriés des camps qui débarquaient, misérables, des trains venus de l'Est. Max portait un deux-pièces de bonne coupe et c'était la première fois que je lui voyais porter une cravate. Tel quel, il ne manquait pas d'allure. Petit à petit, je me reprenais et j'ai dit sur un ton enjoué :
– Je ne t'ai jamais vu aussi bien fringué, Max. Tu es superbe.
En connaisseur, mon père a confirmé.
– C'est du sur mesure. Le costume te va comme un gant. Le tailleur qui te l'a coupé connaît son métier.
Max a opiné.
– Ça aide à se faire des relations… C'est une carte de visite. Ce qui est encore plus important, ce sont les chaussures. Une paire de godasses minables, ça fait démarcheur besogneux.
– C'est vrai, ce que dit Max, a confirmé mon père.
J'y sentais je ne sais quel besoin de donner un sens à ce qui se disait.
– Je me rappelle, avant…
Pendant une fraction de seconde, mon père est resté accroché au «avant».
– …Avant, rue Sainte-Gudule, quand un représentant s'amenait avec des chaussures avachies ou pas cirées, il était déjà classé!
En un flash-back, j'ai revu Max, pendant l'exode, ramenant à son père les chaussures vernies chapardées dans la maison abandonnée. Avait-il jamais eu l'occasion de les porter, son père?
Il y eut un atome de silence que mon père redouta. Il dit, pour dire quelque chose :
– Un bon vendeur, ça court pas les rues. C'est un métier.
– C'est plus qu'un métier, a dit Max, c'est une vocation. Tu dois donner l'impression de faire une fleur à celui auquel tu veux refiler ta marchandise.
Exclu de ce dialogue – y assistant perdu dans mes propres pensées – je me sentais godiche dans mes vêtements d'étudiant. J'étais dans la filière du potache que j'avais été, que restait-il du Max que j'avais connu, dans celui qui était assis en face de moi, dans son beau costume sur mesure, séparé de moi par la distance Bruxelles-Auschwitz, distance hors du temps, hors des paramètres de la vie? Ce Max n'avait plus rien à voir avec celui que j'avais connu. Auschwitz me l'avait volé. L'avais-je retrouvé pour le perdre? N'était-il pas déjà perdu?
C'est ma mère qui a demandé :
– Ça n'a pas été trop dur de nous retrouver, Max?
Elle voulait savoir si ses recherches pour nous retrouver à notre nouvelle adresse n'avaient pas été difficiles, mais l'adjectif «dur» donnait à la question posée à Max une ambiguïté qui atteignait au plus profond notre famille préservée. Max a réagi comme si de rien n'était.
– Il m'a fallu du temps, mais vous voyez, j'y suis arrivé. Je suis là.
Des yeux, il a fait le tour de la table.
– Ça fait plaisir de nous retrouver tous.
Le « tous » m'a fait un drôle d'effet et j'ai eu le pressentiment de ce qui allait suivre, lorsque ma mère eut la force de continuer.
– Et ta famille, Max?
Nous devinions, nous connaissions déjà la réponse.
– Déportés, avec le sixième convoi, le 29 août.
Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père a demandé :
– Et toi, Max, quand?
– En 1943.
On est restés silencieux. Ma mère avait préparé des latkes. Max l'a complimentée.
– Une merveille, vos latkes. Exactement comme… Je m'en ressers!
De sa fourchette il en a piqué deux dans le plat, les a saupoudrées de sucre et sans transition a dit :
– J'ai vu Hélène là-bas.
Bêtement, je me suis exclamé :
– Hélène!
– Oui, Hélène…
La grange du nord de la France, l'odeur du foin imprégnée de chaleur, et tout, et tout.
Ma mère a voulu demander :
– Elle a…?
Elle ne parvenait pas à énoncer la question et elle fut secouée par une nouvelle crise de larmes.
Max a dit :
– Oui, elle a été gazée.
C'était laconiquement précis. On n'a rien osé demander au sujet des parents d'Hélène, comme nous n'avions rien osé demander sur sa famille à lui, après son «déportés».
– Nous voyons souvent les Baum, a articulé mon père. Ils ont eu de la chance. Ils ont tous réchappés. Un vrai miracle.
– Comme nous…
Ça m'est sorti... Il y avait déjà dans ce «comme nous» toute la culpabilité du survivant. Entouré des miens, je crois bien que jamais je ne me suis senti aussi seul que dans la solitude de Max installé à cette table, avec nous, jamais je ne l'ai perçu aussi isolé que parmi les miens – comme s'il ne faisait pas partie des miens. C'était intolérable, Max. Tu étais mon ami, mon unique ami, et pourtant, tu ne faisais pas partie des miens. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables de nos mauvaises pensées. On a beau les chasser sur le champ – on voudrait les exterminer. N'empêche!… elles prennent naissance dans nos tréfonds inavouables, elles sont nos enfants illégitimes. L'espace de quelques secondes, – une seconde, un quart de seconde, qu'importe! – j'ai considéré Max comme un intrus et j'ai pensé : J'aurais préféré qu'il ne vienne pas.
Sur un ton qu'il voulait désinvolte, mon père a poursuivi.
– Et maintenant, Max, qu'est-ce que tu deviens?
– Je me débrouille… J'ai ouvert une affaire de stock américain avec un associé.
– À Bruxelles?
– Oui à Saint-Gilles.
– Ça marche?
– Le tout est de trouver des marchandises. Des clients, il y a plus qu'il n'en faut.
Il a répété :
– Mais on se débrouille. Et vous?
Je continuais à me sentir écarté de la conversation.
D'une mallette qu'il avait déposée à côté de lui, Max a sorti du café, du chocolat, des cigarettes Camel et des Players…
– Je vous ai apporté ça à tout hasard, ça peut toujours servir… Tu fumes, Daniel?
Copyright © Samuel Szyke, 2006
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|