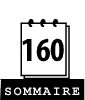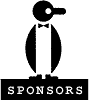|







|
|
JE PEINS ET J'ÉCRIS
J'ai vu, à sept ans, un épileptique terrassé sous un grand tableau rouge. L'évènement ne m'initiait pas à la peinture : les odeurs de terre et de métaux exaltés par l'huile m'étaient depuis toujours familières, je connaissais la fascination de l'icône dont l'orthodoxe affirme qu'elle montre le mystère que le verbe ne pourrait dire. (Née en Russie d'une aristocrate et d'un peintre par ailleurs juge de paix, ma mère fut une illustratrice renommée.) Je trouverai à me détendre de mes études secondaires par la pratique du dessin et de la peinture tous les soirs de semaine et le dimanche matin. Dissertation exceptée, le diplôme d'humanités gréco-latines fut une formalité sans gloire. Durant les derniers examens je vernis la tablette dessinée, gravée, partiellement colorée de mon banc. Elle sera exposée un an aux murs de la classe de rhétorique puis volée. Par facilité sans doute, je fréquentai le cours de peinture d'après nature de l'Académie de Bruxelles. Nanti du brevet de maîtrise, j'y fus à 21 ans nommé assistant-éducateur du cours de gravure, et devins professeur de lithographie à l'École des Arts d'Ixelles, à l'issue de ce mandat. Mon œuvre à venir échappait à la pression économique.
Mon adolescence avait été éclairée par l'enseignement d'un artiste de dix ans mon aîné. Je ne me suis accompli dans la peinture qu'après sa mort, par une expérimentation de la couleur affranchie de la représentation, donc vide de signification, tout à l'opposé de son engagement et de ses aptitudes. (Peu sensible à la couleur, il servait un réalisme social qui glissera du fantastique au fantasmatique). Je le vis se lasser de peindre. Impressionné par les chefs-d'œuvre africains dont il s'entourait en expert passionné, il devint sculpteur. Mon père mourut. Cette année-là mon ami me montrait quelques broderies des Shoowa du Kasaï, dont les géométries piègent l'œil dans des parcours sans fin. Débuta une chasse aux trésors qui fit de moi son rival. Car, parmi la dizaine de milliers de ces compositions que je pourrai apprécier, et dont je posséderai plusieurs centaines, quelques dizaines seulement m'imposeront durablement leur activité : l'œuvre est rare parmi la multitude des artefacts produits par nécessité, opportunité ou vocation, parfois par jeu. J'appris que les broderies shoowa sont offertes aux défunts, avec eux enterrées, que les figures élémentaires de leurs dessins sont scarifiées sur les ventres des fillettes, futur attrait sexuel grandissant avec l'âge, que les femmes n'en composent les intrications qu'enceintes. J'en dessinai la genèse, du simple au complexe. J'écrivis comme je pus mes constats. J'étais père depuis peu lorsqu'ils furent publiés. La vente de ma collection à un musée parisien m'offrit la maison où nous vivons, mon épouse et moi, avec un atelier pour chacun (elle est peintre, fille de peintres, arrière petite-fille d'un peintre jadis réputé), un jardin planté d'arbres et un étage pour notre fils né pendant la mutation de mon travail.
J'avais invoqué la présence sous l'apparence, tenté périodiquement de me défaire d'une représentation par essence nostalgique. Je m'essayai alors à l'abstraction lyrique, sur de petits panneaux carrés, sans leur arrêter d'orientation : des mobiles tenus par des aimants à un support métallique, associables par chaque côté à d'autres de mêmes dimensions. Chaque pièce constituait un tableautin polychrome avec une dominante ou deux, que quiconque isolerait ou combinerait à sa guise selon la multitude des possibles. Les pièces s'agrégeaient suffisamment pour constituer un ensemble que le regard puisse parcourir de région en région, pas assez cependant pour que les variantes de ce tout ne demeurent en attente de résolution définitive. Rares furent les amateurs qui désassemblèrent et reconstruisirent mes propositions. J'entrepris une combinatoire similaire au sein de chaque composition. J'agrandis et synthétisai quelques-uns de mes tableautins abstraits, réduisant jusqu'à les abolir les courbes et des obliques qui accaparent l'attention au détriment de la prégnance des tons. Je puisais mes couleurs dans la mémoire de moments d'émotion forte. Nourrie de mes dépouilles, mon œuvre m'infligeait le sentiment d'une consumation, qui me quittera à mesure que je me détacherai des affects par l'expérimentation de la matière colorée. J'assiste désormais aux phénomènes. Je les anticipe. Je visualise ou prévois. J'exécute sans émotion. J'aime ce présent étale qui me libère du ressassement de la pensée. Le plaisir de faire transparaît certainement dans le produit. Ma peinture se distingue de toute autre par le temps indéfiniment renouvelé d'un espace instable perpétuellement.
Un ami peintre me fit rencontrer l'enseignant qui marqua l'œuvre abstraite de ses débuts, avant qu'il opte pour une imagerie surréaliste, tandis que ce professeur se consacrait à la recherche au sein du laboratoire d'esthétique expérimentale créé pour lui, excroissance de l'unité de psychologie perceptive au sein d'une faculté de médecine. Aux registres à travers lesquels notre esthétique rencontre l'art, celui des contenus ou du sens (représentation, signification, intention) et celui des moyens (poïétique ou schématique des formes), il ajouta celui des forces ou de l'énergétique par laquelle l'œuvre active la sensorialité dans une saisie globale de notre intégrité physique, qui affecte la sensation que nous avons de nous-mêmes (cénesthésie), traduite par les sentiments de bien ou de mal-être et d'autres, dont la tonalité affective est toujours très marquée. Trois mois après notre visite commune de la première exposition de mes commutations, le scientifique m'en livra une étude très complète intitulée Déhiscences. Ce terme de botanique désigne le processus par lequel les organes clos s'ouvrent naturellement à leur maturité. La rupture d'une totalité finie (la surface initiale), son ouverture sur la démultiplication des possibles et la faille indéfiniment entretenue qui en résulte résument en un mot ma démarche. L'auteur concluait ainsi son étude : «ce n'est plus le peintre, mais l'œuvre même qui institue devant nous ce rite d'émergence et de disparition, de naissance et de mort, auquel, je pense, aucune autre peinture ne nous avait fait assister.»
Dès que je ne pense plus, je pose la couleur vive. Je m'en tiens aux rectangles contigus en grille droite inégale. Je joue d'oppositions et d'affinités aussi variées que possible dans un rapport d'ordres et de désordres relatifs. Un signal attire l'œil, une configuration se détache un moment. Bientôt d'autres combinaisons la supplantent, puis d'autres, indéfiniment. Plus j'agis vite, plus s'enchaînent les apparitions et les disparitions. Une houle de sensations fait et défait l'étendue. Je prends du recul. Je corrige des écarts pour amplifier la fonction qui s'effectue, contraignante tant que dure l'attention. Sa dynamique est active sous n'importe quelle lumière. Qui la regarde s'y voit vivant. L'émergence renouvelée suffit à abolir l'inertie de la matière actée. La permutation se perpétue au cœur d'une faille auto-entretenue. Je me reconnais dans ce dépassement sans transcendance. Son chant ne suggère rien. Aucune réminiscence ne le hante.
À peine délivré du bruit du sens, je fus invité à écrire en hommage à cet ami sculpteur, brutalement disparu, que nul ne célébrait. Je m'étais émerveillé de son enthousiasme. J'avais été navré de le voir se détruire. Je fus sidéré d'apprendre, du journal qu'il tint durant vingt ans, le gouffre dans lequel il avait sombré corps et âme tandis que son imagerie basculait de la tendresse à la violence, à la souffrance avec délectation, à la terreur. Sa famille attendait l'exaltation du génie, elle fut choquée. D'autres me solliciteront. J'évoquerai les exploits d'une douzaine d'artistes amis ou proches, ceux d'artistes-enfants, ceux conçus selon divers handicaps physiques, mentaux ou sociaux. L'œuvre se suffit de silence dans l'action spatiale, elle s'offre en réalité physiquement éprouvée. Faute d'un tel accomplissement, j'en apprécie la tentative, je m'attache aux vécus authentiques.
À ses heures, poète, excellent parfois (mon frère écrit bien aussi), puis persévérant ethnologue de traditions populaires immémoriales (ma sœur est une musicologue très scientifique), mon père possédait des sculptures congolaises avant ma naissance. Il les vendit à un musée pour acheter la maison familiale. L'acquisition de ma propre maison n'épuisa pas le pactole offert pour mes broderies, le reste fonda une collection d'œuvres d'une variété de cultures dont j'eus l'opportunité de nourrir ma compréhension de l'art. L'essentiel de mes écrits consiste en études, que personne n'attend, d'arts archaïques dont les exploits d'artistes tendent un lien entre animalité et devenir humain, par-delà la faille du langage qui nous dédouble, car nous sommes à jamais partagés entre nature et culture. L'écriture me détend de l'effort pictural et me fait réfléchir. Mes travaux peu académiques ont été publiés par de grands éditeurs. À les relire je constate la médiocrité de ma littérature et la prétention de mes affirmations. Mais cet exercice me conforte dans la conviction nécessaire à la persévérance dans la peinture, un exercice solitaire. Mon opinion contestable a enrichi ceux qui ont su l'exploiter. Mes détracteurs adhèrent au courant de pensée selon lequel la signification est la raison d'être de l'art. Ce point de vue domine l'enseignement, le marché et le musée depuis un demi-siècle de décadence accélérée.
Je conserve donc, tant que leur activité m'imposent leur pouvoir, des œuvres de notre tradition présente ou passée ainsi que celles de peuples d'outre mers et d'outre temps, des sculptures tanzaniennes et oubanguiennes notamment, restées méconnues parce que peu visibles selon les critères de l'esthétique apollinienne qui privilégiait l'harmonie de la forme sans prendre en compte la tension induite par le travail des forces mises en œuvre, une induction radicale au sein de cultures dont les sociétés peu instituées n'imposent guère le sens politique à l'artisan et livrent le sculpteur à l'inconnu dont il lui faut évoquer ou invoquer l'action. Comment «restituer» par une «représentation» les forces naturelles ou surnaturelles invisibles? L'efficience magique de leurs créations se confond de fait avec leur prégnance esthétique.
Née de la perpétuation funéraire, l'imagerie s'étend à l'invocation de toutes sortes d'entités occultes auxquelles la culture rend des comptes ou des cultes, bien que l'incantation ne nécessite aucune figuration puisque de simples objets naturels sacralisés y suffisent. Puis la figuration en vient à celle des héros mythiques qui fondent la société par couples, au seuil qui distingue et parfois persiste à confondre l'humain et l'animal, le culturel et le naturel. Nombre d'auteurs ont souligné le caractère organique des créations de peuples soumis à une nature implacable que leurs cultures complexes conjurent par magie. Celles-là rencontrent la réalité sur un plan dont les sociétés plus structurées tentent de se défaire absolument. Mais plus le politique impose son sens à la création, plus celle-ci peine à franchir l'écart entre le naturel et le culturel. Les œuvres avérées y parviennent, qui travaillent effectivement la part réflexe (biologique) de notre perception. L'art illustre alors le basculement sans hâte de l'état de nature à celui de culture. Son imagerie est d'usage privé, quotidien ou événementiel, autant sinon plus que d'usage collectif ou lié aux rites de passage.
Existe un art au moins qui ne sert ni sacralité ni pouvoir, art éphémère peint sur la peau ou sur les pagnes de liber battu jetés après usage : celui des pygmées Mbuti, peuple de chasseurs-cueilleurs errant depuis des millénaires dans les forêts de l'Ituri. Là, sous un ciel masqué par la forêt, dans le bruit constant des petites choses qui cassent, tombent ou grouillent, les femmes tracent la leçon première du dessin. Telle jeune fille aux fesses rebondies se peindra un seul énorme point sur l'une d'elles, telle autre choisira les rythmes linéaires qui étireront sa silhouette élancée. Des points jetés au hasard sont réunis par la ligne en constellations. Relier les parallèles, articuler les cheminements, identifier les géométries issues de croisements singuliers. Trois cents figures déduites de ces jeux de séduction concourent à l'infinité des possibles. De nombreuses enquêtes ont tenté de les lire. Aucune n'a prouvé qu'elles soient signifiantes. Sur l'écorce fine et souple évoluent des progressions mimétiques de mouvements naturels, des croissances, parfois en imagerie allusive du processus de la génération, jusqu'à l'assaut de minuscules vers la cavité d'une matrice. Les Mbuti n'ont ni chefs ni lois (ils riront longtemps de l'auteur de la faute qui les mit en péril). Ils ne pratiquent ni sorcellerie ni rite, pas même funéraire. Ils consacrent peu de temps à leur survie. Ils content des histoires, dansent, chantent des polyphonies d'une étonnante spatialité.
Je craignais d'exploiter ma singularité, l'auteur de Déhiscences me révéla l'universalité des automatismes perceptifs que j'apprenais à maîtriser. À la lecture de ses travaux, je réaliserai combien mon œuvre contraignante soutient sa «théorie du champ pictural». Nous étions proches, complices parfois, lorsqu'il me reprocha un texte que je lui soumettais avant publication, dans lequel j'usais, sans en référer systématiquement à sa propriété, de mots investis du sens neuf qu'il m'enseigna comme à tant d'autres. Il se sentit floué. Je détruisis mon texte, son amertume persista. Il compléta néanmoins son étude, précisant notamment la question du contour que je ne trace pas : les limites des surfaces rectangulaires en tiennent lieu. Contigües, orthogonales, celles-ci forment cependant des grilles incomplètes selon une variété d'algorithmes. «La mise en rivalité des contrastes et des contours à la limite de formes aliénées à la couleur» m'a permis, écrit-il, «d'obtenir ce qui semblerait impossible, qui est de dissocier la forme de son contour pour pouvoir le réattribuer à toute autre forme ou groupe de formes.» La mobilité des contours est en effet le moteur de ma peinture, acquise par transparences, transpositions, transfigurations – un terme qui semble pour longtemps réservé au domaine religieux.
Une fin d'hiver (nous renouions une prudente relation), mon ami entreprit un texte sur l'africanité de mon art. Reflet d'une culture de l'unité, la peinture d'Occident n'a jamais tenté une telle combinatoire d'incomplétudes, un archaïsme de société tribale. Cette réflexion l'éloignait trop de ses recherches, il l'abandonna. L'été suivant, sur trois visites enthousiastes de mon exposition intitulée Pas besoin de lumière, il travailla fébrilement cette question : l'induction figurale, dont il me reconnut l'accomplissement, serait-elle la résolution du puissant et énigmatique Victory Boogie Woogie, l'œuvre ultime de Mondrian restée inachevée après trois ans d'hésitations? Auteur des «Études sur Mondrian» auxquelles il consacra moins d'années qu'à mon œuvre, il avait, dès Déhiscences, cité la dernière lettre du peintre célèbre terminée par ces mots : «en art, on oublie trop souvent l'élément destructif». Un glaucome foudroyant lui coûte alors un œil (il est diabétique, cardiaque, octogénaire). Il m'écrit : «Tu m'as fait comprendre que le mot tension, qui est au fondement de la théorie du champ pictural, n'a rien d'une métaphore.»
Copyright © Georges Meurant, 2009
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|