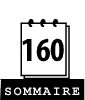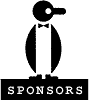|







|
|
LIRE 1984
|
Si vous regardez dans votre esprit, qui êtes-vous, Don Quichotte ou Sancho Pança? Selon toute vraisemblance, vous êtes les deux. Il y a une part de vous qui souhaite être un héros ou un saint, mais l'autre part a les traits d'un petit homme gras qui voit très bien les avantages de rester en vie, avec toute sa peau.
George Orwell, The Art of Donald McGill, septembre 1941.
|
1er janvier 1984. Promu prophète d'un jour par la vertu d'un titre millésime, George Orwell occupe la une des magazines, du Time au Spiegel et son nom fait la manchette des plus grands quotidiens du monde. Dès le second semestre de 1983, les excès de "l'Orwell industry" sont "devenus une sorte de cauchemar orwellien en eux-mêmes. Big Brother, sous la forme de Big Crick et d'autres entrepreneurs de cette industrie, remplissent nos écrans de télévision, subjuguent les ondes radios et inondent les colonnes des journaux"(1). Devenu ici un épouvantail, là un argument publicitaire, "George Orwell doit se retourner dans sa tombe (…) Partout dans le monde, une part substantielle des médias et du monde académique est prête à "apprécier" ses idées d'une manière qui aurait confirmé ses pires appréhensions"(2).
George Orwell survivra-t-il à 1984? Une fois les inévitables scories éliminées, l'engouement général pour, ou plutôt autour de 1984 aura été l'occasion d'un effort de recherche remarquable et d'une diffusion de l'oeuvre d'Orwell et de ses thèmes de réflexion majeurs.
Avec l'année Orwell se sont accumulées des relectures du livre qui me paraissent susciter autant de 1984 imaginaires. Ici, on reprochait à Orwell d'avoir usé sous l'influence de Zamiatine et d'Huxley d'un "bric-à-brac futuriste…"(3); là, on comptabilisait les "erreurs" commises par l'auteur dans ses anticipations(4), pour se réjouir du démenti que l'humanité avait infligé à son pessimisme(5).
Avant d'examiner le sens et la postérité du livre, il m'a paru indispensable de rendre la parole à son auteur, d'abord en sondant ses intentions, ensuite en remettant à jour la structure profonde du roman. J'ai donc tenté de reconstituer un dialogue imaginaire entre l'historiographe et l'écrivain(6) :
«Dites-moi, George Orwell, quel regard de témoin portez-vous sur votre roman 1984?
«– Un affreux, un abominable gâchis. Mais l'idée était si bonne que je n'ai pu me résoudre à l'abandonner. Depuis juin 1947, j'ai dû porter, avec le poids du livre, celui de la maladie qui me rongeait. Souvent j'ai été incapable d'écrire, de me concentrer, de conserver au roman tout l'équilibre de sa construction. L'histoire aurait été sans doute moins sinistre et la mise en phrases meilleure si je n'avais pas été si malade.
«Comment définir 1984? C'est un livre sur le futur, sans être un roman d'anticipation (en-dehors du télécran, il ne contient pas de nouveautés techniques). Chaque Anglais y retrouvera une part de son quotidien. Je crois que cette volonté de réalisme sera pour beaucoup dans la force du livre.
«1984 est une sorte d'utopie (ou, comme diront les spécialistes du futur, de contre-utopie), un modèle de société où les tendances que l'on peut observer aujourd'hui auraient été prolongées jusqu'à leur fin dernière. Je ne crois pas au triomphe inéluctable de Big Brother dans le monde occidental des trente ou quarante prochaines années. Mais je suis convaincu que quelque chose comme 1984 pourrait arriver.
«S'il vous faut une morale pour comprendre la signification profonde du roman, adoptez celle-ci : "Ne permettez jamais que cela arrive. Cela dépend de vous!"
«Le totalitarisme, si on ne le combat pas, peut triompher n'importe où, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. Il peut naître non d'une victoire militaire de l'URSS (rendue improbable par l'équilibre de la terreur) mais d'un cancer qui attaquerait sournoisement les institutions démocratiques. Le danger est triple. Il peut venir des structures imposées aux communautés libérales par le climat de guerre froide, des effets pervers de l'économie centralisée et de l'acceptation de la perspective totalitaire par les intellectuels de tous les bords.
«Un totalitarisme occidental conserverait probablement le discours démocratique comme une simple rhétorique mystificatrice. C'est le sens du nom "ingsoc" (socialisme anglais) que le régime océanien donne à sa doctrine. Si j'avais écrit mon livre aux États-Unis, j'aurais sans doute choisi "américanisme" ou "cent pour cent américain"!»
1984 a été conçu comme une projection de 1948. Dans un monde déchiré en trois grands blocs hégémoniques, la Grande-Bretagne est devenue "Airstrip One", la piste numéro 1, une région de second ordre de l'Oceania. Londres n'est plus qu'une métropole croulante où l'urbanisme hérité du 19e siècle achève de se décomposer.
La société océanienne est divisée en trois cercles. Elle est totalement dominée par le Parti intérieur (2% de la population) qui s'appuie sur les fonctionnaires du Parti extérieur (15% de la population) pour gérer l'État et la société. Les "prolos", travailleurs manuels, forment le reste de la population. Privés d'enseignement, ils échappent au "contrôle de la pensée" : l'excès de travail, la misère, l'alcool, la loterie et la propagande paraissent suffire à les abrutir.
L'objectif de l'État est de parvenir au contrôle total de la pensée, d'abolir la notion de vérité absolue et de parvenir à la maîtrise complète de la mémoire humaine. Pour arriver à ses fins, le Parti intérieur dispose de trois armes principales. Le télécran, à la fois téléviseur et caméra, permet d'effectuer un contrôle permanent sur la vie publique et privée des membres du parti. On ne peut ni stopper l'appareil, ni savoir quand on est réellement observé. Mais l'intrusion permanente du parti dans l'existence de chacun de ses membres ne s'arrête pas à ce gadget électronique (qui est la seule concession d'Orwell à l'anticipation). Chaque individu est un dénonciateur potentiel au service de la "Police de la Pensée". L'enrégimentement des enfants dans les organisations de jeunesse du Parti introduit la délation et l'espionnage au coeur de la vie familiale. Mais, plus encore que sur la coercition, le pouvoir du Parti et de son chef Big Brother repose sur la dilution constante de la vérité des faits : Oceania est perpétuellement en guerre avec l'un ou l'autre des super-États, Eurasia (autour de la Russie) et Estasia (autour de la Chine et du Japon). Dans ce conflit triangulaire, les alliances se nouent et se dénouent mais, lorsque l'ennemi du jour change, le passé est adapté à la situation nouvelle : l'allié de la veille redevient l'ennemi de toujours.
Cette réécriture du passé est assurée par le Miniver, le ministère de la Vérité. Sans relâche, ses fonctionnaires ajustent les documents pour les rendre conformes à la vérité changeante de l'instant présent. La correction est introduite dans un exemplaire du Times sans cesse amendé. Ce travail s'étend à toute la sphère des moyens de communication de masse qui sont produits et contrôlés par le Miniver, journaux, tracts, films, romans, disques…
La dictature de Big Brother est en réalité une "logocratie". L'ordre y est moins maintenu par la terreur (entretenue par les disparitions) que par l'idéologie. Le "contrôle de la pensée" devient une conduite intériorisée par chaque citoyen. Il est facilité par l'effacement graduel de l'anglais (ancilangue) devant une langue nouvelle (novlangue). La novlangue a pour fonction de rendre toute pensée hérétique littéralement "impensable" et informulable. Ainsi, le mot "libre" peut être utilisé en novlangue pour exprimer une idée telle que "la voie est libre" ou "cette place est-elle libre?". L'évolution de la syntaxe et du vocabulaire (le nombre de mots qui constituent un lexique ne cesse de diminuer) ne permet plus d'accoler "libre" à d'autres mots comme pensée, entreprise, parole…
L'objectif final du Parti intérieur est d'aboutir au processus de "double-pensée", un mode de raisonnement schizophrénique qui permet de connaître et de ne pas connaître, d'admettre une vérité et son contraire. Au stade ultime, la "double-pensée" aboutit au "mentir-vrai"(7), qui permet de tricher en toute conscience, d'effacer de la mémoire le souvenir même du mensonge. L'exercice de la "double-pensée" est facilité par "l'arrêt-du-crime", la capacité de s'arrêter net comme par instinct, devant toute pensée hérétique.
La figure centrale de 1984 est Winston Smith, un petit fonctionnaire du service des Archives du Ministère de la Vérité. Smith est un déviant. Né peu de temps avant la révolution, il souffre de déficience de la mémoire, c'est-à-dire qu'il est incapable de détruire en lui les souvenirs du passé réel : ces souvenirs fugaces particulièrement conscients du caractère mensonger de l'univers de Big Brother. Lorsqu'il assiste aux "Deux Minutes de la Haine" — une séance d'hystérie collective qui permet aux membres du Parti de décharger leur agressivité sur l'image du renégat Goldstein — il n'échappe pas à la tension nerveuse ambiante, mais sa haine se détourne insensiblement sur Big Brother.
Big Brother, objet d'un culte effréné de la personnalité, est, selon toute apparence, une fiction créée par le Parti intérieur, un symbole qui cristallise le besoin de soumission et d'amour de la masse.
La dissidence de Winston apparaît au grand jour lorsqu'il fait l'acquisition, dans une boutique d'antiquaire, d'un cahier de papier crémeux et lisse dans lequel il va tenter de tenir son journal. Il part à la recherche de fragments de passé non altéré, interroge les "prolos", loue enfin à l'antiquaire une chambre meublée à l'ancienne dans laquelle il vivra bientôt son histoire d'amour avec Julia.
Durant toute la première partie du roman (qui en compte trois), Winston est demeuré un homme seul. Le récit ne comprend pratiquement pas de structure narrative. Les activités de Winston sont le prétexte à une description de la société ambiante. La deuxième partie de 1984 est construite de manière radicalement différente autour de trois personnages. Winston fait la connaissance de Julia, une jeune femme membre de la "Ligue anti-sexe des juniors" qu'il prend pour une "bigote" politique. Julia révèle à Winston qu'elle l'aime et l'entraîne pour une première rencontre amoureuse dans un coin préservé de la campagne anglaise. L'acte sexuel est une révolte majeure contre le Parti qui cherche à abolir l'orgasme, à proscrire toute sexualité. Le puritanisme du Parti dissimule une motivation fondamentale : la privation sexuelle entraîne l'hystérie qui est désirable parce qu'on peut la transformer en haine guerrière et en dévotion pour les dirigeants.
Julia est la représentante d'une seconde génération d'adultes, les cadets de Winston, qui ont grandi entièrement dans le monde totalitaire. Elle est à la fois mieux adaptée à cet univers et mieux protégée contre son action. Elle tire une autonomie relative du simulacre, du respect superficiel des normes de comportement imposées par le Parti. Mais cette autonomie puisée dans le conformisme et l'inconscience annihile toute volonté de révolte.
La chute de Julia et de Winston, ce couple qui a réussi à constituer une cellule indépendante de l'univers totalitaire, est provoquée par le troisième personnage, O'Brien. O'Brien est un membre du Parti intérieur. Depuis plusieurs années, il exerce une fascination irrépressible sur Winston qui aime l'intelligence dont rayonne son visage. O'Brien leur révèle qu'il est, lui aussi, un hérétique. Au terme d'une séance d'initiation, il les admet dans la "Fraternité", l'organisation secrète qui lutte contre le Parti. Winston reçoit bientôt le livre d'Emmanuel Goldstein qui doit lui révéler le sens de la lutte à mener. Il entame sa lecture. Mais O'Brien n'est en réalité qu'un membre de la Police de la Pensée. Le monde clos, la chambre au mobilier ancien où les amants se retrouvaient, s'effondre, Julia et Winston sont arrêtés.
La troisième partie du roman se réduit en fait à un dialogue entre le bourreau et sa victime.
O'Brien soumet Winston à des tortures physiques et mentales dont le but est d'éliminer les "déficiences" de la mémoire. Le passé, affirme O'Brien, n'a pas d'existence réelle. Où existerait-il? Le Parti contrôle totalement la mémoire des hommes et les traces matérielles, il contrôle donc le Passé tout entier. L'Univers lui-même est une fiction que le Parti peut modeler ou abolir à sa convenance.
Au terme de la "cure", Winston capitule. Il apprend lentement à dire puis à croire en même temps que "deux et deux font cinq". Son intelligence est brisée, mais sa dignité d'homme reste entière, avec sa haine pour Big Brother et son amour pour Julia.
Enfin vient l'épreuve ultime. Chaque homme possède une faille secrète au-delà de laquelle il perd son identité. Dans la "salle 101", l'homme est placé face à la "pire chose qui soit au monde". C'est tantôt être enterré vif, tantôt être empalé ou noyé. Dans votre cas dit O'Brien, la pire chose qui soit au monde, ce sont les rats. Et la faille s'ouvre. L'homme se brise. Pour échapper au supplice, Winston comprend qu'il n'y a plus qu'une chose au monde qu'il puisse interposer entre lui et les rats. Il hurle frénétiquement «Faites-le à Julia! Pas à moi! Déchirez-lui le visage!…».
Parfois, la mort des protagonistes permet à un roman de s'achever sur une note d'espoir. Orwell nous a privés de cette issue. Il nous impose le spectacle de la dégradation d'un homme et d'une femme qui ont perdu l'essentiel, le respect d'eux-mêmes. Winston est devenu un gros homme aux yeux vides. Libéré, pourvu d'une sinécure, il passe l'essentiel de son temps à résoudre des problèmes d'échecs, assis à une table du café du Châtaignier. Brisé, englué par le gin, il lui manque encore le changement final qui le guérira. Et, dans un éclair, vient la victoire finale sur lui-même, comme une balle qui le frapperait dans la nuque. La lutte est terminée. IL AIME BIG BROTHER.
"In a sens a fantasy, but in the form of a naturalistic novel", une fiction écrite sur le mode du roman réaliste(8). En 1939, Orwell avait abandonné la fiction romanesque au profit de l'essai ou du réalisme documentaire. Le journalisme lui avait incontestablement acquis une audience plus large, mais il n'était pas parvenu, avant le succès de Animal Farm, à diffuser et à faire comprendre son message anti-totalitaire à l'homme de la rue, "l'ordinary man". Déjà, avant 1940, le nazisme avait failli subjuguer l'Europe entière sans que les idéologies démocratiques aient su sérieusement se faire entendre. Dans l'atmosphère de liberté qui règne dans la Grande-Bretagne de 1947, écrit-il, l'homme de la rue n'a pas de compréhension réelle, objective, de pratiques comme les camps de concentration, les arrestations arbitraires, la presse muselée ou les déplacements de population. Sa persistante ignorance ne tient donc pas à un manque d'information, mais à une incapacité des locuteurs à communiquer leur message(9).
En ce sens, 1984 procède directement d'une réflexion d'Orwell sur l'échec du réalisme. Le réalisme ne réside plus à ses yeux dans la vérité des situations mais dans la vérité des sensations. On s'est interrogé sur la force d'un reportage tel que The Road to Wigan Pier. L'analyse et la comparaison du texte avec celui des carnets contemporains d'Orwell montre que, dès cette époque, les passages les plus forts tiraient leur vigueur même non d'une minutieuse reconstitution des faits, mais de l'art même du romancier à restituer la force des sensations. 1984 est donc un cauchemar éveillé où le lecteur s'identifie à la victime d'une dictature totalitaire. Et ce transfert est d'autant plus profond que la plupart des éléments de la vie matérielle le renvoient à son propre quotidien. L'histoire des années trente, constate-t-il, a été dominée par le triomphe des émotions et des pulsions sur la raison, orgueil racial, culte barbare des chefs, religiosité délirante, passions guerrières effrénées(10). On ne peut lutter à armes égales contre de tels phénomènes en s'en tenant aux bonnes vieilles règles du discours rationaliste, en termes de "decency" ou de "sanity". Hitler était incontestablement un paranoïaque délirant, mais il a trouvé dès 1933 des milliers de responsables et des millions de citoyens «raisonnables» pour le suivre dans ses pires folies.
On reproche fréquemment à 1984 son désespoir, son pessimisme et le sentiment de défaite inéluctable qui étreint le lecteur. En réalité, cette réaction traduit une incompréhension profonde du message d'Orwell ou, si l'on veut, de sa théorie du totalitarisme. "Le premier but du totalitarisme est de perpétuer et d'institutionnaliser la révolution. Son caractère principal est d'instituer une dynamique de perpétuation du système; l'État totalitaire ne peut être réformé ; il ne peut qu'être détruit"(11). Animal Farm montrait comment une révolution dégénère en dictature. 1984 démontre qu'il existe un point de non-retour à partir duquel la résistance individuelle est totalement impuissante à renverser le régime totalitaire. "Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement"(12).
La force du roman tient incontestablement aussi à l'intensité du cauchemar psychologique dans lequel baignent les citoyens d'Oceania. Le plan du roman élaboré en 1943 fixe clairement les intentions originelles d'Orwell : "effet fantasmagorique, rectification, bouleversement des dates, doute (de Winston Smith) sur sa propre santé mentale" et après la chute et la torture "… reconnaissance de sa propre folie"(13). Le monde de la double-pensée met en scène une "société schizophrénique au service d'un groupe dirigeant paranoïaque qui sait ce qu'il fait"(14).
Roman construit avec la minutie d'un mécanisme d'horlogerie, 1984 se prête donc à une série de lectures et d'interprétations différentes. C'est ici, dans cette polyphonie de l'art romanesque, que gît l'écueil qui guette le critique : privilégier un procédé, une lecture au profit des autres. En ce sens, on ne peut mieux définir 1984 qu'en accentuant les "et" d'une longue suite de qualificatifs : roman réaliste ET roman d'anticipation, écriture fantastique ET naturalisme, lecture politique ET psychologique ET psychanalytique.
La force du message a peut-être également oblitéré la qualité de l'oeuvre littéraire. Dans le monde anglo-saxon, mais plus encore en France, la place d'Orwell serait aux yeux d'une minorité de critiques celle d'une politique aux médiocres qualités littéraires. "Le style d'Orwell, note Simon Leys, est à la littérature un peu ce que le dessin au trait est à la peinture : on en admire la rigueur, le naturel et la précision, mais on ne laisse pas d'éprouver parfois qu'il y manque une dimension (…) s'il n'avait dû compter que sur ses seules ressources littéraires pour affronter la postérité, on peut se demander si son oeuvre n'aurait pas fini sur le même rayon poussiéreux où nous oublions aujourd'hui les volumes de Maugham. Équipé pour faire une honorable carrière de probe et intelligent artisan des lettres, il est devenu en fait le prophète majeur de notre siècle; mais finalement, il doit cette situation exceptionnelle moins à son talent d'écrivain qu'au courage, à la vigueur, et à la lucidité avec lesquels il a su percevoir et dénoncer la menace sans précédent que le totalitarisme fait peser aujourd'hui sur l'humanité"(15). Simon Leys, malgré l'expérience personnelle qu'il a acquise dans sa lutte pour une démystification du maoïsme, passe à mon sens à côté des qualités majeures de 1984. Comme l'Archipel du Goulag, le roman d'Orwell a rencontré un écho immense, non parce qu'il révélait des faits ou des phénomènes ignorés(16), mais parce qu'il était parvenu à les communiquer.
"C'était une journée d'avril froide et claire. Les horloges sonnaient treize coups…" Dès la première page, 1984 s'affirme comme un roman de frontière, aux marges du réel (la lumineuse froideur de l'avril anglais) et de l'irrationnel (les horloges londoniennes sonnent treize coups…). Le temps — sa structure, son épaisseur — occupe ici, comme dans les autre romans d'Orwell, une place centrale(17).
La destruction ou l'irréalité du temps a une valeur double : elle souligne l'errance de l'individu, en marge de la folie, elle rappelle et renforce le thème majeur du livre, la mutabilité du Passé. Lorsque Winston Smith inscrit à la première page de son journal "4 avril 1984", il est pris d'un total sentiment d'impuissance. Est-ce bien l'année 1984? Il est sûr d'avoir trente-neuf ans…, mais est-il né en 1944 ou en 1945? Le temps romanesque ne redevient (immédiatement) tangible qu'après la rencontre de Julia. Le temps et l'espace redeviennent des alliés qui aident à se situer et à se souvenir. Le temps retrouvé devient le complice des amants. L'arrestation vient-elle, brutale, Winston se réveille, lève les yeux vers la pendule dont l'aiguille indique le chiffre neuf. Mais en cette claire journée d'août, aucun repère ne lui permet plus de dissocier le matin du crépuscule. Et, comme Arthur London le raconte dans L'Aveu, la privation du temps devient la torture la plus efficace que subisse Winston dans les caves du Ministère de l'Amour.
La défaite, inéluctable, de l'individu en lutte contre l'Univers totalitaire. "Ils" vous attrapent toujours. "Ils me fusilleront ça m'est égal ils me troueront la nuque cela m'est égal à bas Big Brother ils visent toujours la nuque…" (note du journal de W.S., chapitre I). "Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort" (journal de W.S., chapitre II). 1984 emprunte au roman policier sa logique romanesque : la conclusion (le meurtre ou ici la chute de Winston Smith et de Julia) est inscrite dans la première page même du livre. Comme dans tant de romans policiers anglais de l'entre-deux-guerres, l'histoire est rythmée par une de ses "nursery rhymes" dont raffolent les enfants anglais. Charrington, l'antiquaire-flic chez qui Winston a acheté son album-journal, lui donne la première et la dernière rimes d'une chanson : "Oranges et citrons, disent les cloches de Saint-Martin." En chantant, les enfants levaient les bras et terminaient ainsi : "Voici une bougie pour aller au lit et un couperet pour vous couper la tête"(18).
Obsédante comme la mort qui guette, la chanson incomplète hante Winston. Et lorsqu'il prend contact avec O'Brien, il n'a de cesse de lui demander le reste du texte. "Oranges et citrons, disent les cloches de Saint-Clément / Tu me dois trois farthings, disent les cloches de Saint-Martin / Quand me paieras-tu ? disent les cloches du Vieux-Bellay / Quand je serai riche, disent les cloches de Shoreditch."
Vous saviez la dernière ligne, dit Winston. Oui, je savais la dernière ligne, répond O'Brien. Et l'un et l'autre feignent d'oublier le dernier vers, la "chandelle et le couperet". La révolte de Winston est donc suicidaire : à l'instant même de son arrestation, Winston confie à Julia "Nous sommes des morts". Et une voix de fer, sortie de la muraille (où se dissimule un télécran) répète après eux "Vous êtes des morts". Et la voix ironique de Charrington ajoute "Et à propos pendant que nous en sommes à ce sujet, voici une chandelle pour aller vous coucher, voici un couperet pour vous couper la tête…"(19).
La mort de 1984 n'est pas l'anéantissement physique. Cesser de vivre, ce serait cesser de souffrir, une délivrance. Comme les accusés des Procès de Moscou, Winston appelle cette balle dans la nuque qui marquerait la fin : "Ils auraient fait éclater son cerveau en morceaux… La pensée hérétique serait impunie en lui (…). Mourir en les haïssant, c'était ça la liberté"(20). La mort de 1984 est bien pire : c'est la catatonie, la phase ultime de la schizophrénie, quand tout explose pour laisser la place à une seule chose, l'amour pour Big Brother.
Le temps. La mort. La folie.
"Winston avait l'impression d'errer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre"(21).
L'écrivain alité, l'homme rongé par la maladie laisse le rêve, l'inconscient guider l'écriture : grandes architectures bureaucratiques du Ministère de l'Amour et de la Vérité que l'on retrouve dans les carnets d'hôpital de Cranham (1949), sous le titre "Rêve de mort"; rêves où apparaît, obsédante, l'image de la mère et qui s'insèrent mal dans le canevas romanesque; rêves d'étreintes dans le "Pays Doré", là où les grands poissions dorment sous les saules(22).
1984 n'est pas seulement une tentative rationnelle d'imaginer un futur possible. Un univers distordu, irréel peut se charger "d'une extraordinaire profondeur d'imagination et d'une énergie oppressante"(23). La peur telle qu'elle s'exprime dans le roman renvoie directement aux terreurs de l'enfance. Le citoyen d'Oceania est maintenu dans un état régressif de dépendance infantile du parti et de son chef.
La composante sado-masochiste qui règle les rapports entre Winston et O'Brien est évidente. Le personnage compose un mélange subtil du maître de collège, de l'inquisiteur espagnol et du psychiatre.
Orwell entretient volontairement cette confusion permanente en variant tous les registres de la dialectique du maître et de l'élève. Ici, le personnel en blouse blanche, les injections chimiques, les électrochocs. "Vous êtes dérangé mentalement. Vous souffrez d'un défaut de mémoire"(24). Là, le maître d'école, qui montre cinq doigts à l'enfant et lui demande combien font deux et deux. "Votre réintégration comporte trois stades. Étudier. Comprendre. Accepter"(25). Et enfin, la torture barbare, les matraques, les coups de botte, la lumière perpétuellement allumée dans le cachot. Les rats. L'inquisiteur. En jouant délibérément sur toute la gamme de nos terreurs infantiles, Orwell trouve ce chemin qui mène à un niveau plus profond de notre conscience.
"Personne ne peut se dire ni être partisan de Big Brother" note naïvement Norbert Bensaïd, en qualifiant 1984 de "cri de douleur"(26). Personne, faudrait-il corriger, ne peut aimer ou s'identifier aux bourreaux de 1984, parce que l'habileté d'Orwell a fait de chaque lecteur un Winston en puissance. Beaucoup de critiques ont été choqués (ou trompés) par le sadisme qu'exsude plus d'une scène de 1984. Le recours à un réalisme morbide, à un attirail gothique qui rappelle l'atmosphère des "Dime Novels" ou des aventures de Harry Dickson(27) ressort directement de l'utilisation de "topoi" de la littérature populaire. 1984 est une sorte d'antithèse du célèbre roman noir de James Hadley Chase, Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Le monde de gangsters imaginé par Chase, note Orwell en 1944, est une "version distillée de la scène politique moderne, dans laquelle des choses comme les bombardements massifs de civils, les prises d'otages, la torture… sont normaux et moralement neutres, admirables même lorsqu'ils sont faits sur une plus vaste échelle (…). L'homme de la rue ne s'intéresse pas spontanément à la politique; lorsqu'il lit, il souhaite que les conflits quotidiens qui emplissent le monde soient traduits par une histoire simple qui mette en scène des individus. (…) Pas d'orchidée (…) est une rêverie pour l'âge totalitaire"(28). Puisque Freud et Machiavel ont envahi les "Pulp magazines", Orwell luttera avec les armes de l'adversaire. Durant les "Deux minutes de la Haine", Winston focalise toute son agressivité sur Julia qui n'est encore pour lui qu'une fille "jeune, jolie et asexuée", ceinte du ruban rouge de la ligue anti-sexe : "De vivaces et splendides hallucinations lui traversèrent rapidement l'esprit. Il la fouettait à mort avec une trique de caoutchouc. Il l'attachait nue à un poteau et la criblait de flèches comme un saint Sébastien. Il la violait et au moment de la jouissance lui coupait la gorge"(29). Si le style et la cruauté des images évoquent directement la violence sadique à laquelle d'autres auteurs, depuis Chase, nous ont habitués, Orwell parvient à placer son lecteur dans la position de la victime. Le procédé semble lui avoir été suggéré par la lecture de Darkness at Noon (Le Zéro et l'Infini) à propos duquel il note : "Pour comprendre des choses (comme les horreurs nazies), il faut être capable de s'imaginer soi-même comme une victime"(30).
Une lecture parallèle du Zéro et l'Infini et de 1984 révèlerait sans doute les liens profonds qui unissent les deux livres. La fin du roman d'Orwell (la torture et la confession) utilise délibérément des images et des situations empruntées à l'oeuvre de Koestler : le long couloir qui mène à la mort, la balle dans la nuque.
"Un coup sourd l'atteignit derrière la tête (…) des souvenirs le traversèrent comme des traînées de brume sur les eaux (…) ce chromo accroché au-dessus de son lit et le regardant, de qui était-ce le portrait? Était-ce le n° 1 ou l'autre — l'homme au sourire ironique ou l'homme au regard vitreux? (…) Un second coup de massue l'atteignit derrière l'oreille. Puis tout fut calme…"(31). La mort, l'anéantissement psychique guette Winston, à la dernière page de 1984 : "Il longeait le couloir carrelé de blanc, avec l'impression de marcher au soleil, un garde armé derrière lui. La balle longtemps attendue lui entrait dans la nuque. Il regarda l'énorme face. Il lui avait fallu quarante ans pour savoir quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire…"(32).
Orwell donne-t-il une réponse différente au problème central du Zéro et l'Infini? Au fond, les deux livres sont marqués par leur époque. Koestler, en 1940, s'interroge sur la capitulation de Roubachof, sur les confessions extorquées aux accusés des Procès de Moscou. Pourquoi les vieux bolcheviques avouent-ils, alors que le seul crime est de ne pas aimer le régime stalinien? Pourquoi ces révolutionnaires endurcis cèdent-ils à la pression physique et morale que leur font subir leurs tortionnaires?
La réponse de Koestler est empreinte d'une certaine ambiguïté. Les révolutionnaires russes ont choisi d'être des hommes sans morale. Roubachof se confesse tout simplement parce qu'il ne trouve plus en lui-même de raison de ne pas le faire. La justice, la vérité objective ont cessé d'exister pour lui depuis longtemps. Pour le parti, il a triché, menti, livré même à la Gestapo un compagnon de lutte suspect de "divergences politiques". En somme, il finit par ressentir une certaine fierté pour son acte d'obéissance. L'individu meurt mais l'Histoire est en marche. Le Livre de Koestler débouche sur une impasse que symbolise l'alternative de l'omelette et des oeufs à casser.
Comme Roubachof (mais à un niveau bien moindre), Winston Smith est membre du Parti. Mais le Parti s'est dépouillé de ses oripeaux humanitaires. La barbe de Karl Marx se couvre de poussière au fond d'un placard. L'apparatchik glacial a remplacé le commissaire du peuple. Sur la devise de la révolution, il reste un mot : le pouvoir. Lorsque Julia et Winston évoquent l'arrestation inéluctable, tous deux dépassent l'alternative de Roubachof. "Se confesser n'est pas trahir. Ce que l'on dit ou fait ne compte pas. Seuls les sentiments comptent. S'ils peuvent m'amener à cesser de t'aimer, là sera la vraie trahison"(33). Dans la prison où Roubachof est incarcéré, les détenus communiquent en tapant des lettres en morse. "Je capitule", frappe Roubachof. "Ne vous reste-t-il pas une étincelle d'honneur ?", lui demande son voisin de cellule, un officier tsariste. Qu'est-ce que l'honneur? La dignité répond l'officier. Nous avons remplacé la dignité par la Raison, réplique Roubachof. Et le mur se tait(34). La défaite de Wisnton est au-delà de la Raison, dans la dignité restaurée de l'homme.
On ne saurait, sans trahir l'exigence honnête qui est au centre de la pensée d'Orwell, terminer cette lecture de 1984 sans souligner les défauts parfois graves du roman. Orwell a mené une course toujours inégale contre la maladie. Ainsi toute la troisième partie de 1984, qui décrit la destruction de Winston Smith, a été rédigée dans la précipitation. Ceci explique bien des lourdeurs, des maladresses de style, le ton même de ces derniers chapitres. Par contre, le manque de temps ne peut suffire à expliquer une inconséquence majeure de l'intrigue : la peinture d'une classe ouvrière passive, abrutie, démoralisée qui compose la majorité de la population d'Oceania. Comme le souligne Tosco Fyvel, cette image de l'ouvrier analphabète, abruti par l'alcool était déjà totalement anachronique dans l'Angleterre de 1948. Orwell reproduisait une image de la classe ouvrière qui appartenait plutôt à sa propre enfance et laissait entier le dilemme majeur du "progressisme". L'espoir était-il dans les pauvres? S'il y a un espoir, écrit Winston, il réside chez les prolétaires.
Cet étrange messianisme étonne, dans un livre conçu comme l'anti-utopie par excellence. Peut-être dénotait-il simplement chez Orwell l'absence de réponse univoque à la question du progrès et de l'avenir du monde. Comme l'écrit encore Winston, "Ils (les prolétaires) ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés"(36).
RÉFÉRENCES
1. Paul Johnson, dans The Spectator, 7 janvier 1984. [Retour]
2. Irving Kristol, dans The Wall Street Journal, 19 décembre 1983.[Retour]
3. Magnès SPERBER, dans L'Express, 28 octobre 1983, p. 90. [Retour]
4. Georges KIEJMAN, Ibidem, p. 92-3. [Retour]
5. Mario VARGAS LLOSA, Ibidem, p. 91. [Retour]
6. J'ai préféré la fiction d'un entretien imaginaire au procédé plus scientifique qui eût consisté à citer puis à analyser les déclarations de George Orwell à propos de 1984. Elles figurent pour l'essentiel dans sa correspondance. Les textes respectent au plus près l'esprit ce ces déclarations mais ils en adaptent la lettre ou le strict déroulement chronologique. Les sources originales figurent dans les CEJL, t. IV. Il s'agit principalement de lettres de George Orwell : à son éditeur Fred Warburg (31 mai 1947), CEJL IV, p. 329-30 ; à George Woodcock (9 août 1947), CEJL IV, p. 366 ; à Robert Selhouse (22 octobre 1947), CEJL IV, p. 381 ; à T.R. Fyvel (31 décembre 1947), CEJL IV, p. 386 ; à Richard Rees (4 février 1948), CEJL IV, p. 404 ; à Fred Warburg (22 octobre 1948), CEJL IV, p. 448 ; à Anthony Powell (15 novembre 1948), CEJL IV, p. 460 ; à Julian Symons (4 février 1949), CEJL IV, p. 475 ; à Robert Giroux (17 mars 1949), CEJL IV, p. 483 ; à Francis Henson (16 juin 1949), CEJL IV, p. 502 ; ainsi que du communiqué de presse diffusé par Fred Warburg en réponse à l'interprétation fallacieuse du roman comme une attaque contre le Labour Party (B. Crick, George Orwell. Une vie, p. 484.). [Retour]
7. L'expression est de Richard MARIENSTRASE, "Vers le trou de mémoire", Le Genre Humain, 9, p. 67. [Retour]
8. CRJL IV, p. 330. [Retour]
9. Préface à Animal Farm, CEJL III, p.406-6, et IV, p. 37-40. [Retour]
10. "Wells, Hitler and the World State", (1941), CEJL II, p. 139-45. [Retour]
11. Sigmund NEUMANN, Permanent revolution, New York, 1942. [Retour]
12. George ORWELL, 1984, Gallimard, "Folio", p. 377. Toutes les citations de 1984 se réfèrent à cette édition. [Retour]
13. Bernard CRICK, George Orwell. A Life, annexe, p. 583-4. [Retour]
14. François BRUNE, "1984" ou le règne de l'ambivalence, p. 53. [Retour]
15. Simon LEYS, Orwell ou l'horreur de la politique, p. 53-4. [Retour]
16. Les témoignages sur les camps nazis ou le goulag, comme les premiers exposés de la théorie du totalitarisme étaient publiés et largement diffusés bien avant que ces phénomènes aient été effectivement ressentis par l'opinion. [Retour]
17. Comme le note Tosco FYVELL (George Orwell. A Personal Memoir, p. 183-4) chacun des romans d'Orwell commence sur une notation de temps : "As the alarm bell on the chest of drawers exploded like a horrid little bomb of bell metal, Dorothy, wrenched from the depths of some complex, troubling dream…" (A Clergyman's Daughter). "It was only half past eight, but the month was April and there was a closeness in the air" (Burmese Days). "The clock stuck half past two. In the little office… Gordon…, last member of the Comstock family and, as we know, twenty-nine and rather moth-eaten already…" (Keep the Aspidistra Flying). "The idea really came to me the day I got my new false teeth" (Coming Up For Air). [Retour]
18. On retrouve cette "nursery rhymes" dans le fameux roman policier de Fredric BROWN, Here Comes a Candle publié en 1950 aux États-Unis, qui décrit lui aussi le lent suicide d'un homme rejeté par la société ambiante. [Retour]
19. George ORWELL, 1984, p. 315. [Retour]
20. Ibidem, p. 395. [Retour]
21. Ibidem, p. 43. [Retour]
22. Le pays doré est au centre de Coming Up For Air. [Retour]
23. Alex ZWERDLING, George Orwell and the Left, New Haven, Yale University Press, 1974, p. 201. [Retour]
24. 1984, p. 348. [Retour]
25. 1984, p. 368. [Retour]
26. Norbert Bensaïd, "L'avenir est-il ce qu'il était ?", Le Genre Humain, 9, 1983, p. 238. [Retour]
27. La scène de l'arrestation dans la chambre close est tout à fait typique de cette utilisation de clichés de la mystery novel du début du XXe siècle. On songe aux nouvelles fantastiques de Conan Doyle. [Retour]
28. "Raffles and Miss Blandish", Horizon, octobre 1944, CEJL III, p. 212-24. [Retour]
29. 1984, p. 29. [Retour]
30. "Arthur Koestler", écrit en septembre 1944, CEJL III, p. 234-244. [Retour]
31. Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, traduit par Jérôme Jenatton, Paris, Le Livre de Poche, 1975, p. 318. [Retour]
32. 1984, p. 416. [Retour]
33. 1984, p. 237. [Retour]
34. Dialogue reconstitué d'après celui du Zéro et l'Infini, p. 211-2. [Retour]
35. Tosco FYVEL, George Orwell. A Personal Memoir, p. 198. 1984, p. 312. [Retour]
36. 1984, p. 105. [Retour]
Texte tiré et révisé de l'ouvrage L'Âme de cristal, George Orwell au présent, Éd. de l'Université de Bruxelles, 1985 (épuisé).
Copyright © Jean-Pierre Devroey, 2004.
|