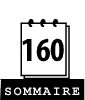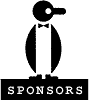|







|
|
POÉTIQUE DU JOURNAL ET THÉORIE CRITIQUE DE L'INFORMATION CHEZ MALLARMÉ
«Obscurité provocante des proses autant que des Poésies, disjonction radicale entre usage littéraire et usage référentiel du langage, attribution au poète — dont «le cas» est celui «d'un homme qui s'isole pour sculpter son propre tombeau[1]» — d'une temporalité sans commune mesure avec le présent immédiat de l'actualité : l'œuvre et la pensée de Mallarmé semblent bien installées dans une position d'extériorité absolue au monde de la presse et au texte journalistique. Tout suggère en effet que l'écart qui s'est progressivement accentué au cours du XIXe siècle entre haute poésie et grande presse atteint avec lui sa largeur maximale. Le temps n'est plus même au mépris dont un Baudelaire couvrait les journaux, mais à une indifférence policée, reflet d'une expérience du langage qui se vit comme exception au régime de «l'universel reportage[2]». Qu'elle puisse s'autoriser de plusieurs prises de position explicites du poète allant dans ce sens n'empêche pas que cette vision des rapports de l'esthétique de Mallarmé aux formes du discours journalistique relève largement d'une construction savante rétrospective, fondée sur une connaissance parcellaire de l'œuvre et de la trajectoire de son auteur au sein de l'espace culturel des années 1860-1890. Car non seulement Mallarmé a pratiqué un certain type de journalisme et n'a pas dédaigné de se prêter aux nombreuses enquêtes conduites auprès des écrivains et des intellectuels par la presse à la fin du siècle, mais il y a chez lui un effort de théorisation critique du journalisme et de l'information dont on ne voit pas d'équivalent chez d'autres écrivains de l'époque. Si ses Poésies n'en gardent pratiquement aucune trace — hormis dans le «Billet» adressé à Whistler, où «la rue / Sujette au noir vol de chapeaux[3]» peut être lue comme une double métonymie du médium journalistique —, ses écrits théoriques postérieurs à 1880 sont hantés d'un bout à l'autre par la question du journal, qui est celle des risques que celui-ci fait encourir au livre et à la littérature, mais aussi des ressources encore inexploitées qu'il leur présente. «Un livre comme je ne les aime pas, ceux épars et privés d'architecture», écrira-t-il en 1897 au seuil du recueil de ses Divagations : «Nul n'échappe décidément au journalisme ou voudrait-il en produit pour soi[4].» Façon agacée, ironique, d'acter le pouvoir d'emprise que la grande presse d'information, à la fin du siècle, tend à exercer jusque sur les pratiques discursives les plus délibérément éloignées de sa sphère de rayonnement. Façon aussi de souligner que l'écrivain, qu'il le veuille ou non, doit compter avec le journal, sinon en tirer profit.
Pratique du journalisme

C'est par la porte de service de correspondances assurées à Londres pour divers journaux que Mallarmé fait une brève entrée en journalisme au début des années 1870. Sa décennie précédente a été celle d'un parnassien radical exilé en province et assigné à un «creusement» du vers dont l'expérience asphyxiante devait le plonger, vers 1867, dans une profonde dépression. Hérodiade, L'Après-midi d'un faune, le conte métaphysique Igitur resteront comme les minutes de sa descente en apnée au cœur du langage et de sa difficile remontée vers une conscience apaisée des ressorts verbaux mais aussi sociaux de l'expression poétique. La conversion est saisissante qui le voit, dès que muté à Paris, quitter les régions exclusives de l'esthétique pure pour un terrain d'intervention qui conjoindra journalisme et littérature. Ainsi, le provincial survolté qui en 1862, dans son libelle contre «L'Art pour tous», déplorait que «Les Fleurs du mal [soient] imprimées avec des caractères dont l'épanouissement fleurit à chaque aurore les plates-bandes d'une tirade utilitaire[5]» s'empresse, moins de dix ans plus tard, de démarcher plusieurs journaux en vue de couvrir l'Annexe française de l'Exposition internationale de Londres. C'est qu'il faut bien vivre et saisir l'occasion d'un séjour gratis outre-Manche pour nouer des contacts avec tels poètes anglais et tels éditeurs. Mais c'est aussi que le compte rendu d'exposition représente pour beaucoup d'écrivains des années 1850-1880 — comme d'un autre côté le compte rendu du Salon officiel de Paris — une sorte d'exercice obligé, un rite de passage dans les deux mondes de la modernité culturelle et du journalisme occasionnel. Et c'est avec le plus grand zèle qu'il remplira sa tâche en rédigeant trois lettres ouvertes adressées au directeur du National en 1871, suivies un an plus tard d'un article plus substantiel pour le compte de L'Illustration. Ces articles montrent un rédacteur soucieux de remplir au mieux le contrat qui lui a été confié. Il distribue des médailles aux exposants, applaudit à la «fusion de l'art et de l'industrie[6]», salue la perte de sens que connaît «le mot d'authentique» sous l'impulsion des arts décoratifs[7], ajuste son propos et son style aux cadres prescrits par le genre du compte rendu célébratif autant que par la ligne des journaux qui rémunèrent sa prose. L'article pour L'Illustration montre, sans doute, qu'il sait prendre de la hauteur et considérer d'un regard synthétique le «mouvement» par lequel «le Grand Art est banni de nos appartements intimes par la vertu irrésistible de la seule Décoration[8]», mais c'est là encore un tribut symbolique payé à la ligne d'un journal qui cible une bonne bourgeoisie en quête de consécration culturelle. Ces textes de commande participent certes d'un engouement d'époque pour les arts décoratifs et du questionnement qu'ils soulèvent touchant non seulement à la valeur mais à l'essence des œuvres à l'âge industriel; ils témoignent surtout, en ce qui le concerne, d'une étonnante capacité à jouer des codes qui réglementent un discours journalistique très contraint. S'il ne l'éloigne guère de son terrain esthétique d'appartenance, ce journalisme-là représente en ce sens, pour Mallarmé, l'expérience d'une première déterritorialisation féconde. L'adoption provisoire de codes extérieurs à sa pratique de poète pourrait en effet l'avoir mis en condition, avec d'autres facteurs, de développer un rapport réflexif aux codes profondément intériorisés qui gouvernent la démarche poétique.
L'auteur d'Hérodiade semble en tout cas s'être assez pris au jeu pour envisager, au retour de ses deux missions londoniennes, de lancer à Paris une revue sur les arts décoratifs. Ce projet, demeuré sans suite, préfigure les huit livraisons du journal de mode que Mallarmé dirigera de septembre à décembre 1874 et dont il caressera longtemps le souvenir, comme d'une brève saison au paradis des apparences : «j'ai après quelques articles colportés d'ici et de là, confiera-t-il à Verlaine dix ans plus tard, tenté de rédiger tout seul, toilettes, bijou [sic]; mobilier, et jusqu'aux théâtres et aux menus de dîner, un journal,
La Dernière Mode
, dont les huit ou dix numéros parus servent encore quand je les dévêts de leur poussière à me faire longtemps rêver[9].» La critique mallarméenne a fait assaut des caractérisations les plus diverses au sujet de
La Dernière Mode
: poème en prose, «divagation» avant la lettre, évasion faunesque, portion exotérique du «Livre» absolu, voire faux journal tenant de la supercherie littéraire. Ces dénégations ne font pas le poids au regard d'un objet qui par son contenu comme par sa structure représente bien un journal de mode — avec son format, ses rubriques, ses gravures, ses patrons, ses annonces publicitaires sous forme de cartes de visite des bonnes maisons — et dont le style comme la matière rédactionnelle empruntent largement au fonds commun des publications concurrentes[10], selon une habitude assez banale dans la presse du temps et finalement très conforme au principe directeur du discours de mode, voulant que les valeurs «à la mode» s'imposent et se prouvent par une circulation circulaire de l'information. Mallarmé y prend une manifeste volupté à multiplier les pseudonymes, la plupart féminins, à décrire par le détail toilettes et usages élégants, à tenir aussi la chronique des livres, des spectacles et des plages.
Cette volupté se voit mieux encore dans l'adoption d'une rhétorique qui, souvent très injonctive — car la mode tient d'une prescription à la fois esthétique et sociale —, est également une érotique du discours, faite de connivence avec les lectrices et de jouissance aux étoffes, aux parures, aux bijoux, à tout ce qui, touchant au corps, permet de le dire à mots couverts. Encore devrait-t-elle moins frapper, au fond, que la maîtrise dont le poète fait preuve dans le maniement du lexique de la confection et du vêtement, l'intériorisation active du point de vue de la Mode et l'orchestration générale d'une «Gazette» qui, se voulant «du monde et de la famille», articule, avec la grave légèreté nécessaire, conseils sur l'éducation et chronique de la vie parisienne, correspondance avec les abonnées et critique des nouveautés littéraires, recettes de cuisine et descriptions de toilettes. Et tout cela sur le fond d'un métadiscours veillant à rappeler la ligne du journal, soulignant les services que celui-ci rend à ses lectrices et faisant valoir l'unité d'un propos qui, quel que soit son objet, a pour enjeu de leur présenter un modèle réduit du monde auquel elles appartiennent. La rédaction sous plusieurs pseudonymes est ainsi fortement recoupée par l'enjeu constitutif du discours de mode : adoption d'un côté, sur divers objets, de codes et de formes d'énonciation spécifiques, en une sorte de jeu de rôles et de polyphonie journalistique où le poète se montre plus virtuose que dans ses comptes rendus d'exposition; participation, de l'autre, à une logique d'inculcation sociale des conduites et des apparences tout ensemble distinctives et conformes.
La Dernière Mode
ne sera pas sans conséquence sur le répertoire des Poésies de la maturité et leur rhétorique fétichiste : un petit monde fait d'objets décoratifs, de pièces de mobilier et de parures disant tantôt l'absence du sujet, tantôt la ferveur érotique qui l'anime. Le rôle de ce journal n'aura pas été moindre, sans doute, dans l'incorporation pratique du «sens des formalités» à travers lequel le poète appréhendera les formes esthétiques et les rites de la vie culturelle[11].
L'expérience journalistique de Mallarmé — en attendant ses interventions souvent ironiques dans la presse lorsque la célébrité sera venue — se clôt en 1875-1876 avec la série de billets anonymes qu'il rédige sur l'actualité culturelle parisienne pour la revue londonienne L'Athaeneum. A défaut d'une chronique espérée au Gaulois sur les poètes anglais, c'est, selon ses mots, à une « une sorte de reportage littéraire au futur[12]» qu'il se livre dans cette trentaine de «gossips» littéraires, dramatiques ou artistiques, qui sont autant d'occasions de faire valoir non seulement les œuvres et les noms qui lui paraissent porteurs d'avenir — Manet, Zola, Cladel, Banville, sans s'oublier lui-même —, mais aussi l'insertion forte dont il se prévaut dans le milieu des ateliers, des éditeurs et des galeries. Au lendemain du refus du Faune par le comité de lecture du troisième Parnasse contemporain, qui l'a mis en marge du mouvement dominant la poésie française, le poète semble bien avoir à l'esprit l'installation d'un réseau international alternatif, et en prenant la défense d'un Manet ou d'un Zola, contre les attentes de la revue assez conservatrice qui le publie, c'est un peu de la sienne aussi qu'il s'occupe avec un grand sens stratégique. La publication en septembre 1876, dans The Art Monthly Review, d'une grande étude en traduction anglaise sur «Les impressionnistes et Édouard Manet» couronnera cette période intermédiaire de sa carrière en proposant une ambitieuse interprétation esthétique et politique d'un mouvement ayant préfiguré en peinture l'esprit de liberté formelle dont le symbolisme sera porteur après 1880. Pour l'heure, il ne fait guère de doute que dans «l'intrus résolu[13]» que les tenants de l'académisme ont vu en Manet, Mallarmé projette beaucoup de sa position au sein de son propre champ et de l'ambition qui l'anime sous les deux rapports de l'invention poétique et de la théorisation des grands changements de paradigme esthétique.
Théorie esthétique de l'information

L'accession du poète à la célébrité autour de 1885 — grâce aux Poètes maudits de Verlaine et au roman A rebours de Huysmans — fait passer sur un autre plan son rapport au journalisme. Alors que l'école parnassienne s'essouffle, raidie dans ses dogmes, et que la presse française entre en revanche dans son «âge d'or», c'est à une théorie fondamentale du discours poétique que Mallarmé s'emploie pour révoquer d'un même geste le formalisme académique des disciples de Leconte de Lisle et l'utilitarisme référentiel de la grande presse. «Narrer, enseigner, décrire, cela va», écrit-il en préface au Traité du Verbe de René Ghil, avant d'y condamner «l'emploi élémentaire du discours [qui] dessert l'universel reportage dont, la Littérature exceptée, participe tout, entre les genres d'écrits contemporains[14]». Tout est là résumé non seulement d'une vision de la littérature comme exception aux deux règles sociales du langage instrumental et du devoir de contemporanéité, mais aussi d'une conception de la presse qui en fait le vecteur d'imposition d'un régime discursif fondé sur la surchauffe informationnelle et la superstition d'un présent perpétuel. Car, d'un côté, «cela va» en effet : l'inflation du texte de presse au début de
la Troisième République
est si grande qu'il semble à lui seul faire basculer la culture tout entière du régime de la qualité dans celui de la quantité. «Déversoir», «chaos», «tourbillon» : Mallarmé n'est pas avare de mots pour donner la mesure de cette saturation générale dont l'équivalent, à même la surface du journal, est «l'insupportable colonne qu'on s'y contente de distribuer, en dimensions de page, cent et cent fois», conjuguée à l'effet d'épaisse «maculature» que «la feuille étalée» emprunte à la technologie de l'impression et dont il ne fait «nul doute que l'éclatant et vulgaire avantage soit, au vu de tous, la multiplication de l'exemplaire et, gise dans le tirage[15]». Et tout cela mis au service, d'un autre côté, d'un rapport au monde et au temps aussi vain qu'illusoire. Dans la routine journalistique, la roue des événements tourne à vide : chacun chassant l'autre, lâché dès que saisi et nommé au travers d'un langage mercenaire qui se dissout avec l'objet qu'il désigne, là où le vocable poétique demeure en adhésion à la «notion» qu'il fait émerger, force restant une forme ineffaçable au regard de la chose qu'elle efface. L'objet de la presse, en ce sens, n'est pas même tels événements successifs d'une chaîne sans fin, mais cette chaîne elle-même, c'est-à-dire la vide événementialité dont elle est l'exposant social : «Unique fois au monde, parce qu'en raison d'un événement toujours que j'expliquerai, il n'est pas de Présent, non — un présent n'existe pas.. Faute que se déclare la Foule, faute — de tout. Mal informé celui qui se crierait son propre contemporain, désertant, usurpant, avec impudence égale, quand du passé cessa et que tarde un futur ou que les deux se remmêlent perplexement en vue de masquer l'écart. Hors des premier-Paris chargés de divulguer une foi en le quotidien néant et inexperts si le fléau mesure sa période à un fragment, important ou pas, de siècle[16].» Comprenons entre autres que l'actualité est un simulacre historique sécrété par la grande presse d'information, réclamant de ses lecteurs un acte de foi dans une contemporanéité pensée comme participation à un temps homogène; Gabriel Tarde, d'un autre point de vue certes, ne dira pas autre chose : l'actualité ne sera-t-elle pas, selon lui, la «sensation» de communauté virtuelle et de rationalité commune que la presse procure à ses lecteurs en leur faisant prendre connaissance au même moment des mêmes nouvelles, quand bien même celles-ci porteraient-elles sur des faits du passé[17]? Le présent des médias, injonction faite au sujet d'être en symbiose avec son temps, n'existe donc pas comme «Présent», c'est-à-dire comme présence de l'Être dont la «Littérature» seule serait garante dans les opérations poétiques qui la constitue; sans passé comme sans futur, leur présent n'est qu'un trou béant, une déchirure dans le tissu du Temps, l'écart masqué entre deux états qu'elle empêche de se raccommoder l'un à l'autre, alors que le propre de l'«Aujourd'hui» serait à l'inverse, non «[d'être] seulement le remplaçant d'hier, présageant demain, mais [de sortir] du temps, comme général, avec son intégrité lavée et neuve[18]». Fiction, en somme, que la contemporanéité médiatique, mais fiction trompeuse, en ce qu'elle se présente sous les espèces d'une présence immédiate au réel cependant que la «Fiction» des «Lettres», en se donnant pour essor vers le vide, joue en quelque sorte cartes sur table. L'information comme mythe collectif des journalistes : l'idée n'est pas moins forte que l'observation faite encore par Mallarmé, à propos des contes de Maupassant, d'un renversement, dans la presse fin de siècle, du rapport entre fiction et actualité, au fil d'une équivalence métaphorique établie entre le journal comme produit commercial et les magasins occupant le rez-de-chaussée des grands immeubles urbains : «Voilà comment, chez nous seuls, la Presse, limitons cette désignation, ainsi que de coutume, au journalisme, a, naguères, voulu une place aux écrits. Le traditionnel feuilleton en rez-de-chaussée longtemps soutint la masse du format entier : ainsi qu'aux avenues, sur le fragile magasin éblouissant, glaces à scintillation de bijoux ou par la nuance de tissus baignée, sûrement pose un lourd immeuble à étages nombreux. Mieux, à présent la fiction proprement dite ou le récit, imaginatif, s'ébat au travers de "quotidiens" achalandés, triomphant à des lieux principaux, jusqu'au faîte; en déloge l'article de fonds, ou d'actualité, apparu secondaire[19].» Ceci tient d'un vœux pieux bien sûr : car, à la fin du siècle, c'est l'article d'actualité qui, loin d'être devenu secondaire, tend à déloger du journal les écrits littéraires en colonisant tout l'édifice des colonnes; et bientôt le «grand reportage» y prendra le relais du roman-feuilleton. Perception assez juste néanmoins, ironie comprise, que cette actualité tient elle-même en effet d'une fiction collectivement construite au sein du champ journalistique.
Poisseux, maculé d'encre, omniprésent, trivial, quadrillant l'univers et les esprits, c'est bien ce journalisme-là qui se dessine à l'horizon de l'esthétique évanescente que Mallarmé propose en modèle à la génération symboliste. Au matérialisme des reporters comme à la gravité infatuée des chroniqueurs politiques, elle oppose les arabesques d'un idéalisme absolu; à leur langage instrumental tendu vers tout un monde à dire, un langage réflexif portant sur des sujets apparemment minimaux; à leur obsession du fait divers et des nouvelles grossies, les «Grands faits divers» qui composeront la dernière section du recueil des Divagations; et à leur hégémonisme grandissant sur l'économie de l'imprimé, gros d'intrusion jusque dans les écrits qui ne relèvent pas de leur sphère, l'obscurité à la fois défensive et insolente d'une écriture jalouse de sa propre autonomie. Quitte à voir, dans cette presse envahissante, la chance offerte à la poésie de s'alléger, en s'y déchargeant, du poids de réalité et du devoir de référence socialement impartis à la langue commune («Un journal reste le point de départ; la littérature s'y décharge à souhait[20]»). Il y a bien pourtant, chez Mallarmé, une esthétique du journal et, sous ce rapport, il est significatif qu'elle se formule principalement dans les textes qu'il réserve au projet du «Livre». Le commerce de la librairie s'y trouve soumis à une critique non moins radicale que l'économie symbolique de la grande presse : elle aussi marche à l'inflation de «produit[s] agréé[s] courant[s][21]», tels que le roman, et «le discrédit où [elle] se place», en temps de «krach» de l'édition, «a trait, moins à un arrêt de ses opérations […] qu'à sa notoire impuissance envers l'œuvre exceptionnelle[22]». Dans ces conditions, « que manque-t-il, avec l'exploit, au journal, pour effacer le livre […] : rien, ou presque — si le livre tarde tel qu'il est, un déversoir, indifférent, où se vide l'autre[23]»? Du journal au livre ordinaire une ligne de continuité se dessine — d'autant plus visible que se multiplient, à l'époque, les livres de journalistes — et leur opposition n'a de sens, estime Mallarmé, qu'à être dialectisée en direction d'un «Livre» qui, les dépassant l'un et l'autre, en exploiterait les ressources insoupçonnées. Du livre tel qu'il tarde, ce «Livre» retiendrait l'effet de volume, de «tassement, en épaisseur», de pliage, «indice, quasi religieux[24]»; et, du journal tel qu'il s'en imprime trop, sa mobilité spacieuse, son grand format, son orchestration en mosaïque, étouffée d'ordinaire par la compacité de ses colonnes et à quoi un emploi judicieux des blancs, aérant la page, permettrait de se donner libre cours, au profit d'un livre qui serait «expansion totale de la lettre[25]», espace offert à un «jet de grandeur, de pensée ou d'émoi, considérable, phrase poursuivie, en gros caractère, une ligne par page à emplacement gradué», avec, «autour, menus, des groupes, secondairement d'après leur importance, explicatifs ou dérivés — un semis de fioritures[26]». Grande annonce est ainsi faite à la littérature d'un «Livre» non seulement propice à «l'œuvre exceptionnelle», prolongement matériel, typographique des opérations verbales dont celle-ci est le produit, mais également capable d'installer, entre «Littérature» et «universel reportage», une frontière infranchissable. Frontière paradoxale, pour le moins, puisqu'elle serait le fait d'une hybridation du livre et du journal, les renvoyant tous deux à la banalité de leur forme standard.
Ce «Livre», on le sait, n'aura pas eu lieu, autrement que comme prospectus et ensemble de notes, schémas, calculs ayant échappé à l'autodafé demandé par le poète entre les deux spasmes d'étouffement dont le second aura raison de lui en septembre 1898. Un an plus tôt,
la revue Cosmopolis
, en publiant le premier état du poème Un Coup de Dés jamais n'abolira le Hasard, avait montré ce que le poète avait à l'esprit lorsqu'il imaginait, au-delà du conflit opposant le livre et le journal, les conditions de leur hybridation fructueuse. Grand texte panoramique, inscrit dans le double sillage du «vers libre» et du poème en prose, tenant de la partition musicale et de la translation, à même la page imprimée noir sur blanc, des constellations qui, elles, aimait-il à dire, s'écrivent blanc sur noir au firmament. Mais aussi feu d'artifice typographique sur un ensemble de doubles pages de grand format (dans le second état du poème) et conférant aux «blancs» une aussi grande «importance[27]» qu'aux différents corps des caractères dont les lignes se composent, articulées qu'elles sont, de surcroît, autour d'un intitulé vertébral traversant en très grandes capitales l'ensemble de l'œuvre. Résumé d'une esthétique, mise en scène de la théorie de la signification propre à Mallarmé autant que mise en récit de la «mémorable crise» du vers — grand «événement» à l'échelle du microcosme poétique et inscrit comme tel au cœur de son dispositif[28] —,Un Coup de Dés semble bien répondre ainsi à deux séries de conditions de possibilité : série proprement littéraire d'un côté, avec «l'évolution» sur laquelle Jules Huret a mené la grande enquête que l'on sait; mais série aussi proprement journalistique, avec le paysage d'une presse en expansion et en voie de modernisation formelle sous l'impulsion d'un journal tel que Le Matin qui, le premier, bientôt imité par d'autres, avait brisé la verticalité des colonnes et expérimenté le titre manchette non justifié à la colonne. Œuvre hybride au total, née d'une méditation sur les formes respectives du livre et du journal. Et chef d'œuvre d'un poète saisi, à son corps plus ou moins défendant, par le démon de la presse.
[1] Propos recueilli par Jules Huret dans son Enquête sur l'évolution littéraire (1891), éd. Grojnowski, Vanves, Thot, 1982, p. 77.
[2] Stéphane Mallarmé, «Crise de vers», dans Œuvres complètes, tome 2, éd. Marchal, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2003, p. 212.
[3] «Billet», Poésies, dans Œuvres complètes, tome 1, éd. Marchal, Paris, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1998, p. 34.
[4] Introduction au recueil Divagations (1897), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 82.
[5] «Hérésies artistiques. L'Art pour tous», dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 360.
[6] Première des trois «Lettres sur l'Exposition internationale de Londres» (Le National, 1871), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 366.
[7] «Expositions internationales de Londres. Deuxième saison» (L'Illustration, 1872), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 386.
[8] Ibid., p. 386.
[9] Lettre (dite «autobiographique») à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, dans Correspondance, tome 2, éd. Mondor et Austin, Paris, Gallimard, 1965, p. 303.
[10] Voir Jean-Pierre Lecercle, Mallarmé et la mode, Paris, Séguier, 1989.
[11] Voir Pascal Durand, Mallarmé. Du sens des formes au sens des formalités, Paris, Seuil, coll. «Liber», 2008.
[12] Lettre à Marius Roux, 11 décembre 1877, dans Correspondance, tome 2, éd. citée, p. 157.
[13] «Les impressionnistes et Édouard Manet» (The Art Monthly Review, 1876), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 446. Pour une lecture approfondie de cette contribution essentielle à une esthétique pré-sociologique de l'impressionnisme, et préfigurant sous bien des aspects le grand texte que le poète consacrera à la «Crise de vers» des années 1880-1890, voir Pascal Durand, Crises. Mallarmé via Manet, Leuven, Peeters/Vrin, 1998.
[14] «Avant-dire» au Traité du Verbe (1886), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 677-678.
[15] «Le Livre, instrument spirituel» (1895), dans Œuvres complètes, tome 2, éd citée, p. 227 et p. 225.
[16] «L'action restreinte» (1895), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 217.
[17] Voir Gabriel Tarde, «Le public et la foule» (1898), dans L'opinion et la foule, Paris, P.U.F., 1989, p. 33.
[18] «Deuil» (1893), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 319.
[19] Ibid., p. 319.
[20] «Le Livre, instrument spirituel», dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 224.
[21] «Étalages» (1892), dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 218.
[22] Ibid., p. 223.
[23] «Le Livre, instrument spirituel», dans Œuvres complètes, tome 2, éd. citée, p. 225.
[24] Ibid., p. 224.
[25] Ibid., p. 226.
[26] Ibid., p. 227.
[27] «Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n'abolira le Hasard» (1897), dans Œuvres complètes, tome 1, éd. citée, p. 391.
[28] «Un coup de dés jamais n'abolira le hasard», dans Œuvres complètes, tome 1, éd. citée, p. 384.
Copyright © Pascal Durand, 2010.
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|