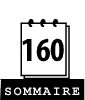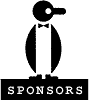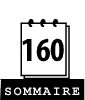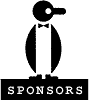|







|
|
UNE VOIX DE L'AU-DELÀ
PAR STÉPHANE LAMBERT
à Jacques Franck,

Il faut écrire, justement quand on croit que le mot imprimé ne peut plus rien améliorer. Aux optimistes, il peut sembler facile d'écrire. Aux sceptiques — pour ne pas dire : aux désespérés — c'est difficile, et c'est pour cela que leur parole devrait peser plus lourd. Ce devrait être pour ainsi dire des voix de l'au-delà. Auréolées par l'éclat de l'inutile.
Joseph Roth
I

Il faut marcher longtemps. Après avoir vu défiler, derrière la vitre du bus 285, la litanie d'enseignes commerciales étalée le long de l'avenue de Stalingrad (issue de la guerre froide). Carrefour, Bricorama, L'Oréal, Ibis. J'avais l'impression de réciter une prière alors que je me rendais au monumental cimetière de Thiais en périphérie parisienne. Un lieu d'inhumation beaucoup moins prisé que le Père Lachaise ou le cimetière Montparnasse, surtout lorsqu'on appartenait à l'intelligentsia germanopratine. Mourir, d'accord, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix, mais pas pour croupir le reste de l'éternité dans les faubourgs. Misère! L'on avait fui sa vie durant ce qui paraissait hors du centre, on n'allait pas s'en écarter une fois six pieds sous terre. Misère! C'est là le sort des exilés : eux savent ce que c'est qu'être loin. La solitude est leur maison. Ainsi c'était à Thiais que s'étaient terminés les naufrages d'Evgueni Zamiatine, de Paul Celan et de Joseph Roth. L'exil est sans joie. Ô Ténèbres. Ô Terre. Notre destin est amer. Autre psalmodie. Autre guerre. — Il faut marcher longtemps, après avoir franchi l'effrayant portique, pour rejoindre la 7e Division. C'était alors la campagne, et ce bout de cimetière qui passait le relais aux champs et aux prairies en fleurs aurait sûrement plu à Joseph Roth (si l'on en croyait les témoignages de ceux qui l'avaient côtoyé) pour y semer sa carcasse. Aujourd'hui ce sont des tours d'habitations qui bordent l'enceinte du cimetière. Célèbres HLM qui, avec les non moins fameux pavillons unifamiliaux, dessinent le paysage de la banlieue parisienne. Et lorsqu'en ce début de printemps je marche le long de l'interminable allée d'arbres (l'absence de feuillage m'empêche de pouvoir clairement les identifier) en direction de la 7e Division, je suis frappé par l'état des parterres de tombes traversés, sol retourné, emplacements vides, sépultures désaffectées, tableau de la mort en fin de cycle, se préparant à une nouvelle ère, et je continue d'avancer dans l'interminable allée dont la fin me paraît si lointaine qu'elle en devient presque aussi abstraite que les pas qui m'y mènent. Pour me guider, je n'ai qu'un seul repère : Joseph Roth est enterré à la 7e Division. Pas d'autre indice. Et lorsque j'arrive enfin, il faut m'y résoudre, malgré le découragement que m'inspire l'épreuve à accomplir : je vais devoir parcourir l'une après l'autre chaque rangée de morts, fouler la terre sèche sous le tiède soleil printanier — cela aurait pu être pire : chaleur écrasante, pluie glacée —, tenter de retrouver ce mort parmi tant d'autres — existait-il ailleurs au même instant un autre damné s'adonnant à ce sport funèbre —, au diable, le printemps! me dis-je alors, l'idée d'un après-midi paisiblement passé au jardin du Luxembourg, un livre entre les mains, m'avait effleuré l'esprit avant de me lancer dans l'expédition, au diable, le printemps! puisque c'était la même saison, un peu plus avancée, qui avait décidé de sa mort, — et je m'étais mis à parcourir à pas lents — mon moral n'était pas fameux — chaque rangée de tombes de la 7e Division, la tâche se compliquait du fait que la plupart des noms s'étaient effacés sur la pierre usée des sépultures, et je craignais de laisser passer celui de Joseph Roth devenu indéchiffrable, ou pire : enseveli sous l'anonymat où finissaient par échouer tous les morts, une crainte qui faillit une nouvelle fois me faire abandonner la mission que je m'étais fixée — pourquoi, pourquoi m'acharnais-je ainsi contre moi-même —, mais l'émotion suscitée par les marques d'affection que le deuil avait gravés sur des tablettes en pierre, « à mon époux tant aimé », « à notre chère maman », « à notre enfant regretté », « à mon frère », raffermit mes intentions, je voulais moi aussi témoigner au mort que je venais visiter du lien qui existait entre nous, ses livres n'avaient-ils pas fait de lui un frère qui aurait vécu avant moi dans le seul but de m'épauler, et sa voix sortie de l'au-delà m'habitait bien plus que celle de tant de vivants (des membres de ma propre famille), oh! et tous ceux-là qui témoignaient ici de leur attachement à ces morts devaient aujourd'hui aussi être des morts, et à leur tour d'autres vivants avaient écrit sur leur tombe le chagrin de leur deuil, ainsi va la mort, elle est la seule vérité qui tienne, et ainsi vont les mots, ils survivent à leurs auteurs, et alors que je divaguais, que mon esprit se perdait dans ce genre de considération, je trébuchai sur la tombe d'un certain Paul Claudel, les dates de vie et de mort (1920-1965) me confirmèrent tout de suite qu'il s'agissait bien d'une homonymie, comment aurait-il pu en être autrement, la gloire littéraire avait certainement permis à l'original de choisir un autre havre pour y planter ses restes fertiles, et sous ces pierres vieillies, brisées, décomposées, s'étaient dissoutes des vies, plus de corps, plus d'idées, au diable, le printemps! l'agrément des vivants sous un ciel calme au jardin du Luxembourg, — je me mis à envier ce repos, oui, on pouvait envier les morts, ensevelis sous la terre, débarrassés des oripeaux gênants, retournés à la sagesse de l'anéantissement, plus de corps, plus d'idées, souvenirs effacés dans la composition minéralogique du sol, baiser de la terre, néant, et ce 28 mai 1939 il faisait beau, c'est ce que rapportaient les témoignages de ceux qui, ce jour-là, avaient suivi le cercueil de l'écrivain autrichien, petite assemblée d'exilés qui avaient accompagné un des leurs jusqu'au bout du voyage, je ne sais pas si l'on peut dire un clan comme celui que forment les familles soudées à l'heure de la mort, mains qui se liguent comme une chaîne pour affirmer la perpétuation du lien, l'image est forte — l'isolement fait si peur —, je ne sais pas si ce jour du 28 mai 1939 cela s'était passé ainsi, sous ce beau soleil de printemps, où des exilés d'horizons différents, séparés de leur terre et de leur famille, s'étaient rassemblés derrière le cercueil d'un compagnon de déroute, manière de recomposer un semblant de monde, vision tenable, non, je ne sais pas si des mains s'étaient liguées en cette circonstance, mais des âmes, d'autres âmes, des âmes de poètes certainement, s'étaient donné rendez-vous à Thiais, plusieurs bornes au sud de Paris, en ce matin de printemps où le feuillage des arbres le long de l'interminable allée était suffisamment touffu pour permettre à la procession d'avancer dans l'ombre, — et enfin, alors que je m'étais mis à douter d'atteindre mon but après trois quarts d'heure de recherche sans résultat, et que j'étais déjà en train de me dire, tout cela pour rien, j'ai fait tout cela pour rien, toutes ces rangées de morts parcourues pour rien, et que je repensais au jardin du Luxembourg auquel j'avais renoncé, oui, alors que je commençais doucement à maudire ce lieu où j'étais venu me perdre, enfin j'étais tombé sur sa tombe, une plaque de marbre presque neuve avec son nom lisiblement imprimé, JOSEPH ROTH, et cette inscription en français : ÉCRIVAIN AUTRICHIEN / MORT À PARIS EN EXIL / 2.9.1894 - 27.5.1939. Comme cela se faisait fréquemment — je l'avais remarqué à chacun de mes pèlerinages sur des tombes d'écrivain — quelques pierres (du simple gravier) avaient été posées sur la dalle nue par des lecteurs de passage — ainsi l'écrit rejoignait-il à sa façon la minéralité. Un petit sapin vert vif virant au jaune planté à l'avant du monument funéraire semblait rappeler par son teint l'éthylisme du défunt. Je fis donc là silencieusement mes prières. (…) À la sortie du cimetière j'avais retrouvé l'effrayant portique qui faisait face à l'enseigne d'un McDo. À présent il me fallait retourner vers le centre, quitter cette zone où d'autres vivaient, éloigner la sensation d'exil. Toujours je me sentais loin de tout. Sentiment universel. Joseph Roth s'était dissout au bout du cimetière en face des champs où avaient poussé des HLM, et je repris le bus 285 sur l'avenue de Stalingrad. Lorsque je descendis à la gare routière de Villejuif, j'assistai à un impressionnant contrôle policier. Des uniformes, des uniformes, des uniformes. Partout autour de moi une armada d'uniformes se répandait, contrôlant, traquant la moindre irrégularité. De mon côté je masquai, du mieux que je pus, mon sentiment de clandestinité, et je passai une nouvelle fois entre les mailles du filet. Drôle de guerre.
II

Esprit brumeux. Lourd de l'alcool ingurgité. Ivresse crasse, stagnant dans la tête et les artères. Sommeil houleux. Cœur de poète envenimé. Visage en fin de course. Un pied dans la tombe et l'autre — l'autre rageant contre le sol endurci. Aujourd'hui il pleuvait encore. Cela n'arrêtait plus depuis plusieurs jours, diable c'était pourtant le printemps — mais au diable, le printemps! vous veniez de renverser votre verre sur les nouvelles du jour et le vin dessinait une auréole rouge sur le visage d'Hitler. Vos traits prématurément vieillis vous mèneraient droit à la fosse, et la pression montait, à la vue de ces journaux chaque jour la pression montait de plus en plus, de l'autre côté de la rue le spectacle désolant de l'hôtel Foyot démoli réveillait chaque matin une colère rouge, le passé dormait d'un sommeil contrarié sous les ruines, le réveil l'horreur de l'enfer, phrases griffonnées, le lever un combat pour, sur des bouts de papier déchirés, coins de serviettes, tracts publicitaires, béance en bordure de ce qui hier avait encore un sens et par où aujourd'hui tout s'échappait, clarté, ce nom simple ne venait plus, et l'enchaînement des mots capotait, la construction des phrases, laborieux processus, inutile désormais, l'ivresse et l'écriture emmêlées, pauvre moyen de faire. Faire quoi? Faire face à la catastrophe. Allons bon!… Chaque jour. Chaque matin. Rebâtir le monde. Au café Tournon. Proximité du Sénat et du jardin du Luxembourg. Toutes les heures du jour. Attablé. Près de la fenêtre. Il est là, assis exactement à la même place sur la banquette. Parcourant les fausses informations de la propagande. Et vous, rapporteur de vérité, vous réagissez, comment faire autrement, le monde est devenu abruti et sourd, vos nerfs à bout, le cœur malade, l'esprit brumeux et lourd. Phrases décomposées qu'il vous faut reconstruire. À quoi bon formuler l'impossible. Chaque jour, d'autres nouvelles arrivent à votre petit quartier général de la rue Tournon par la voix d'autres exilés. Débit de paroles autant que de boissons. La pensée de Friederike, ma petite Friedl, malgré les années de séparation, les liaisons, la pensée de Friedl, à Vienne, malade, malade des nerfs, et de la tête, bien avant vous, ne vous quittait plus, avait-elle senti si tôt, avait-elle déjà su, oui, bien avant vous, dans quel monde nous vivions, Friedl à Vienne, piégée par les Allemands, cette pensée vous glaçait le sang, vous tourniez le dos au miroir, la vision de vos traits, oh! ne parlons pas de ça, n'était-ce pas vous qui sombriez au fond, le monde allait bien, vous vous faisiez des idées, Friedl était restée là-bas, en Ostmark, l'Autriche était devenue une province du Reich, le pire était en marche, personne n'avait bronché, tout allait bien, il fallait voir avec quelle lascivité Vienne s'était offerte à l'assaut de l'ogre, une vraie putain, Friedl était restée là-bas entre leurs sales mains de nazis, là-bas, en Ostmark, l'enfer avait pris le pouvoir, et malgré tout, malgré le chagrin d'avoir perdu Friedl, d'avoir tout perdu, la douleur indicible que vous inspirait l'état du monde, malgré votre cœur malade de poète, votre cœur de poète malade, malgré la fatalité de la destruction, vous écriviez, quotidiennement vous écriviez, on vous avait rapporté avec quel entrain les Autrichiens (vos frères?) avaient crié «Mort aux Juifs», et quotidiennement vous écriviez, miracle du saint Buveur! jusqu'à la dernière goutte d'alcool et d'encre vous écririez, des mots rageurs et lumineux, tirés de l'esprit brumeux et lourd. «Mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là.» Proverbe de la maison. Affiché à l'avant du comptoir. L'au-delà? C'est là que le vin d'ici vous mènerait un jour — une heure prochaine. Que Dieu nous accorde à nous tous, à nous autres buveurs, une mort aussi douce et aussi belle! Un rouge! Visage empourpré. Buvons à la santé de l'Autriche! Sensation sombre. Buvons à la santé de l'Anschluss!… Impression de sombrer. Et à ma petite Friedl, puis vous retombiez dans un silence de plomb pendant quelques minutes, le regard perdu dans une direction inconnue, avant qu'un étranger ne vous dérange, demandant à vous parler, ah! le pouvoir salvateur que l'on prêtait aux écrivains, vous saviez bien que vos mots étaient parfaitement inutiles, qu'ils ne sauveraient rien, ni personne, mais on vous suppliait de rendre compte de cela dans l'un des journaux en exil auxquels vous contribuiez, et la pression montait, en vous la pression montait, mêlée à l'ivresse, et à l'abattement, mêlée à toutes ces forces qui vous détruisaient, et quel fourmillement dans ce monde, une heure avant sa fin, vous vous sentiez diablement remontés tout à coup, Un rouge! un verre de Chevigny pour l'heure, l'au-delà attendra! Et buvons! Buvons à la santé de l'Allemagne! et de ce bon vieux poète de Gottfried Benn! Pire qu'une putain, celui-là... Et à tous ses nouveaux amis sanguinaires! Et vous repensiez à la Galicie, à votre terre de Galicie, en première ligne désormais, aux juifs de Galicie, en première ligne désormais, les menaces proférées par vos propres compatriotes annonçaient la boucherie, déjà la vision des Einsatzgruppen, et de leurs exécutions de masse, vous traversait l'esprit comme une annonciation du pire, saint Buveur éclairé par l'horreur, et vous entendiez les coups de feu en série, de la main vous vous frappiez le crâne, et vous visionniez les tas de corps, superposés les uns sur les autres après leur massacre à la chaîne dans ces grandes déchetteries humaines que seraient les charniers de Galicie, ne vous faites pas d'illusion, disiez-vous à votre interlocuteur, c'est l'enfer qui a pris le pouvoir, et vous saviez que plus rien ne sauverait Friedl de l'idéologie nazie, plan d'euthanasie des malades mentaux, la mort généralisée comme unique politique, c'était conforme à la destruction en cours, et dehors il pleuvait, au diable le printemps, vous buviez une gorgée de rouge, et maugréiez contre la lâcheté internationale, la peur d'une guerre avait sacrifié la paix du monde, le monde sombrait, qui aurait pu prétendre le contraire, Gottfried Benn ânonnant sa leçon?... L'appétit de l'ogre ne s'arrêterait plus, non, et dans votre tête embrumée, tempête, tempête, vous entendiez déjà les coups de feu en série, les rafales affolaient les tympans, la pluie martelait les carreaux, tempête, tempête, et la pression montait, et sur votre visage empourpré précocement usé on lisait la rage intérieure qui vous persécutait, sur votre dos un manteau gris abîmé, dans votre chambre une valise à moitié vide, dans votre tête le souvenir de Friedl, et devant vous des feuilles tâchées d'alcool et d'encre, des feuilles mortes parcourues de signes illisibles, oh! et des pensées aussi, des pensées vaines, sans lendemain, qui vous dévoraient l'âme et le corps, Un rouge! aviez-vous articulé avant de vous écrouler sur la table où chaque jour vous écriviez sans relâche, presque comme un dément, et quel aurait pu être votre dernier toast, allons, allons, cher mort, faites preuve d'un peu d'imagination, chacun autour de vous avait vu venir ce moment, chacun l'avait craint, mais personne ne s'était encore habitué, de votre part, à un silence si définitif, Alors buvons, auriez-vous pu lancer à la cantonade, buvons à la santé du Führer, oui, tiens, buvons à la santé d'Hitler! Car ce jour de mai 1939, lorsque Joseph Roth s'écroula à sa table du café Tournon, avant de mourir quatre jours plus tard dans un dortoir de l'hôpital Necker, ce n'était pas fini, la mort ne faisait que commencer.
Copyright © Stéphane Lambert, 2010
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|