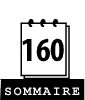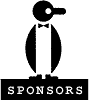Lorsque l’avocat bruxellois Paul-Aloïse De Bock publie en 1961 chez Denoël cette ample fresque qu’il intitule Les Chemins de Rome, la critique ne soupçonne pas qu’il s’agit d’un véritable roman à clé. À certains, l’intrigue, certes excessivement profuse, paraît incroyable. Qu’on en juge : le héros, Giovanni Giovannelli, a échappé à la police de Mussolini en fuyant l’Italie à skis. Il retourne néanmoins dans son pays natal afin d’assister à l’enterrement de son père, boulanger à Assise. Puis, à Bruxelles, il tente d’assassiner un prince italien venu fêter ses fiançailles en Belgique. Il le manque volontairement, mais affirme avoir voulu tuer afin de transformer le tribunal qui le condamne en tribune dénonçant publiquement le fascisme. Pendant son séjour dans les prisons belges, il noue une idylle épistolaire avec la secrétaire de son avocat et lui fixe rendez-vous, le jour de sa libération, au seul endroit de Bruxelles qu’il connaît: la colonne du Congrès, d’où il a tiré sur le prince. Quelques mois plus tard, le voici en Espagne où il meurt sur le front républicain.
Nul destin n’est plus romanesque. Et pourtant, la plupart des faits ici présentés ont effectivement eu lieu. Paul-Aloïse De Bock (1898-1986), fils d’un ouvrier pâtissier, membre du Parti Ouvrier Belge depuis 1919, formé au jury central puis à l’Université libre de Bruxelles, est un petit avocat bruxellois spécialisé dans la défense des coopératives socialistes. C’est le procès de Fernando De Rosa dont il assume la défense conjointement avec Paul-Henri Spaak et un vieux maître du barreau de Bruxelles, qui lui apporte une gloire soudaine, et la matière de son œuvre littéraire. Fernando De Rosa a effectivement tiré en octobre 1929 sur le prince héritier d’Italie, Umberto, qui, à l’occasion de ses fiançailles avec la princesse Marie-José de Belgique, venait déposer des fleurs à la colonne du Congrès. Toutefois, si la mort tragique de De Rosa en Espagne est authentique, De Bock a mêlé d’autres épisodes au destin de son héros. C’est un autre socialiste italien émigré à Bruxelles, Yacometti, qui a eu l’audace de retourner en Italie au chevet de son père; De Rosa, lui, y était venu clandestinement pour renouer des liens avec des groupes antifascistes.
Le roman apparaît donc comme une galerie de portraits de personnages historiques. On y rencontre Salvemini, ancien professeur d’histoire à l’Université de Florence et cerveau de l’antifascisme (Montesalve), le Comte Sforza, ministre des Affaires étrangères après la chute de Mussolini (Chiroze) ainsi que, au passage, Pietro Nenni, l’avocat Modigliani, frère du peintre défunt, ou bien encore Menapace, un indicateur de la police italienne (Panamace) infiltré dans les milieux de la Concentration antifasciste. Du côté belge, De Bock lui-même (l’avocat Guérain), l’anarchiste Ernestan, Charles Plisnier, Jules Destrée, le ministre de la justice Paul Janson (Paul Redonde) et bien d’autres... Pour l’historien, Les Chemins de Rome s’imposent comme une source de premier ordre sur l’antifascisme italien immigré à Bruxelles, et ce d’autant plus que la forme du roman à clé permet à l’auteur d’exprimer des convictions et des jugements sur les événements même en l’absence de preuves matérielles[1].
L’étude de la composition du roman révèle toutefois qu’on ne saurait borner la lecture à la simple redécouverte des faits historiques. Les Chemins de Rome réunissent en effet deux niveaux narratifs, le souvenir et le roman, qui se mêlent inextricablement.
L’auteur attribue à son héros ses propres souvenirs d’enfance. L’épisode de la pâtisserie paternelle, le séjour dans les dunes belges, un meeting avec Vandervelde, les réactions des socialistes belges à la fin de la Grande Guerre sont autant d’événements qui ont marqué l’auteur. A ce premier niveau, Paul-Aloïse De Bock se ménage ainsi une double entrée dans le roman: le masque de Maître Guérain lui permet d’intervenir comme personnage, l’enfance de Giovanni Giovanelli reflète son itinéraire personnel et confère à la fiction la densité de la mémoire. Cette disjonction narrative de l’autobiographie lui permet d’assumer la distance chronologique qui le sépare des faits. Elle le protège d’une prise de parti trop univoque. Elle donne enfin au récit le tour critique et ironique qui est pour beaucoup dans l’intérêt qu’il suscite.
Le second niveau est celui de l’Histoire. Mais ici aussi, De Bock a fait éclater la continuité prévisible. Il mêle les deux procès de l’antifascisme auxquels il a été confronté: celui de De Rosa en 1929, et celui de l’anarchiste Berneri, en 1927 (Ruboni dans le livre). Dans Les Chemins de Rome, les deux affaires semblent n’en faire qu’une et c’est en pensant au procès de son ami Ruboni que Giovanelli fait appel à Maître Guérain pour le défendre. En s’écartant ainsi de la logique événementielle, De Bock intègre les différentes figures historiques qu’il a côtoyées dans une constellation sémantique dont la figure maîtresse devient la relation d’attirance/répulsion de Giovanni pour Ruboni, du socialiste pour l’anarchiste, de l’exigence politique de l’efficacité pour l’éthique de la pureté. C’est en ce sens que la composition du roman révèle son enjeu essentiel : une réflexion sur l’engagement des intellectuels socialistes dans l’entre-deux-guerres, confrontés au fascisme d’une part, à leur destin personnel de l’autre[2].
Différentes pratiques militantes surgissent alors. L’anarchisme représente une « ligne droite » ; il s’oppose au socialisme, prêt à épouser les sinuosités du compromis. Ruboni, « l’étincelant gardien de la cité Solaire» (p. 283), veillant sur le feu sacré, fait coïncider, dans ses actes, la transformation du monde avec l’affermissement du moi : « Je veux prouver au monde et à moi-même, Ruboni, mon antifascisme. » En face de lui, l’intellectuel socialiste quémande une sanction plus modeste, une vérité extérieure qui lui révélerait la voie à suivre. Telle est la supplique de Giovanni : « Pour moi, c’est plus simple. J’ai besoin de communier, de me sentir solidaire, lié à une force qui me transporte au delà de moi-même » (p. 54). Leur dialogue ne porte guère sur la stratégie ou sur les objectifs du combat politique. Ils débattent de la signification individuelle de l’engagement. Les avantages matériels ne les requièrent pas, et ils ne peuvent admettre qu’un profit soit le mobile de leur action. Devant les communistes qui promettent des améliorations du niveau de vie, « Giovanni était mal à l’aise. Il se demandait pourquoi les communistes essayaient de séduire en appâtant leurs amorces de bienfaits petits-bourgeois » (p. 76). Pour le héros, la question récurrente, fondamentale, est celle de la mort de Dieu : « Il s’agissait de le remplacer » (p. 77). Le héros est pris, littéralement, entre ces deux feux: la pureté et la nécessité. Il sait que « les actes que commandent les subtilités de la vie politique l’entraînaient sur une route bien tortueuse. Était-ce la sienne ? » (p. 78) — mais, d’autre part, il n’ignore pas que « la pureté, camarade, comme les Chemins de Rome, a ses méandres » (p. 232). Toutes les voies du roman convergent vers cette interrogation existentielle : le statut d’une éthique socialiste.
C’est pourquoi l’œuvre est bien la synthèse des interrogations d’un milieu et d’une génération. Elle pose, avec un recul de plus de vingt ans, les questions qui agitaient les intellectuels d’origine bourgeoise et de conviction socialiste au tournant des années trente. Paul-Aloïse De Bock, Pierre Vermeylen ou Charles Plisnier, pour ne citer que les plus connus d’entre eux, s’efforcent d’agir à l’unisson avec un prolétariat dont ils ne partagent ni les mœurs, ni les habitudes, mais bien, croient-ils, le destin historique. À leur situation s’applique très exactement l’idée d’Henri De Man selon laquelle « l’intellectuel qui sert le socialisme en remplissant une fonction dans le mouvement ouvrier ne se débarrasse jamais du sentiment qu’il est infériorisé par son origine de classe[3] ».
On ne peut donc s’empêcher de comparer Les Chemins de Rome avec Faux Passeports, ces nouvelles de Charles Plisnier qui, elles-aussi, brassent l’univers de l’antifascisme. Les agissements provocateurs de la police italienne sont décrits dans Carlotta. Ici encore, des faits historiques transparaissent derrière la fiction: la trahison d’Eros Vecchi qui conduit à l’arrestation de Camilla Ravera, dirigeante du P.C.I. clandestin, arrêtée par la police mussolinienne en 1930 et qui restera privée de liberté jusqu’en en 1943. Plisnier rapporte l’exécution manquée du dénonciateur et les événements survenus à Sartrouville dans la banlieue de Paris[4].
À Faux Passeports, le roman de De Bock doit sans doute aussi le travail de re-création de l’Histoire. Plisnier s’est plu, en effet, à monter un double récit, avec deux agents provocateurs. Il fausse aussi les pistes en s’accordant un rôle à la première personne qui est tout à fait impossible car, s’il demeure en contact avec les milieux antifascistes, il a, en 1930, rompu tous les ponts avec le parti communiste. Par contre, si Plisnier rédige des nouvelles en prise directe sur l’événement, qui sont donc susceptibles de peser sur le cours des choses, De Bock, lui, récuse tout engagement, toute intervention. Mais ses personnages répètent étrangement les termes dans lesquels le narrateur de Faux Passeports faisait ses adieux aux compagnons des temps où « tout brûlait encore», à cette «communauté d’espérance », à ces « souvenirs du temps de la foi[5] ».
D’où vient que l’engagement des personnages de nos deux écrivains soit toujours vécu sur le mode du sacrifice ? Impossible, naturellement, de « résoudre » cette question ici, mais observons que la place accordée aux intellectuels dans la théorie socialiste n’est pas sans influencer directement la forme de leur engagement. Celle-ci dépend du rôle qui leur est imparti, de la nature de leur investissement affectif, et de la part d’eux-mêmes qu’ils consentent à céder. De ce point de vue, le socialisme belge des années trente présente de bien peu toniques réflexions. Voyez l’analyse de Jules Destrée, un des principaux théoriciens du P.O.B. Dans un chapitre de son Introduction à la vie socialiste (Bruxelles, 1929), il étudie les motifs qui conduisent vers le parti les petits et les grands intellectuels. Les premiers, entendez les travailleurs non manuels, employés ou fonctionnaires, sont prolétarisés par le capitalisme et, fort logiquement, s’unissent aux prolétaires organisés contre le système. Les seconds, notamment les universitaires, sont plus difficiles à comprendre. Il en est qui n’ont ni clientèle, ni gros revenus, qui ont peiné pour conquérir leur diplômes: c’est la « cohorte lamentable de la misère en habit noir ». Feront-ils de bons socialistes ? Destrée ne le croit pas : « Ceux-là, les faméliques, viendront peut-être à nous dans un esprit de révolte, mais ce sont des recrues peu désirables ; ils sont aigris et amers, pleins de fiel et d’envie, et leur place est plutôt chez les communistes » (p. 67).
Ce rejet des «prolétaires intellectuels» est l’aveu d’une faille dans la réflexion théorique de Destrée et dans celle du P.O.B., puisque entre la conscience de classe des prolétaires et la miséricorde des grands bourgeois qui « vont au peuple », il ne semble pas y avoir de place attribuée à ceux qui rejoignent le Parti pour des raisons idéologiques autant qu’économiques. Cette grave lacune justifie partiellement le succès des thèses sur l’engagement éthique soutenues par Henri De Man. Comment donc Paul-Aloïse De Bock et ses amis auraient-ils pu adhérer sans hésitations ni réticences à un parti dont les théoriciens occultaient ainsi leurs motivations les plus nobles ? Il est légitime de penser que les réflexions obsédantes de Plisnier ou de De Bock sur l’éthique socialiste, les thèmes dichotomiques de la trahison et du sacrifice, l’engagement vécu en termes de passion ou de déchirement proviennent pour une part de cette faille théorique que symbolise le nom de Jules Destrée.
Par ailleurs, Jules Destrée est écrivain. Il est utile de rappeler qu’il fut, pendant la Grande Guerre, avec Georges Lorand ou Maurice Maeterlinck, le fer de lance du « bon droit » de la Belgique envahie auprès du gouvernement italien, le héraut de l’amitié entre les deux pays et le chantre de l’intervention de l’Italie dans le premier conflit mondial[6]. L’homme connaît donc parfaitement la classe politique romaine, il aime le pays, ses monuments, son climat, sa culture… Ce bourgeois aux goûts raffinés[7], avocat et député socialiste, pouvait-il donc ne pas être mêlé à l’intrigue des Chemins de Rome ? C’est bien à lui, qui avait refusé de défendre De Rosa, et aux notables mondains du socialisme que Paul-Aloïse De Bock décroche quelques-uns des traits les plus acérés de son roman. Le voici, par exemple, sous le pseudonyme transparent de Paul Dexhtrait, recevant chez lui le ministre italien de la Justice, Ricci :
Célèbre par son amour de l’Italie et son raffinement esthétique, Destrée l’était aussi par la hauteur qu’il savait prendre à l’égard des contingences politiques. Toutefois, ce n’est pas l’idée que les goûts artistiques sont au-dessus des partis que condamne De Bock (l’anarchiste Ruboni ne va-t-il pas jusqu’à déclarer : « ce socialiste-là, je le comprends: l’art est éternel »), mais bien l’accumulation de contradictions qui font que cet ancien ministre socialiste, encore investi de lourdes responsabilités dans son parti, peut en toute ingénuité retourner en Italie dans les années trente, et ne percevoir en définitive rien de choquant dans «l’essor actuel » du pays.
Destrée publie effectivement en 1931 un ouvrage assez peu connu, Un jour je voyageais en Calabre… (Bruxelles, L’Églantine), décrivant son dernier séjour transalpin. Dans un chapitre intitulé « Le Fascisme », il s’interroge sur la manière dont les Italiens ressentent le manque de liberté. Homme du monde, pour ne pas déranger ses interlocuteurs, il s’abstient « soigneusement de toute conversation pouvant avoir un caractère politique ». Ce qui ne l’empêche pas d’observer d’un regard plutôt sympathique les différentes manifestations du régime fasciste : la « façon de tendre le bras droit avec la main levée est d’ailleurs un assez beau cérémonial », les défilés lui paraissent passer « dans la sympathie générale ». D’ailleurs, au total :
Après un séjour en Calabre, voici Destrée visitant une école. Aux murs : les portraits du Prince Umberto et de la princesse Marie-José. Enthousiasme populaire. Une vieille servante met genou en terre pour lui baiser les mains. Peu habitué à ces «marques orientales de vénération», le tribun s’étonne. Sa conclusion nous ramène paradoxalement aux détours des Chemins de Rome :
Les Chemins de Rome sont à la fois un roman, un témoignage et une analyse. Avec un sens très fin de l’équilibre, Paul-Aloïse De Bock y dose la réalité et la fiction, l’intuition et l’imaginaire. La confrontation du texte avec les événements historiques et avec d’autres ouvrages confirme amplement la justesse d’une approche trop subtile pour prétendre résoudre les conflits que les contemporains n’ont pas tranchés. Vingt ans après les faits, l’auteur ne pouvait pas avoir pour intention première de dresser un panégyrique, moins encore un réquisitoire. Mais à l’étude de l’engagement de ses contemporains, aux rêves et aux illusions souvent déçues de sa génération, Paul-Aloïse De Bock présente l’Italie comme une pierre de touche. C’est à la mesure des enjeux de l’antifascisme que s’éprouvent la pureté des uns et les ambitions des autres, que se creuse le profond fossé séparant les défenseurs du « terroriste » De Rosa et l’enthousiasme populaire accueillant en Calabre le compatriote de Marie-José. C’est donc une Italie réelle, et non un pays mythique, une Italie où politique et culture sont inéluctablement liées, qui partage les camps et les partis, qui divise ces écrivains belges qui sont aussi les personnages de De Bock… De cela aussi, la littérature peut être comptable !
* Texte publié in La deriva delle francofonie « Les avatars d’un regard : L‘Italie vue travers les écrivains belges de langue française ». A cura di Anna Soncini Fratta, Bologna, CLUEB, 1988, p. 79-91. Actes du colloque à Bagni di Lucca, 5-6 octobre 1987.
NOTES

[1] Voyez l’étude d’Anne Morelli, Les Chemins de Rome; mesure des réalités historiques et des fictions d’un roman à clé, « Bulletin de la société d’étude des lettres françaises de Belgique », n° 8, janvier 1984. Notre rappel des realia de l’œuvre doit tout à cette passionnante étude.
[2] Il est probable que le nom de Ruboni soit une autre allusion historique : Émile Royer, avocat et député socialiste, avait défendu à Bruxelles, en 1903, un anarchiste italien appelé Rubino. Cette affaire, qui fit date dans les annales judiciaires, présente de nombreuses analogies avec les faits rapportés par De Bock. Cf. Émile Royer, Prose pour Jean Prolo, Bruxelles, Joseph Milot, 1908. Pour la petite histoire, on notera que Rubino, en prison, s’était mis à écrire et qu’il souhaitait publier son œuvre littéraire au profit de son fils, le petit Marxy.
[3] Henri De Man, Au delà du marxisme, Bruxelles, 1927, p. 171. La même idée a été développée par Louis Althusser dans une page célèbre de son Pour Marx.
[4] Voyez José Gotovitch et Anne Morelli, « Faux Passeports pour la révolution », in Charles Plisnier, entre l’Evangile et la Révolution, Bruxelles, Labor, 1988 (« Archives du futur »). Les travaux d’Anne Morelli font autorité en ce qui regarde l’antifascisme italien émigré en Belgique. Voyez notamment : Fascismo e antifascismo, 1988.
[5] Faux Passeports, Paris, Corrêa, 1946, p. 393-395.
[6] Voyez Michel Dumoulin, Jules Destrée. Souvenirs des temps de guerre, Louvain, Nauwelaerts, 1980, p. 55.
[7] Charles d’Ydewalle, La Cour et la Ville, Bruxelles, 1945, p. 112-116, donne une description amusée du luxe des Destrée (cité par M. Dumoulin, op. cit.).
Copyright © Paul Aron, 2012
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne