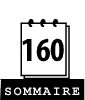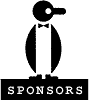|








|
|
LE JOUR OÙ J'AI FAIT MA PREMIÈRE PHOTO
Il y a quelques années, j'ai essayé de faire une photo, une seule photo, quelque chose comme un portrait, un autoportrait peut-être, mais sans moi et sans personne, seulement une présence, entière et nue, douloureuse et simple, sans arrière-plan et presque sans lumière.
(L'Appareil-photo, 1989)
Ma première photo, je l'ai faite vers quarante ans — à trente-neuf ans exactement, quelques jours après mon anniversaire de trente-neuf ans. Certes, à vingt ans, j'avais déjà fait quelques photos que je développais dans ma salle de bain. Toutes ces photos, tirages et négatifs, ont disparu, ils sont peut-être dans des boîtes de rangement, ou dans une malle, avec le Praktika dont je me servais à l'époque, l'agrandisseur et les grands bacs de développement rouges à l'abandon qui doivent encore sentir le fixateur et le révélateur. Je revois très bien ces trois bacs en plastique rouges posés sur une planche en travers de la baignoire où quelques photos en devenir trempaient dans l'obscurité rougeoyante de ma salle de bain, mais j'ignore où ils sont à présent, ailleurs que dans la tiédeur vacillante de mes souvenirs. Mes sujets de prédilection étaient des plus divers (assez pittoresque, je le crains), je me souviens avoir photographié le marché du boulevard Richard-Lenoir à Paris et des pêcheurs au Portugal. Plus tard, vers trente ans, ce n'est plus que dans mes livres que je fis des photos. Les plus emblématiques sont celles que j'ai faites dans L'Appareil-photo, avec un appareil volé, quelques photos mentales prises en courant dans la nuit dans les escaliers d'un navire, photos uniformément sous-exposées qui, lorsque je les fis développer, ne révélèrent rien d'autre que quelques traces de mon absence.
Le Nanzen-ji, à Kyoto, est un temple dont j'ai souvent visité le jardin, non qu'il soit l'un de mes jardins préférés, mais parce que c'était l'un des plus près de l'endroit où j'habitais alors (et, quoique la proximité géographique ne soit pas un élément déterminant dans la constitution de mon goût, il faut reconnaître que c'est souvent un adjuvant précieux). J'ai visité le Nanzen-ji par tous les temps, sous le soleil et sous la pluie, j'ai arpenté ses allées de long en large, j'ai vu les feuilles de ses érables rougir en automne sous mes regards peut-être trop insistants. Pour en ressortir, il m'est arrivé d'emprunter différentes issues et de le quitter par le Nord, à pas lents, la tête baissée, tel un moine perdu dans ses pensées, qui se dirige vers le chemin de la philosophie (ou prend le chemin de traverse d'un petit bistrot qu'il connaîtrait dans le coin), ou par le Sud, en escaladant un raidillon qui menait à un chemin de halage à l'ombre d'un canal. Il m'est même arrivé, plus rarement, de ressortir par la sortie. Un jour que je me promenais dans les jardins du Nanzen-ji parmi les hauts pins silencieux, apercevant au loin les tuiles grises de quelque toit en pagodes qui s'élevait au-dessus des murailles de pierre, perdu dans le silence et la tranquillité des lieux, je me suis senti soudain en harmonie avec le temps. Il m'apparut alors que mes gestes, quand je n'y prenais pas garde, avaient souvent quelque chose d'imparfait, d'irréfléchi et de brutal, pour ne pas dire d'occidental. Toujours, je tirais et tordais (pour ouvrir un paquet, impatient, j'arrachais, je déchirais le papier). Et, alors que, ce jour de décembre 1996, je m'apprêtais à faire ma première photo dans les jardins du Nanzen-ji, je me suis ravisé, me rendant compte que tous les gestes que j'avais accomplis jusqu'alors avaient été exécutés machinalement, sans grâce et sans méthode, avec un rien de nervosité au moment de sortir l'argent de ma poche à la caisse, un doigt d'impatience pour retirer le cache de l'appareil-photo. Alors, renonçant à faire ma photo, je me suis assis sur les marches du jardin de pierres et j'ai respiré lentement en ne pensant plus à rien jusqu'à ce que le vide, progressivement, se fît dans mon esprit. Je regardais devant moi, je regardais les pierres et la végétation savamment ordonnancée, je regardais les traces de râteau sur le sol, mi-abstraites, mi-concrètes, telles des vagues immobiles parallèles, comme les vestiges d'un temps qui avait passé en laissant derrière lui les lignes régulières d'un sillage de graviers. Je me relevai et m'éloignai dans les allées du temple. Je m'éloignais en chaussettes sur le parquet glacé qui surplombait l'étendue de graviers en contrebas quand j'aperçus fortuitement mon ombre sur une paroi du temple. Très lentement alors, avec la lenteur juste des gestes apaisés, je soulevai l'appareil à la hauteur de ma poitrine, et, cadrant mentalement la photo, la cadrant d'instinct sans porter les yeux à la hauteur du viseur, d'un doigt sûr et précis, léger et sans tension, j'appuyai sur le déclencheur et fixai mon ombre sur la paroi.
Et peut-être venais-je de mesurer là encore une fois ce que je savais déjà intuitivement, que la photo — et l'art — était une expérience de vie, une expérience intime dont le sens résidait davantage dans sa réalisation que dans les œuvres elles-mêmes.

Copyright © Jean-Philippe Toussaint, 2001
|