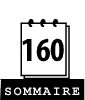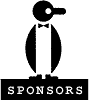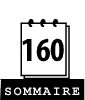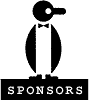|







|
|
MES PETITES CAPITALES
Roma

Mes pas croisent ceux des touristes marchant les yeux rivés sur le plan de la ville. Rentrés chez eux, ils garderont de Rome l'image d'un plan coloré dont les plis se rebellent. Moi je me surprends de temps en temps à marcher la tête en l'air. La vue est saisissante : se découpant sur le ciel, le sommet des immeubles ocres déborde d'un désordre de surélévations probablement illégales qui ont échappé à la vigilance des agents de l'urbanisme. Parfois aussi je rencontre des curés en soutane marchant d'un pas décidé : les fantômes de Rome, dont les draps noir ou pourpres sont seuls à flotter dans l'immobilité du temps. Le temps, je l'ai pris à contre-pied dans l'escalier roulant de la station de métro Colosseo. Quelle sensation de deviner au-dessus de sa tête les ruines enfouies, d'en faire le tour par une porte dérobée qui accéderait aux coulisses. Dans le Trastevere, j'ai brusquement débouché, comme sur une scène de théâtre, Piazza de Renzi qui n'est ni carrée, ni ronde, ni rectangulaire. Elle est toutes ces formes et aucune à la fois. Son harmonie, à l'image de celle de Rome, ne repose sur aucune symétrie. Quatre rues s'y engouffrent dans un certain désordre. Après quelques mètres, à la faveur d'un angle ou d'une courbe, elles disparaissent, laissant entrevoir, par-delà leur défilé, d'autres décors semblables. De même les volumes et les hauteurs des maisons, tous disproportionnés, s'agencent en un surprenant équilibre. Le patron du restaurant où j'ai pris place s'appelle Augusto. Sans rien me demander, il a jeté sur la table une nappe de papier et une carafe de vin blanc un peu trouble. Puis il m'a servi des fettucine fleurant un mélange d'ail, de basilic et d'huile d'olive. Les gens affluent à présent et Augusto crie dans toutes les directions. La répétition quotidienne de ce rite l'a rendu presque aphone, comme si sa voix ne devait rien troubler du silence de la place.
Riga

Nous nous sommes donné rendez-vous au sud de la ville dans un café près du marché couvert, cinq vastes hangars tout en métal qui au début du siècle abritaient des zeppelins. L'avion a eu raison des zeppelins pourtant plus légers que l'air mais gonflés de gaz sujets aux embrasements d'apocalypse. Par bonheur les hangars ont été réaffectés au commerce de viande, de légumes, de poissons et d'objets en tout genre comme on en trouve dans tous les marchés. Monsieur Michielson m'attendait assis à une table proche du comptoir. Je le reconnus au livre posé devant lui qui portait le nom de sa maison d'édition Daugava qui n'est autre que celui du fleuve qui borde Riga avant de se jeter huit kilomètres plus loin dans les flots de la mer Baltique. C'était un roman de Marguerite Duras traduit en letton, sa maison s'étant spécialisée dans la publication d'ouvrages en langue étrangère. Je ne m'attendais pas à me trouver face à un homme si âgé, quatre-vingt ans, peut-être. Devinant les raisons de ma surprise, M. Michielson me raconta son histoire. En 1939, le pacte germano-soviétique avait réglé le partage des pays baltes. La Lettonie et l'Estonie à l'URSS, la Lituanie à l'Allemagne. Lorsqu'en 1945, l'Union soviétique annexa la Lettonie, M. Michielson traversa la Baltique pour s'installer à Stockholm où il fonda une imprimerie, berceau des éditions Daugava dont les ouvrages en letton se diffusaient clandestinement. En 1990, le Lettonie retrouva son indépendance. M. Michielson attendait pareille fête depuis cinquante ans. Il traversa la mer Baltique dans l'autre sens. Riga était toujours aussi belle. Ses immeubles art nouveau aussi malgré leur petit coup de vieux. On aurait tout le temps de les bichonner à présent. Dans l'un d'eux, quelques semaines plus tard, les bureaux des éditions Daugava étaient inaugurés. M. Michielson avait retrouvé ses jambes de vingt ans.
Tallinn

Le ferry où j'embarquai dans le port d'Helsinki ressemblait à un gigantesque bar. Je ne mis pas longtemps à comprendre que le but de la traversée du golfe de Finlande était moins de se rendre à Tallinn dans un quelconque but professionnel ou touristique que de passer quelques heures bien remplies à se bourrer la gueule à des tarifs défiant toute concurrence. Après plus de trois heures baignées de beuveries, de rigolades et de bruits de verres cassés, le bateau s'engouffra enfin dans le port de Tallinn, longeant des murs d'arbres entassés que des grues chargeaient dans des cargos. À croire que l'Estonie n'était qu'une immense forêt. Quand le ferry s'immobilisa à quai, la moitié des passagers roupillait sur des banquettes, l'autre éclusait les fonds de bouteilles. Comme prévu, nous ne fûmes qu'une poignée à descendre. Je n'osais imaginer l'état du bateau durant la traversée du retour. Une énorme patinoire. Parmi les rescapés de cette noyade générale, un jeune homme me demanda si je connaissais l'université. Hélas non, lui répondis-je. C'était moi aussi la première fois que je foulais le sol estonien. Il était linguiste à l'université de Tampere et participait à un colloque consacré aux langues finno-ougriennes dont font partie l'estonien et le finnois, des langues dites agglutinantes où les articles, prépositions, genres ou pronoms inexistants sont remplacés par des préfixes ou suffixes dont chaque nom se gonfle. Alors que nous gravissions les rues tortueuses du vieux Tallinn où le temps semblait s'être arrêté, il me parla avec enthousiasme du live qui était sa spécialité, une langue appartenant au même groupe mais parlée sur les côtes de Courlande. Aux douzième et treizième siècles, les Lives, peuple païen irréductible, s'étaient distingués par leur résistance farouche aux Croisés teutons et à leur entreprise d'évangélisation forcée. Aujourd'hui ils sont encore une douzaine, tout au plus. Hélas, ne vivant pas au même endroit, ils ne communiquent plus entre eux. On assistait donc impuissants à la disparition d'une langue dont ce jeune chercheur tentait de conserver la trace. Arrivés à hauteur de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski qui domine la ville, nos chemins se séparèrent. Je repartis songeur. Les langues comme les villes sont des oeuvres humaines exposées à la fragilité de l'histoire et du temps. Par quel miracle Tallinn, vestige d'un autre âge, a-t-elle survécu aux invasions et occupations multiples alors que le live, avec ses derniers locuteurs, serait bientôt précipité dans l'oubli?
Berlin

À quel privilège la SABENA devait-elle d'atterrir à l'aéroport de Tempelhof que, pour son usage personnel, Hitler avait fait construire en plein centre de Berlin? Elle était, paraît-il, la seule compagnie étrangère dans ce cas. Certaines villes existent par la seule résonance de leur nom. C'était le cas de Berlin jusqu'il y a quinze ans à peine. Son mur qui séparait la ville en deux, obligeant ses habitants à se résigner à vivre d'un côté ou de l'autre, traçait une ligne de démarcation entre deux mondes qui se tournaient le dos. Lors de mon premier séjour à Berlin, je m'étais aussitôt fait conduire au pied de ce mur pour voir enfin l'innommable. Oui, cette chose vue et revue dans les journaux ou à la télévision existait bel et bien dans la réalité. On pouvait même palper de ses mains le béton armé dont elle était faite. Depuis son écroulement, je vais m'incliner sur ses vestiges. Est-ce par nostalgie, par penchant pour la morbidité ou pour entretenir une mémoire défaillante que j'accomplis ce petit rituel, songeais-je à l'arrière du taxi qui m'emmenait vers Check Point Charlie. L'endroit a été conservé intact avec ses baraquements et son mirador. N'y manquent que les vipos et les officiers de la Stasi chargés de filtrer tout passage, opérant à coups de questions directes, de rançons, de tampons et d'invectives. Ce qui représentait le lieu de l'humiliation n'est plus aujourd'hui qu'un décor de cinéma à l'abandon. Quelle mouche a donc piqué nos diplomates, pensai-je, en choisissant comme siège de la nouvelle ambassade belge, l'immeuble de la Stasi dont les caves sont des cachots et dont les murs hurlent encore? Le rapport qualité-prix?
À en juger par le balai incessant de centaines de grues, c'est à Postdammerplatz que sort de terre le Berlin nouveau. Une renaissance sur les hectares de terrain vague de la ligne de démarcation que se disputent les banques, les bureaux, les commerces, les centres d'affaires dessinés par de prestigieux architectes. L'argent prend ici même une éclatante revanche sur quatre décennies perdues. Et les grues dansent! Le taxi me déposa Paolinke Uffer dans le Kreuzberg. Le long du canal, un petit marché et quelques échoppes turques comme nombre d'habitants de ce quartier autrefois. Dieter, mon ami peintre, qui y louait sa maison et son atelier, n'a pu résister à la hausse vertigineuse du marché immobilier. Une plaque de cuivre informait le passant que le numéro 34 était aujourd'hui le siège d'un groupe d'avocats ayant pignon sur rue. Les artistes ont immigré de l'autre côté de ce qui, il y a peu, était encore un mur.
Helsinki

Que faire à Helsinki un soir de mars alors que tout vous dissuade de sortir, la neige, un vent glacial et des rues désertes? Sinon le samedi soir, paraît-il, où les jeunes envahissent bruyamment les bars et les dancings, les habitants de la ville ne se posent même pas la question, calfeutrés dans la chaleur de leurs intérieurs isolés, mangeant du ragoût de renne surgelé ou suant dans leurs saunas brûlants. Vous y avez pensé déjà l'après-midi, recueilli avec eux dans la cathédrale orthodoxe, toute de brique rouge, qui domine l'île de Katajonakka. Leurs chants vous ont même arraché quelques larmes. Des chants surgis tout à la fois de la terre et du ciel. Est-ce la musique encore qui vous aspire de votre hôtel anonyme et conduit vos pas craquant sur la neige durcie vers le Conservatoire illuminé dans cette nuit d'encre? Il s'y passe quelque chose. Vous entrez. On ne vous réclame rien et vous voilà assis au dernier rang de la salle de concert. Sur la scène un orchestre réduit à quelques cuivres, instruments à corde et à vent. Et voilà que surgit un jeune adolescent blond tenant un violon qu'il coince entre le menton et l'épaule. Les yeux fermés, il lance son archet sur les cordes comme s'il partait au combat, porté par une inspiration divine. Et vous reconnaissez aussitôt les premières notes du Concerto pour violon et orchestre en ré mineur de Sibelius. Le hautbois, timide, lui répond puis les cordes. Mais les entend-il, cet enfant, tout absorbé à escalader et à dévaler les gammes, se brûlant aux extrêmes de la musique même? Icare était-il musicien? Vous voilà tour à tour ébloui, transporté, égaré dans les forêts de Finlande, le visage fouetté par la neige et le vent. Un tonnerre d'applaudissements vous ramène sur terre. Vous avez assisté, vous dit-on, incrédule, au dernier exercice des épreuves terminales pour violon du Conservatoire d'Helsinki que Sibelius fréquenta de 1885 à 1889, et que, de nuit comme de jour, il hante encore.
Paris

Est-il une seule ville au monde, fût-elle la capitale d'un État, où convergent, à un tel degré de concentration, le réseau autoroutier et les lignes de chemin de fer? Vous avez ouvert la carte de France et vos yeux ont aussitôt trouvé Paris. Tout y mène, tout y part. N'y aurait-il point de salut hors de Paris? Vous y avez songé alors que, plein d'espoir, vous débarquiez gare du Nord venant de Bruxelles avec votre serviette bourrée d'une quinzaine d'exemplaires du manuscrit de votre premier roman. Autrefois le trajet durait trois heures. Aujourd'hui une heure vingt-cinq suffit. Comme si Paris entendait gober tout ce qui se trouve en dehors d'elle. Vous vous engouffrez dans le métro, direction Porte d'Orléans. Agglutiné dans la rame, vous entendez une voix qui s'élève, celle d'un ex-détenu affamé, père de famille nombreuse et souffrant d'handicaps divers. Elle fait appel à votre générosité. Au mur de chaque station, des publicités géantes vous proposent le bonheur. L'atmosphère est irrespirable et la station Saint-Germain- des-Prés vous apparaît comme une délivrance. Des vitrines exposent photos et textes de Camus, Sartre, Queneau, Prévert, Vian, Gary, Duras… qui animèrent les heures folles du quartier latin. La terrasse des Deux magots est comble. On y sirote un café en lisant son journal ou en griffonnant quelques mots. Peut-être qu'un jour vous-même ferez de ce café votre poste d'observation pour y écrire vos futurs romans. Pourquoi ne pas rêver ? Comme Sartre jadis ou… À moins que ce ne fût au Flore, juste à côté, où, dans une chorégraphie parfaite, des garçons se glissent entre les tables, le plateau à hauteur d'épaule, enregistrent les commandes et présentent des additions pharaoniques à des clients blasés. Mais vous voilà déjà rue Jacob aux éditions du Seuil où la réceptionniste, dans une indifférence totale, prend votre manuscrit qu'elle dépose sur une pile d'autres en vous demandant un peu (beaucoup) de patience pour la réponse. Vous n'êtes hélas pas le seul, a-t-elle conclu. Et puis la rue Sébastien Bottin et les éditions Gallimard, les photos de Sartre et de Camus encore et la mine compatissante de la réceptionniste… Au coin de la rue, un verre s'impose au café de l'Espérance. Et enfin Grasset, Stock, Fayard, Minuit, Flammarion et tous les autres unis dans une polyphonie rythmée par «on vous donnera des nouvelles». Il vous a fallu à peine plus d'une heure pour faire le tour des éditeurs du sixième arrondissement qui, à quelques exceptions près, constituent la liste exhaustive de l'édition littéraire française. Imagine-t-on chose pareille en Allemagne ou en Italie, avez-vous songé, affalé dans le Talys du retour?
Athènes

S'il existe un dieu des artistes, serait-il perfide au point de faire revenir le génial Phidias sur la colline où il passa les plus riches années de sa vie? La cruauté des dieux est légendaire. Le Parthénon dominant la ville s'imposerait à lui dans son évidente beauté. Son volume, ses proportions intactes. Et ses frises, ses chevaux cabrés aux fébriles encolures, surgies de la pierre? Disparues, subtilisées avant d'être entreposées dans une salle du British Museum, aurait-on répondu à sa question incrédule. Et puis, comme il le fit cent fois, mille fois après sa journée de labeur, Phidias marcherait quelques pas, s'arrachant à l'oeuvre qui a requis tout son corps et promènerait songeur son regard vers la ville bruissante à ses pieds, la ville où s'inventèrent la démocratie et le théâtre, où Platon écrivit le mythe de la caverne, où Aristote conçut la théorie des corps en mouvement. La ville qui inventa l'idée même de ville. On l'imagine suffocant, pressant un mouchoir contre sa bouche et ses narines. L'air aux effluves de brise marine, dont il emplissait ses poumons à l'envi, l'a-t-on subtilisé comme ses fresques? À moins que ce ne soient les gaz d'échappement des trois millions de voiture qui engorgent les rues d'Athènes, noircissant les poumons et les pierres? Mais s'agit-il encore de pierre ou de ciment? Et puis la curiosité sans doute le pousserait à se mêler comme jadis à la foule. Et le voilà déambulant incognito dans les rues vibrantes d'Athènes, tantôt effrayé par des marteaux-piqueurs éventrant un trottoir, tantôt amusé par les evzones impassibles accomplissant leur ronde autour du palais présidentiel de Syntagma. On l'imagine sautant dans le tramway tout neuf qui longe la côte, se gaussant de la clientèle branchée de Psirri, dégustant un mezze place Avinissas. Résisterait-il enfin à acheter pour cinq euros dans une échoppe de la promenade Thission, un Parthénon en faux marbre à coller sur son frigo?
Praha

On raconte que le 29 octobre 1787, au Théâtre national de Prague, outre Mozart et Da Ponte, le librettiste, assistait à la création de Don Giovanni, le sublime Casanova qui y reconnut enfin un personnage à sa mesure. On imagine le sourire amusé des trois hommes lorgnant un public atterré par cette énorme gifle aux conventions sociales. Mais la musique qui pardonne tant de choses finit par emporter la réprobation générale. Des parterres au quatrième balcon, ce fut un tonnerre d'applaudissements debout. On imagine la foule sublimée descendant la ville, traversant bourdonnante la Starometské nam, foulant la rue Karlova puis le pont Charles vers Mala Strana, marchant en direction du Château où de généreux mécènes offrent ripailles et libations.
En mars 1922, alors que les fastes de l'Empire austro-hongrois ne sont plus qu'un souvenir, Kafka, miné par la tuberculose, observant le même Château, commence le roman qui portera ce titre, où l'arpenteur K convié en ce lieu pour un travail, n'arrivera jamais à y identifier ni son objet ni son commanditaire. Mais nul mécène pour le soutenir, juste un ami Max Brod qui sauvera ses manuscrits des flammes. Songe-t-il encore à Milena, son amour inatteignable, avec qui, un an plus tôt, il a interrompu sa correspondance passionnée? Lui qui, redoutant la brûlure de l'amour, a fui chaque femme qui s'éprenait de lui, était aux antipodes de Don Juan. Il écrit, à bout de force. Deux ans plus tard son corps reposera au nouveau cimetière juif de Strachnitz.
Rappelle-toi Prague, notre premier rendez-vous amoureux, nous y avons visité la villa Betramka, maison de Mozart dans le quartier vert de Smichov et le numéro 2 d'Altstäder Ring où vécut Kafka, sans penser qu'entre les deux demeures, il y avait un océan de distance.
Dublin

Sous le Ha'penny Bridge coule la Liffey river. Dans les neuf cent pubs de Dublin à flots coule la Guiness. Le débit de l'eau du fleuve se compare au débit des pompes à bière, la Black Stuff que brasse, au sud de la Liffey, la géante Guiness Hopstore dont les effluves de bière embaument le centre de la ville par vent favorable. Comme naguère les usines Côte d'Or répandaient sur Bruxelles-Midi leur bienfaisante odeur de chocolat noir. L'âme de Dublin est dans ses pubs où le visiteur, même allergique à la bière noire, finit toujours par se retrouver, fuyant «l'hiver perpétuel». Le vent et la pluie vous poussent dans le pub, la chaleur vous y aspire et spontanément vous vous mêlez aux bavardages, aux chansons et aux claquettes. Ici la vraie vie est dans les pubs. Joyce reconnaîtrait-il le Davey Byrne où il avait ses habitudes? Pas sûr. Vous préférez le Brazen Head, loin de l'agitation du centre, ce vieil estaminet sombre au plafond bas où l'on devine ce que l'on boit.
Glaciales, par contre, les geôles de la prison de Kilmainham Goal. Vous ne connaissez aucune ville qui ouvre au regard du visiteur sa prison vide depuis 1924. Elle se dresse dans sa froideur comme un monument aux morts, un mémorial du martyr irlandais. Autour de la galerie centrale, les cellules alignées sur trois étages comme les cabines des anciennes piscines. Vous avez une pensée émue pour les cent quarante prisonniers, politiques pour la plupart, qui y furent pendus ou fusillés. Parmi eux, les héros qui ont nom Patrick Pearse, Joseph Plunkett qui y épousa même Grace Gifford juste avant d'être exécuté. La légende ne dit pas si, à la cigarette du condamné, il préféra une dernière Black Stuff.
Nicosie

Il existe un aéroport dont l'unique activité visible est la pratique du golf. C'est l'aéroport international de Nicosie où les soldats britanniques de la force dite d'interposition des Nations Unies trompent leur ennui en y jouant au golf. Aucun risque de perturbation des joueurs : cela fait trente ans que plus un avion ne se risque à atterrir sur ce tarmac éventré. Trente ans que plus un passager ne franchit les portes du terminal ouvert à tous les vents. Seul un triréacteur Trident de la Cyprus Airways, esquinté par les balles perdues d'un bombardement, semble avoir été oublié là par les belligérants. Qu'attend-il au juste? L'arrivée de passagers improbables? La réouverture de l'aéroport situé en pleine ligne de démarcation? La réunification de l'île? Survolera-t-il à nouveau un jour les montagnes de Kirenia qui surplombent la ville, cet oiseau aux ailes meurtries ou finira-t-il ses jours concassé dans un fracas de ferraille? À moins que, immobilisé au sol, il s'éternise là en bout de piste comme un défi au temps et à la bêtise des hommes. Même les soldats britanniques ne remarquent plus sa présence sauf lorsqu'ils retrouvent en pestant une balle de golf égarée sous son fuselage. Ce sont eux aussi qui, chaque jour au pied de leur mirador, arrosent l'herbe de la ligne verte qui sépare les deux zones belligérantes entre les bastions Roccas et Mula. Depuis longtemps, ils ont jugé ce gazon impropre à la pratique du golf car, disent-ils, récupérer une balle perdue dans des fils de fer barbelés n'est pas une mince affaire. Par contre, au-delà de Mula vers Quirini, le fossé est un no man's land qui sert de terrain de football. Mais les militaires préfèrent résolument le golf.
Madrid

Assis à l'entrée de la salle centrale du rez-de-chaussée, un gardien du Musée du Prado somnole. Comme chaque jour, la foule s'y presse pour contempler Les Menines de Velázquez. Il a entendu dire que certains visiteurs faisaient le voyage de Madrid pour ce seul tableau. Vous vous rendez compte? De Paris, de Berlin, de Londres, de Tokyo, oui de Tokyo, pour un seul tableau qui constitue le décor de son lieu de travail. Il le connaît par coeur. Même les yeux fermés, il voit et revoit la scène qu'il représente : au centre, l'infante Marguerite entourée de deux dames d'honneur, la première faisant la révérence, la seconde lui offrant à boire. À droite, une naine et, devant elle, un nain qui pose le pied sur l'échine d'un dogue assis sur le plancher. Dans le fond, observant la scène, le maréchal du palais se tient dans l'embrasure de la porte éclairée. À l'avant plan à gauche, une toile retournée posée sur un chevalet qu'est en train de peindre Velázquez lui-même, le pinceau et la palette à la main. Que peint-il au juste? Le gardien ne s'est jamais posé la question. L'infante peut-être, rayonnante dans sa robe blanche ornée de rosettes rouges et de dentelles noires. Ou l'éclat transparent de son visage? Ou encore la scène entière? À moins que ce ne soit Philippe IV et la reine Marie-Anne que reflète le miroir brillant accroché au mur sombre auquel le peintre tourne le dos. Tous les regards, en effet, convergent vers ce même point où, hors champ, semble poser le couple royal. Le gardien a eu le temps de passer toutes ces hypothèses en revue. Et si, en définitive, le spectateur lui-même se trouvait convoqué par le peintre au centre de la scène? Velázquez ne ferait rien d'autre que peindre celui qui le regarde. D'où cette cohue quotidienne rivée à cette toile non pas pour la contempler mais pour en faire partie. Figurer sur un Velázquez mérite bien un petit voyage fût-ce de Paris, Londres, Berlin ou Tokyo. Et le gardien se sent à son tour aspiré dans la toile par tous les regards qui convergent vers lui. Oui, c'est bien lui que Velázquez peint et repeint sans relâche depuis 1656. Et n'est-ce pas son portrait qui se dissimule ça et là parmi les tableaux innombrables accrochés aux murs de cette salle transformée en atelier du peintre? Juste retour des choses, au fond, car sans gardiens, il n'y aurait pas de musées et sans musées que subsisterait-il de la peinture ?
Luxembourg
Egon Jux, né en 1927, est l'architecte du pont Grande-Duchesse Charlotte, appelé communément le Pont rouge en raison de sa couleur. Long de trois cent cinquante-cinq mètres, il relie le haut de la ville de Luxembourg et le quartier européen de Kirchberg. Lors de son inauguration en 1963, Egon Jux parla de fiançailles entre l'Europe et le Luxembourg, de trait d'union entre l'ancien et le nouveau. Le pont relie le boulevard Robert Schuman et l'avenue John F. Kennedy, tout un programme. Quarante ans plus tard, «l'élégance et la simplicité radicale de la construction» en font toujours un symbole de la modernité, proclame la brochure de l'office du tourisme. D'une hauteur de septante-quatre mètres, le Pont rouge enjambe l'Alzette et le quartier de Plaffenthal. En 1991, la cinéaste luxembourgeoise Geneviève Mersch, tournant un film dans ce quartier, fut frappée par l'atmosphère d'angoisse et de peur qui y régnait. Certains habitants n'arrivaient plus à trouver le sommeil, d'autres, éplorés, levaient la tête dès qu'ils passaient sous le pont. Engageant la conversation avec l'un deux qui réparait son toit éventré, elle comprit que la chute d'un corps humain était la cause de ce trou béant. Plus d'une centaine de personnes, apprit-elle, avaient choisi le Pont rouge pour se suicider, atterrissant, septante-quatre mètres plus bas, tantôt sur le toit d'une maison, tantôt sur un trottoir, dans un jardin ou un bac à sable d'enfants. Le suicide, signe des temps, est lui aussi au coeur de la modernité. Ainsi, plutôt qu'entre le Luxembourg et l'Europe ou entre Schuman et Kennedy, le Pont Grande-Duchesse Charlotte serait le trait d'union entre les vivants et les morts, entre ceux d'en bas qui tentent de vivre et ceux d'en haut qui y renoncent. Après la diffusion du film, les autorités de la ville ont doté le pont d'un système de protection empêchant les candidats au suicide d'enjamber la rampe. Mais les habitants de Plaffenthal continuent à ne dormir que d'un oeil.
Bruxelles

Assis à la terrasse du café, nous devisions sans but, jouissant des ultimes rayons de l'été indien. À quelques mètres de nous, le canal qui traverse le nord de la ville, reliant Willebroek et Charleroi, fit naître en nous le sentiment du fleuve. Rêvions-nous de la Seine, du Danube, du Tibre, de la Daugava, de la Tamise, du Tage? Ou plutôt de la Liffey River en buvant notre Guiness? Sous nos pieds, enfoui dans la terre, nous devinions le flux de la Senne qui jadis arrosait Bruxelles et qu'en d'autres temps des despotes inconscients décidèrent de murer pour de prétendues questions d'hygiène. Une rivière coulant sous terre, se frayant un passage parmi des ramifications d'égouts, de canalisations géantes et de bassins d'orage, de vestiges de ruelles anciennes et de parkings irrespirables, composait la géographie souterraine et lacustre de la ville. Le bruit sourd des voitures plongeant dans le tunnel Léopold II pour en ressortir derrière la Basilique de Koekelberg en direction de la mer, question de changer d'air, donnait à penser que Bruxelles n'était qu'un iceberg flottant dont la face visible semblait dérisoire au regard des profondeurs immergées. Dans l'inconscient de la ville sommeillaient des taupes.
Derrière le canal, deux immeubles jumeaux, de construction récente avaient absorbé dans leurs flancs les façades en pierre des maisons de maître dont ils avaient pris la place. Les promoteurs avaient réussi le tour de force de concilier dans ces constructions deux actes antagonistes : détruire et conserver. Cette architecture de l'apparence, du trompe-l'oeil, qui perturbait les codes, brouillait nos points de repère, n'était-elle pas à l'image même de la Belgique, avons-nous songé, dont la survie même repose sur le compromis absolu?
Copyright © Jean-Luc Outers, 2005.
|