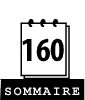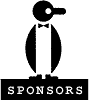|








|
|
LE JOUR, PAS SI LOINTAIN, OÙ J'AI ASSISTÉ À LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Lorsque, le 30 juin 2002, sur le coup de vingt-deux heures, Pierluigi Collina a mis un terme à la rencontre qui opposait le Brésil à l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde de football, je me suis dressé dans les tribunes à l'unisson de mes voisins et j'ai levé les bras au ciel. À l'étroit sur mon strapontin de la tribune Nord depuis le début du match, j'avais suivi la rencontre entre un couple hispanophone entre deux âges et deux jeunes gens ténébreux au physique du sous-continent indien, râblés et baraqués, torses nus sous des débardeurs blancs échancrés (on idéalise parfois trop ces finales mythiques), partagé entre mon enthousiasme éclairé pour le jeu brésilien et ma légitime tendresse pour la cause européenne. Sur la pelouse, déjà envahie de photographes et d'officiels qui couraient en tous sens, d'Allemands abattus et de Brésiliens euphoriques qui priaient sur le sol en agitant des drapeaux, des nuées de volontaires japonais vêtus de combinaisons vertes dressaient à la hâte une estrade improvisée, et, lorsque Cafu, le capitaine brésilien, s'empara du trophée et le brandit devant la foule, une immense clameur retentit dans le stade, accompagnée d'une pluie de paillettes et d'un bouillonnement de fumigènes tirés par des canons d'argent, tandis que, dans les tribunes, un déluge de paperolles multicolores tombait soudain des cintres et inondait les gradins où chacun, debout et applaudissant, levait les bras pour les dévier, les attraper au vol ou les recueillir entre ses mains. J'ai maintenant, à la maison, comme reliques de la finale, trois de ses papiers japonais, auxquels je donnerais volontiers le nom proustien de paperolles, que j'ai choisis avec soin aux couleurs du Brésil : jaune, vert et bleu.
En quittant le stade, tandis que je longeais dans la nuit noire la massive silhouette de l'immense édifice de béton, un crachin désagréable se mit à tomber, d'abord léger, puis de plus en plus soutenu. M'arrêtant un instant dans les allées, j'ouvris mon sac à dos et en sortis un imperméable transparent, qui n'avait encore jamais quitté son emballage d'origine. J'en avais fait l'acquisition à Kobe deux semaines plus tôt, quelques heures avant le match Brésil-Belgique, craignant quelque averse tropicale qui m'eût trempé jusqu'aux os à l'improviste, et je l'emportais désormais avec moi à chaque match, n'ayant pas encore eu l'occasion de m'en servir. C'était un modèle en plastique transparent, légèrement opaque, qui me recouvrait intégralement, de la tête aux pieds. Je le passai par-dessus mes vêtements, et, ainsi recouvert d'une fine couche de plastique transparent sur lequel les gouttelettes de pluie s'accumulaient comme une rosée, je me remis en route dans la nuit, suivant la foule lente et docile qui serpentait entre deux haies de stewards et de policiers qui nous indiquaient le chemin dans l'obscurité du bout de leurs matraques fluorescentes, eux aussi recouverts de toute une panoplie de tenues imperméables ruisselantes. C'était un étrange cortège qui avançait ainsi en silence sous la pluie en direction du métro dans la nuit chaude et humide de Yokohama, balayée de temps à autre par les lueurs jaunes de quelques phares de taxis ou d'autocars qui manœuvraient au loin pour quitter les parkings. Arrivés au pied de la station de métro surélevée de Kozukue, nous dûmes ralentir, bloqués par un cordon de policiers, et fîmes du sur-place pendant quelques minutes devant le goulot d'étranglement de l'unique entrée, les policiers ne nous laissant gagner les escalators que par vagues successives. En haut des escaliers, dans la station de métro où la foule se pressait aux guichets et égouttait ses parapluies dans une touffeur moite de bains publics, je me mis à avancer d'un pas gauche dans ma tenue intégrale en plastique transparent aux allures de combinaison post-Tchernobyl, quand, jetant un regard circulaire dans le hall, je reconnus là, à trois mètres de moi, adossé à un mur près des guichets, mon ami Romano Tommasini, violoniste à l'orchestre philharmonique de Berlin, que je n'avais pas vu depuis deux ans et qui regardait passer la foule les yeux dans le vague. Avançant vers lui à grands pas, encore tout empêtré dans ma tenue en plastique dégoulinante, je me jetai dans ses bras (en espérant que c'était bien lui, et non quelque type qui attendait là tranquillement), ravi et incrédule, comme dans une scène de retrouvailles d'une comédie italienne. Romano ! m'écriai-je en lui donnant l'accolade. Nous en étions encore à nous émerveiller du hasard qui nous avait fait nous retrouver dans une foule de quatre-vingt mille personnes, quand un monsieur japonais, qui semblait chercher son chemin, s'approcha prudemment et, s'adressant à moi, me dit à voix basse en français : Bonjour Monsieur, j'étais à votre conférence hier soir, c'est moi qui vous ai posé une question, vous vous souvenez?
Copyright © Jean-Philippe Toussaint, 2002
|