
|
|
POSITION DU SUJET ET POLITIQUE DU CORPS DANS LES CHANTS DE MALDOROR
PAR PASCAL DURAND
« Vieil océan, tu es le symbole de l’identité : toujours égal à toi-même » [I, 9][1]. Parmi les propriétés que Lautréamont/Ducasse attribue au « vieil océan », l’égalité et l’identité à soi constituent probablement les plus saisissantes au regard fort contradictoire de la machinerie énonciative des Chants et des métamorphoses à répétition dont le narrateur et ses avatars fictionnels font l’objet. Mon intention n’est pas de dresser à mon tour le tableau de ces métamorphoses ni d’établir une fois de plus que celles-ci constituent, selon une logique évidemment réversible, l’expression thématique des distorsions de toute sorte qui affectent le sujet de l’énonciation dans l’œuvre signée ou non Isidore Ducasse. D’autres l’ont fait excellemment, et il n’y a plus sans doute à y revenir. Mon intention est ailleurs : elle est, pour commencer, d’interroger à nouveaux frais la signification et la portée de cette diffraction du sujet telle qu’elle s’inscrit dans l’histoire du discours lyrique au dix-neuvième siècle. Convenons d’appeler « sujet » non pas le « moi » personnel de l’écrivain, mais l’instance subjective plus ou moins fictive qui parle dans l’œuvre et s’y trouve éventuellement représentée, en regard d’une autre instance subjective, interlocutrice ou muette, inscription formelle celle-ci, au sein du système expressif de l’œuvre, d’un lecteur idéal[2].
Je rêvais que j’étais entré dans le corps d’un pourceau, qu’il ne m’était pas facile d’en sortir, et que je vautrais mes poils dans les marécages les plus fangeux. Était-ce comme une récompense ? Objet de mes vœux, je n’appartenais plus à l’humanité ! Pour moi, j’entendis l’interprétation ainsi, et j’en éprouvai une joie plus que profonde. Cependant, je recherchais activement quel acte de vertu j’avais accompli pour mériter, de la part de la Providence, cette insigne faveur. […] La métamorphose ne parut jamais à mes yeux que comme le haut et magnanime retentissement d’un bonheur parfait, que j’attendais depuis longtemps. Il était enfin venu le jour où je fus un pourceau ! J’essayai mes dents sur l’écorce des arbres ; mon groin, je le contemplais avec délice. Il ne restait plus la moindre parcelle de divinité : je sus élever mon âme jusqu’à l’excessive hauteur de cette volupté ineffable. Écoutez-moi donc, et ne rougissez pas, inépuisables caricature du beau qui prenez au sérieux le braiement risible de votre âme, souverainement méprisable ; et qui ne comprenez pas pourquoi le Tout-Puissant, dans un rare moment de bouffonnerie excellente, qui, certainement, ne dépassé pas les grandes lois générales du grotesque, prit, un jour, le mirifique plaisir de faire habiter une planète par des êtres singuliers et microscopiques, qu’on appelle humains, et dont la matière ressemble à celle du corail vermeil. Certes, vous avez raison de rougir, os et graisse, mais écoutez-moi. Je n’invoque pas votre intelligence ; vous la feriez rejeter du sang par l’horreur qu’elle vous témoigne : oubliez-là, et soyez conséquents avec vous-mêmes… Là, plus de contraintes. Quand je voulais tuer, je tuais ; cela, même, m’arrivait souvent, et personne ne m’en empêchait. Les lois humaines me poursuivaient encore de leur vengeance, quoique je n’attaquasse pas la race que j’avais abandonnée si tranquillement ; mais ma conscience ne me faisait aucun reproche » [IV, 6]. C’est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant » [IV, 1]. Oh ! si au lieu d’être un enfer, l’univers n’avait été qu’un céleste anus immense, regardez le geste que je fais du côté de mon bas-ventre : oui, j’aurais enfoncé ma verge, à travers son sphincter sanglant, fracassant, par mes mouvements impétueux, les propres parois de son bassin ! Le malheur n’aurait pas alors soufflé, sur mes yeux aveuglés, des dunes entières de sable mouvant ; j’aurais découvert l’endroit souterrain où gît la vérité endormie, et les fleuves de mon sperme visqueux auraient trouvé de la sorte un océan où se précipiter ! [V, 5] Deuxième observation : ces perversions qui se relaient avec une insistance réjouissante ont ceci de particulier qu’elles visent toutes à ébranler, non pas tant l’ordre sexuel et l’ordre moral, que l’ordre social qui les sous-tend, en mettant en jeu une subversion sans reste des institutions, des appareils idéologiques autant que des appareils répressifs d’État, pour parler une langue un peu oubliée. La famille d’abord, cellule, dans les Chants, de toutes les tortures. Ainsi de l’homme pendu à un gibet, au quatrième chant, que son épouse et sa mère viennent couvrir de goudron avant de le flageller [IV, 3], ou de ce fils, dans le même chant, enfermé « pendant quinze ans, dans un cachot, avec des larves et de l’eau fangeuse pour toute nourriture » : « Je ne te raconterai pas en détail, dit-il à Maldoror, les tourments inouïs que j’ai éprouvés, dans cette longue séquestration injuste. Quelquefois, dans un moment de la journée, un des trois bourreaux, à tour de rôle [son père, sa mère ou son frère jumeau], entrait brusquement, chargé de pinces, de tenailles et de divers instruments de supplice. Les cris que m’arrachaient les tortures les laissaient inébranlables ; la perte abondante de mon sang les faisait sourire » [IV, 7]. Famille qui, en cela cellule sociale de base, est le lieu, aussi bien, de l’habituation aux rapports de force (le père paternaliste, la mère servilement maternelle, le fils et la fille sournoisement filiaux). « J’ai fait un pacte avec la prostitution afin de semer le désordre dans les familles » [I, 7], écrit Lautréamont au premier chant, livrant ainsi l’une des clés probables de toute son entreprise. Autre institution ébranlée : la religion. Inutile de dévider la longue litanie des imprécations adressées au « Céleste Bandit », au « Grand Objet Extérieur » [V, 3], au « Tout-Puissant » surpris au lupanar [III, 5], comme à autant de figures suprêmes de la Loi, dont Maldoror aspire à éradiquer en lui toute trace au fil de transformations qui peuvent passer, on l’a vu, comme les essais successifs d’un corps cherchant à se délester du poids intérieur de l’âme afin d’atteindre à une complète « autonomie ». Dieu du nomothéisme bien plus encore que du monothéisme, le Dieu sans nom de Ducasse n’a pas d’autre fonction que de représenter cette Loi, qui ailleurs peut prendre la figure du pater familias, sinon celle de l’auteur aux commandes du texte ; car, derrière le Créateur de toutes choses, qu’il doit bien postuler et maintenir pour pouvoir le défier et le tenir en échec, c’est encore l’effigie du créateur littéraire, cette créature de la littérature, que Lautréamont met en cause, et vice versa[10]. Inutile aussi de rappeler les invectives accablant le « prêtre des religions » [V, 6], appellation englobante, extensive, mettant dans le même sac les crédulités de toute obédience et les échafaudages symboliques dont l’homme, cet infirme, se dote comme d’autant de béquilles[11]. Dans ce jeu de massacre, la police, donnée pour le « bouclier de la civilisation[12] » [VI, 2], n’est pas en reste, non plus que l’école, instance de toutes les inculcations et de tous les abrutissements (les Poésies le rediront avec la plus grande force). L’institution littéraire n’en sort pas non plus indemne, dont les genres, les codes rhétoriques et les contrats de lecture se trouvent à tout moment bafoués et traînés dans le ridicule – c’est-à-dire montrés dans l’arbitraire ordinairement masqué sur lequel se fonde leur pouvoir de séduction et de vraisemblance. L’hypertrophie, la surexposition des perversions sexuelles vaudrait ainsi, dans les Chants, en tant que symbole turgescent d’une révolte dressée contre toutes les forces de répression qui, quel que soit le registre dans lequel cette répression agit, s’exercent comme répression du désir, assujettissement du possible et du désirable à un petit nombre de possibilités reçues, acceptées, conformes. « Législateurs d’institutions stupides, inventeurs d’une morale étroite, s’écrie encore Maldoror, éloignez-vous de moi, car je suis une âme impartiale » [V, 5]. La vitalité se répandra magnifiquement dans le torrent de leur appareil circulatoire, et vous verrez comme vous serez étonné vous-même de rencontrer, là où d’abord vous n’aviez cru voir que des entités vagues appartenant au domaine de la spéculation pure, d’une part, l’organisme corporel avec ses ramifications de nerfs et ses membranes muqueuses, de l’autre, le principe spirituel qui préside aux fonctions physiologiques de la chair[VI, 1]. Ces figures médicales affectent également, parmi d’autres zones rhétogènes du texte Maldoror, deux des chaînes comparatives de ce sixième chant : [Mervyn] est beau […] comme l’incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure [VI, 3]. Ces mêmes figures touchent enfin au rapport de médecin à patient que le texte établit entre son scripteur et son lecteur, au sujet duquel le premier formule un diagnostic avant de lui ordonner un régime adéquat et de lui prescrire des « potions » mélangeant rationalité médicale moderne et formules de rebouteux : Sois persuadé que l’habitude est nécessaire en tout ; et, puisque la répulsion instinctive, qui s’était déclarée dès les premières pages, a notablement diminué de profondeur, en raison inverse de l’application à la lecture, comme un furoncle qu’on incise, il faut espérer, quoique ta tête soit encore malade, que ta guérison ne tardera pas à rentrer dans sa dernière période. Pour moi, il est indubitable que tu vogues déjà en pleine convalescence ; cependant, ta figure est restée bien maigre, hélas ! Mais… courage ! il y a en toi un esprit peu commun, je t’aime, et je ne désespère pas de ta complète délivrance, pourvu que tu absorbes quelques substances médicamenteuses ; qui ne feront que hâter la disparition des derniers symptômes du mal. Comme nourriture astringente et tonique, tu arracheras d’abord les bras de ta mère (si elle existe encore), tu les dépèceras en petits morceaux, et tu les mangeras ensuite, en un seul jour, sans qu’aucun trait de ta figure ne trahisse ton émotion. Si ta mère était trop vieille, choisis un autre sujet chirurgique, plus jeune et plus frais, sur lequel la rugine aura prise, et dont les os tarsiens, quand il marche, prennent aisément un point d’appui pour faire la bascule : ta sœur, par exemple. […] La potion la plus lénitive que je te conseille, est un bassin, plein d’un pus blennorragique à noyaux, dans lequel on aura préalablement dissous un kyste pileux de l’ovaire, un chancre folliculaire, un prépuce enflammé, renversé en arrière du gland par un paraphimosis, et trois limaces rouges. Si tu suis mes ordonnances, ma poésie te recevra à bras ouverts, comme quand un pou résèque, avec ses baisers, la racine d’un cheveu [V, 1]. À quelle fonction, autre que parodique ou décorative, répondent cette physiologie délirante et cette pharmacopée rhétorique ? À inscrire dans le texte, me semble-t-il, un sas entre les deux strates de représentation que j’ai évoquées, par où passe également, dans l’hypothèse que je fais mienne, l’une des composantes politiques des Chants de Maldoror. Ce lieu de passage est ménagé, au sein du savoir médical recyclé, par une référence récurrente, directe ou indirectement parodique, aux prescriptions du discours hygiéniste, qui sous le Second Empire, en un siècle de « propreté conquérante[13] », a opéré sa montée en force, à travers toute une propagande assurée par la médecine de proximité et nombre de publications spécifiques, Le Médecin de la famille ou encore les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, vecteurs d’une propagande orientée vers le quadrillage d’un corps à protéger des contaminations qu’il peut subir comme des épidémies dont il peut être la source, au nom d’une morale sociale avançant masquée et visant, en particulier dans les classes laborieuses où régneraient « saleté et infection », à « faire intérioriser des normes qui […] soumettront [ces classes] aux représentations et aux comportements dominants (hygiène, sobriété, sédentarité, ordre, familialisme, épargne, etc.)[14] ». Quand le pied glisse sur une grenouille, l’on sent une sensation de dégoût ; mais, quand on effleure, à peine, le corps humain, avec la main, la peau se fend, comme les écailles d’un bloc de mica qu’on brise à coup de marteau [IV, 1]. Et mieux encore, ironie comprise, dans cette interpellation du chant premier, articulant prescription hygiénique et recommandation entre criminels : Que tu sois un criminel, qui n’a pas eu la précaution de laver sa main droite, après du savon, après avoir commis son forfait, et facile à reconnaître par l’inspection de cette main » [I, 12]. Mais, sous un autre aspect, il convient de lire les Chants comme célébration du corps réagissant à l’hygiénisme ambiant et aux prescriptions sociales que celui-ci enveloppe. D’où une revendication provocante de la crasse : Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l’eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon, aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n’ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent, jusqu’à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie d’ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, et qui n’est plus de la chair. Cependant mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre (je n’ose pas dire corps) ne le nourrissaient abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et, quand l’un deux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu’il ne s’en échappe un, et ne vienne gratter, avec sa bouche, le dedans de votre oreille : il serait ensuite capable d’entrer dans votre cerveau [IV, 5]. De là, aussi bien, « l’acarus sarcopte qui produit la gale » compté, avec le « vampire », au nombre des « deux amis » du lecteur [I, 14], ainsi que tel salut adressé au pou et à la saleté qui contribue à sa reproduction : Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi, l’ennemi invisible de l’homme. Continue de dire à la saleté de s’unir avec lui dans des embrassements impurs, et de lui jurer, par des serments, qu’elle restera son amante fidèle jusqu’à l’éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique, en mémoire des services importants qu’elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l’homme, avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent [II, 9]. De là encore, en apogée de cette « glorification » de « l’invisible ennemi de l’homme », objet de toutes les obsessions hygiénistes du siècle, cette « mine de poux » dans lequel Maldoror, sorte de précurseur du bio-terrorisme, puise à grandes pelletées pour en infester les cités humaines : Pour moi, s’il m’est permis d’ajouter quelques mots à cet hymne de glorification, je dirai que j’ai fait construire une fosse, de quarante lieues carrées, et d’une profondeur relative. C’est là que gît, dans sa virginité immonde, une mine vivante de poux. […] Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j’extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux, grands comme des montagnes, je les brise à coups de hache et je les transporte, pendant la nuit profonde, dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme aux premiers jours de leur formation dans les galeries tortueuses de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier, et se répandent en ruisseaux dans les habitations, comme des esprits nuisibles [II, 9]. De là, enfin, dans l’hymne aux « pédérastes incompréhensibles », cet ironique attelage entre une prescription hygiéniste (dans sa banalité comme avec sa rhétorique moralisatrice) et une célébration de la fellation homosexuelle : Il a fallu que j’entrouvrisse vos jambes pour vous connaître et que ma bouche se suspendît aux insignes de votre pudeur. Mais (chose importante à représenter) n’oubliez pas chaque jour de laver la peau de vos parties, avec de l’eau chaude, car, sinon, des chancres vénériens pousseraient infailliblement sur les commissures fendues de mes lèvres inassouvies [V, 5]. Le retournement parodique délivre ici le même message qu’ailleurs l’hyperbole apparemment conséquente avec l’idéologie sanitaire[15] : entre ordre social et ordre sexuel, le discours médical pour les familles a été le grand passeur de frontières. Par lui, la morale dominante s’est emparée du corps sous couvert de salubrité publique pour le surveiller, et à travers lui en effet les pratiques sexuelles mais aussi les comportements sociaux, de la famille à l’usine et de l’usine à ce qu’on appelait déjà « la rue ». Les classes laborieuses sont dangereuses parce qu’elles entretiennent, dans le fantasme bourgeois, un rapport d’immédiateté animale avec le corps, de même que les concentrations ouvrières dans les grandes villes, où la proximité des corps excite les passions de toute sorte, sont apparues comme des centres d’infection à la fois physiologique et politique. Rappelons-nous, dans le même ordre d’idées, les métaphores hygiénistes dont s’est soutenue l’hausmannisation de Paris : abattre les logements insalubres, éradiquer les quartiers populaires, c’était, au prétexte d’urbanisme et d’hygiène publique, réduire autant des zones de contamination ou de misère sociale que des foyers d’émeute, et tenter de renvoyer au passé le rouge péril des barricades et des révolutions. NOTES [1] Lautréamont, Les Chants de Maldoror et autres textes, éd. Steinmetz, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de poche », 2001, p. 99. Pour les références aux Chants de Maldoror, on donnera entre crochets, dans la suite, le chant en chiffres romains et la strophe en chiffres arabes. Copyright © Pascal Durand, 2008. |
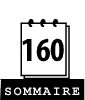   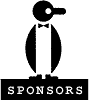  |
