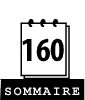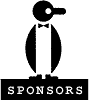|







|
|
LE MONSTRUEUX VRAISEMBLABLE
PAR STÉPHANE LAMBERT
Le grand mérite de Goya consiste à créer le monstrueux vraisemblable.
Charles Baudelaire
PROLOGUE

Scènes de la vie ordinaire. Il y a parmi les cartons de tapisserie conservés au deuxième étage du Prado, sous la candeur de la représentation de la vie rurale, quelques indices de ce qu'entrevoyait déjà le regard de Goya, avant l'irruption de la maladie, peut-être alors encore inconsciemment, derrière la manifestation de la joie, les plaisirs qu'offrait le jeu, la simplicité de la détente et de l'amusement, la bonhomie de l'ivresse. Les enfants ont des tailles bien trop disproportionnées pour que l'on croie encore à leur innocence. Les sourires sont des fêlures qui ouvrent la porte d'autres mondes, enténébrés. Les masques révèlent plus qu'ils ne dissimulent : la comédie carnavalesque donne l'occasion d'aveux sincères. Le pinceau semble guider par l'ironie lorsqu'il compose ces doux tableaux. Car hélas! nous ne pouvons être dupes de la fausseté du décor et des bons sentiments – toute la littérature nous a déjà mis en garde contre la vilenie des hommes, et il faut croire ces écrits qui sont rien moins que le compte rendu de l'expérience humaine. Dans la tiédeur du climat germe la violence, il y a une autre image sous la mièvrerie, qui attend de saisir le peintre à la gorge, et que nous ne pouvons nous empêcher, nous qui avons déjà connaissance de ce qui va suivre, de lire, à travers un ciel là-bas qui s'obscurcit, un regard de femme qui se perd dans le vide avant de s'assombrir, la morphologie d'un visage en mutation, l'espièglerie redoutable de jeunes filles faisant sauter un pantin sur un drap tendu. Ou la lumière jaune oranger en cette fin du jour de L'été (1786-1787), comme un parfum d'enfer naissant, un poison en distillation. Les remparts d'une ville laissés au loin, la moisson s'amoncelle en une montagne de bottes de foin. La nuit s'avance derrière la besogne, la fatigue libère les instincts, bientôt il n'y aura plus de témoins. Rien ne filtre encore directement de la débauche en cours. Mais tout en indique le chemin. Les torses dénudés des paysans, la diablerie des enfants, l'affection d'un père pour sa fillette, la petite main jouant imprudemment avec la bouche paternelle, la caresse du blé, la langueur, laissent entrevoir la lascivité et l'inceste sous-jacents. Pour l'heure, on se prélasse. On rigole. L'alcool fait apparaître les premiers signes de l'excitation. Les regards changent, se chargent d'une étrange lueur de mauvaiseté. La proximité des bêtes sème la confusion. Un cheval blanc, sorte de licorne qui aurait perdu son appendice, tourne le dos à la scène comme un reniement de la pureté. Dans la lignée d'un Breughel, la jovialité n'est pas loin du terrible. La bonté du peuple a des accents de veulerie. Ne pas oublier : la corrida est une fête à l'issue fatale, on y passe du rire au sang. Paraphrasons Baudelaire qui, devant l'extraordinaire «tohu-bohu» des Caprices, notait que le point de suture entre le réel et le fantastique était impossible à saisir chez Goya tant ces faces bestiales étaient imprégnées d'humanité ; c'est ici le contraire : les postures humaines annoncent leur bestialité. Le travail de sape du peintre est en marche malgré lui, comme si des microbes avaient pris d'assaut la représentation de la réalité pour en corrompre toute volonté d'idéalisation à la racine.
On ne peut nier que les «peintures noires» de Goya se dressent comme un sombre flambeau dans l'espace altéré de notre vue. Désormais, il sera impossible, en se penchant sur n'importe quelle autre œuvre de l'artiste — sur n'importe quelle autre œuvre de n'importe quel autre artiste — de limiter la portée de leur contagion. Regarder une œuvre de Goya reviendrait à faire l'amour dans une chambre funèbre. Imaginez le goût de l'étreinte. Les gestes de la lutte ont les mêmes intonations que ceux de l'enlacement. L'élan est festif, mais il est rattrapé en cours de route par des démons dont on ignorait l'existence et qui étaient pourtant bel et bien à nos trousses dès le début de la course. Traversant le Prado depuis l'entrée Jerónimos, l'on emprunte l'escalier médian menant à la galerie centrale pour se diriger vers les salles 36, 37 et 38, les black rooms telles que nous pourrions les surnommer. Sur notre passage, on ne peut rien observer sans chercher une trace, un signe avant-coureur des «Noires», car c'est pour elles que nous sommes venus, c'est pour elles que nous sommes là, mêlés au mouvement des groupes de visiteurs dans ces grandes allées du musée national. L'impressionnant Christ en croix (1780) interrompt notre marche. Le contraste saisissant de la chair pâlie et lumineuse avec le fond si sombre du tableau, empreinte de Velásquez, nous rappelle que c'est sur la beauté d'un mort que nous nous extasions. Plus tard, la confrontation à une reproduction du visage du Christ nous rapprochera des traits figés dans l'expression de la douleur. Les yeux levés au ciel, la bouche entrouverte sur une parole imprononçable, interrogeant ou implorant celui auquel il est lié et dont nul ne sait le nom. La jeunesse aguicheuse et nue de Jean Baptiste dans le désert (1808-1812) me fait alors revenir sur mes pas. Alors que le corps de l'adolescent ne peut me laisser insensible, quelque chose de son histoire s'interpose dans le déploiement du fantasme. Le drôle de mélange du charme innocent du modèle au destin du sujet qu'il incarne rompt le processus naturel du désir. L'incognito de l'icône s'est corrompu dans la liturgie. L'image de la future décollation se superpose à celle de la sensualité juvénile. Le regard du chasseur sur ses trophées sait la cruauté de son divertissement de même que le peintre connaît la noirceur du sublime. L'on sent une compassion spontanée de Goya à l'égard des animaux qu'il tue, il faut le dire, avec bonheur. Pas de regret, mais la simple illustration de la dimension sacrée de son geste. Ainsi le plaisir porte en lui sa contrainte sous forme d'inéluctabilité. Dans la mise en scène des bêtes mortes ou piégées, Goya n'est plus le chasseur, mais un regard adhérant à sa vision, fusionnant avec l'espèce représentée, englobant le mal dans son effarement, car la vision d'un artiste est double (autrement elle ne serait qu'humanitaire ou despotique), elle est par essence confrontation de sa dualité, elle est ignominie et peur de son ignominie, à l'instar de ces deux chats prêt à se battre (1786-1788), le gris et le noir, bombant le dos en se croisant, le poil hérissé, à la fois terrifiés et attirés. La détresse de l'animalité est avant tout dans le spectacle de la violence dont elle doit faire preuve pour survivre. Sans cette empathie foncière à la condition animale et humaine, cet effrayant équilibre entre rêverie et sauvagerie, comment Goya en serait-il arrivé à l'image finale du Taureau-papillon (1824-1828)? Les deux pôles réunis en ce dessin illustrent le grotesque de l'homme sous les traits d'une bête hybride : le fantasme ailé accroché au poids de la nécessité telle une montgolfière chargée de plomb. Faire voler la brutalité. Il n'y a pas d'autre voie : l'artiste a l'obligation d'être vrai.
Grotesque de l'homme. Conservons l'idée. Dans le prolongement de la galerie centrale, s'ouvre la salle octogonale, d'où, bien avant d'y accéder, flamboie en notre direction, entre les deux empereurs romains, Caligula et Auguste, qui semblent tenir la garde de part et d'autre du portique, le grand tableau de la famille royale de Charles IV (1800-1801). En réalité, c'est la reine, Marie Louise de Parme, son épouse et cousine germaine, qui tient les rênes du royaume d'Espagne. Un secret de Polichinelle lisible dans l'organisation de la cour. Goya se plaît à mettre en scène le sceptre ramolli de Charles, d'autant plus que Manuel de Godoy, amant de la reine et premier ministre, allait devenir son principal mécène. Marie Louise occupe le centre du tableau ; on pourrait croire que son époux à ses côtés, par l'inconsistance de sa pose, est un valet qui aurait pris du galon en recevant l'ordre, ou la permission, de rester auprès de sa maîtresse. Sur la figure de ce roi débonnaire à la physionomie si caractéristique des Bourbons, rayonne si peu de lumière que Claudel, à la dent bien aiguisée, écrivit à son propos : «ce qui va en avant, ce n'est pas l'âme, c'est l'abdomen». La férocité du mot souligne la cocasserie de la situation. Cette laideur congénitale de la famille royale, dont on avait atteint un sommet avec le roi Charles III, et qui sur le visage de la reine s'épanouit comme un signe de noblesse, se marie au ridicule de l'apparat. À se demander même comment l'évidence de ce ridicule ne frappe pas ceux qui le constituent! Ils sont apparemment heureux d'être là. Ravis du travail de l'artiste. Presque effacé dans l'ombre, sur la gauche, devant son tableau, Goya joue les témoins impassibles et discrets du faste monarchique. N'étaient-ce le jeu de lumière et son regard droit traversant la zone de retraite où il se tient pour interpeller le spectateur par-delà l'épaule de ses commanditaires, on pourrait croire que le peintre influe très peu sur la représentation de son sujet. A-t-il vraiment besoin d'en faire trop? Tout n'est-il pas déjà dit par les circonstances? Dans la même salle 32, chapelle dédiée à la royauté, sont exposés la série de médaillons avec les esquisses des portraits préparatifs au grand format familial, et les tableaux équestres de la reine Marie Louise de Parme (1799), dont on sait qu'elle fut si satisfaite, et du roi Charles IV (1800-1801), l'air toujours aussi bonasse. Pour mesurer la complexité du rapport du peintre avec ses employeurs royaux, il faut nous attarder sur la langue. L'espagnol nous rappelle l'étymologie commune des mots «royal» et «réel» par l'usage d'un seul et même terme pour exprimer les deux idées : «real». Là où l'anglais, pour le même vocable («real»), abandonne le sens de «royal» mais étend celui de «réel» à «vrai» (il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une culture matérialiste confonde la vérité avec les apparences), le portugais non seulement conserve les deux sens («royal» et «réel») mais les fait cohabiter avec ceux d'«effectif» et de «positif». La royauté est ce qui unit la nation en même temps que le symbole de cette union ; par son projet politique, la monarchie est à la fois source d'unification et unité. Dans cette logique, le réel peut être réduit à ce qu'il paraît puisque l'apparat est produit volontairement : le réel se résumerait donc à ce que l'on veut qu'il soit. On retrouve cette idée dans l'acception médiévale du mot «real» : «ce qui est effectivement», autrement dit ce qui est par l'effet, ce qui tient lieu de réalité par la forme. L'on comprend donc que l'histoire ait favorisé, par souci de stabilité politique, cette collision sémantique. Le roi n'était-il pas l'élu de Dieu? L'empreinte et le garant d'un ordre universel? Cette imposture, qui permettait l'asservissement du peuple, s'est fracturée avec la révolution française. Au fond, si l'on s'en tient à la polysémie de la langue, les temps modernes marquent l'entrée dans le sacrilège : qu'y avait-il derrière le réel? Quel pari audacieux et pour le moins insensé que de le faire voler en éclat! Briser sa structure ne revenait-il pas à ouvrir la porte au chaos et à la terreur? Les ambitions et le pouvoir relayés entre d'autres mains, quel système en garantirait l'équilibre plutôt que le désastre? Où marchons-nous depuis 1789? La sacro-sainte démocratie ne serait-elle que décombres du passé? Goya, loin d'adhérer aux idéaux révolutionnaires, fut l'un des premiers témoins du raz-de-marée qu'ils avaient provoqué. Ancré dans un régime devenu archaïque, il serait aussi l'une des victimes collatérales de cet après peinant à se trouver une véritable direction. L'art, par la force des choses, était entré dans une nouvelle ère. Et les noires visions qui surgiraient bientôt seraient l'aboutissement du déluge où se déverserait, comme dans un delta, la bile d'une veine personnelle. Mais nous n'en sommes pas encore là, pour l'heure Goya peint le grand tableau de la famille royale, c'est un homme au tempérament jovial à qui le destin a déjà réservé quelques mauvais tours, dont celui de le priver de l'ouïe, et l'on peut soupçonner que, pour un artiste de sa trempe, plongé dans la profondeur de son silence, le mot «réel» recouvrait un champ bien plus vaste que celui de la garde-robe de la reine, ou, pour dire les choses différemment, que la réalité avait une origine plus intérieure, plus mystérieuse, que l'effet produit. Ce qui est léger se grave dans la tendreté de la moelle avec des répercussions colossales. Le travail de Goya consistera à faire remonter l'écume cachée sous l'artifice. La fausseté des titres se mêle à la consanguinité de la race. Le décorum du pouvoir parle de lui-même par un don inné de ventriloquie. Il y a dans l'art de Goya un basculement progressif qui fait que le portrait aristocratique porte intrinsèquement son grotesque comme un nerf qui peu à peu va se gonfler et prendre du relief. Aucune caricature, aucun trait grossier, le naufrage suit son cours. J'ai dans la tête, pour me guider à travers les allées du musée, le souvenir des Vieilles (1812) vues à Lille, aux visages presque squelettiques, et la mémoire des bêtes revient instinctivement à qui observe les tissus immaculés de la dynastie. Il faut se défaire du cliché de l'excès, le monstrueux habite le fade, voilà comment Goya réussit son apparent grand écart entre la noblesse de la cour et les caprices de ses démons : l'artiste est la synthèse des genres. Un peu comme si la Maja nue (1800) et la Maja habillée (1805) cohabitaient dans la même image par un procédé de double lecture, éveillant simultanément l'effroi et le désir, l'ordre et le désordre, au point que les rois ensorcelés furent fous de ce géant trouble. Son art semble murmurer : je fais ce qui me plaît, je suis peintre, mon œil s'immisce où il veut, moi seul connais la mesure.
Le ciel bleu de Madrid, en ce précoce printemps, n'empêche pas l'avion, lors de sa descente vers l'aéroport de Barajas, d'être secoué par de violentes bourrasques. La limpidité de l'éther semble ici cacher de mauvais esprits qui en veulent à notre peau – ou en tout cas à la paix de notre âme. L'inépuisable effervescence de la ville n'est-elle pas symptomatique d'un mal intérieur? On ne peut plus croire, plus de trente ans après la mort de Franco, que cette fièvre ne soit que réactive à la fin de son régime. Le plus long régime dictatorial d'Europe occidentale au XXe siècle : cela non plus n'est pas le fruit du hasard. Ce pays ensoleillé produit un vin aussi foncé que le Ribera et une peinture ténébreuse comme celles du Greco ou de Velásquez. Il doit y avoir dans son sol de noirs ferments qui contrecarrent les effets de la lumière. Parfois je me sens enragé, d'une humeur que je ne supporte pas moi-même, écrivait Goya en 1794. Je suis là pour revoir les murs dépiautés de la maison du sourd, série de fresques répertoriées dans l'histoire de l'art sous l'appellation des «peintures noires». Un cycle comparable à nul autre, tant il semble provenir de la région la plus insaisissable, la plus obscure de l'être, ce que l'on nomme ordinairement les tréfonds de la pensée, et que le Prado conserve jalousement, à l'abri des rayons du jour, dans les salles numérotées 36 à 38, comme de fabuleux abîmes. Les joyaux ternis de la couronne.
De ces salles que je croyais connaître pour les avoir visitées quelques années auparavant, je gardais le souvenir de lieux clos où les œuvres étaient exposées en altitude, d'une atmosphère de sous-bois où des chouettes perchées sur les plus hautes branches toisaient les visiteurs de leurs yeux étincelant au milieu de leur silhouette sombre. Je me revoyais même les observer d'en bas, levant la tête dans leur direction, perdant un peu l'équilibre. En réalité, les peintures noires prenaient de la hauteur naturellement. Par leur débordement intuitif du cadre historique et leur envergure métaphysique, elles tenaient lieu directement de mythe. Elles provenaient de temps immémoriaux, nous écrasaient de la puissance de leur imaginaire. Leurs tons terreux et lumineux créaient des scènes aussi saisissantes que celles qu'enfantait la nuit dans nos têtes. Ce n'étaient pas des peintures ordinaires. Sortes de débris tombés du ciel, elles parlaient d'autre part. Du même lieu sans doute où Goya peignit son fascinant Autoportrait avec le docteur Arrieta (1820). De l'autre côté. Une main seulement était restée dans le monde des vivants pour transcrire la teneur de ses visions, le brouillage, pour ne pas dire l'effacement en cours, de son corps. Personne. Malgré les allées et venues, le brouhaha des écoliers. Personne. Le peintre nous avait laissés seuls, abandonnés, sur une planète incompréhensible. Le moindre appel résonnait comme dans un théâtre vide. Ces peintures témoignaient de la vie comme si la vie s'était déjà enfuie, comme si la terre était déjà déserte. D'où ce sentiment de hauteur, de mise à distance, qui excluait le visiteur de son propre univers, qui le mettait sur la touche là où il croyait encore être dans le jeu. Et personne, qui franchissait la porte des salles numérotées 36 à 38, ne restait indifférent. Les peintures noires frappaient quiconque les observait d'un étrange sentiment d'attirance et de répulsion. Chacun sentait combien était vraisemblable le règne de l'épouvante, chacun avait rangé ce savoir dans la boîte noire de son inconscient. Mais les mauvais rêves d'une nuit terrible s'étaient imprimés sur les murs de la maison du sourd, débordant du peintre comme les sédiments d'un fleuve, le remugle de l'âme.
Copyright © Stéphane Lambert, 2008
Copyright © Bon-A-Tirer, pour la diffusion en ligne
|