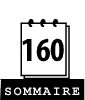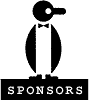|








|
|
LA PASSION ET LES HOMMES (4)
En quittant l'imprimerie et les ouvriers, De Nève m'avait raccompagné jusque chez moi. Plusieurs galopins suivirent avec mon bagage personnel. J'avais l'intention de me rendre à Eename.
Une heure plus tard, dans la chaise d'Audenaerde, mon corps tremblait sous l'effet de ma décision définitive. J'avais brusqué le cours normal des choses. Par moments, mon cœur battait si fort qu'il rythmait le grincement des essieux. Les moyeux des roues auraient dû être graissés.
Le cœur battant et le bruit des essieux se sont gravés dans ma mémoire.
Je ne craignais pas m'être trompé, j'étais sûr d'avoir fait le bon choix. Et j'ai eu raison de n'avoir eu ni crainte ni regrets en abandonnant ma fonction. Ma collaboration à la destinée du pays me valut beaucoup d'estime. La méritais-je?
J'ai passé sous silence un autre départ, auquel je repense de plus en plus souvent, celui de mon frère Urbain, deuxième fils Beaucarne. Il suivait Louis-Maur de deux ans. Bien avant le moment où moi-même je fus conduit à Gand, il avait été au collège d'Alost et, ensuite, confié aux abbés qui deviendraient mes maîtres, lui, non pas pour suivre la voie qu'ils m'ont destinée, mais en tant que correcteur et élève imprimeur aux éditions de l'évêché. En 1823, l'imprimeur de l'évêché J.B. Poelman avait pris l'initiative d'éditer un journal d'information générale, Le Courrier de la Flandre, journal religieux, politique, littéraire et commercial. Moins de deux ans plus tard, le 7 décembre 1826, Le Courrier de la Flandre changea de titre. Le Catholique des Pays-Bas était né. Mon frère Urbain fut affecté à sa gestion technique. Lorsque je fus enrôlé à mon tour, je ne le vis que rarement, nous ne faisions pas partie du même département : j'étais à la rédaction, lui aux machines. Nous nous saluions comme des frères, mais nous n'avions pas de souvenirs communs. Urbain avait encore connu notre mère, je la lui avait volée en naissant, il ne pouvait rien me dire d'elle, je doute même avoir été suffisamment proche de lui pour oser lui poser une question intime. D'ailleurs, avais-je, à l'époque, déjà eu l'occasion de parler de sentiment? De moi-même? Aux études, nous pouvions tout au plus analyser les passions décrites par les auteurs classiques que nous lisions, ce qui néanmoins me permit de découvrir qu'il y avait moyen de s'exprimer plus librement en classe, avec nos maîtres et entre condisciples, que dans la vie commune.
Ce n'était un secret pour personne qu'Urbain était très pieux. Il ne l'affichait pas, mais disparaissait aux heures des offices et passait seul ses moments de loisirs. Il avait décidé de vivre en retrait des ambitions terrestres et préférait se rendre utile par des besognes discrètes. En réalité, il attendait de mériter la solitude de la prière, et si j'ai si peu parlé de lui pendant l'année et demie que lui et moi travaillions à Gand dans la circonspection d'une même entreprise, c'est que l'agitation qui m'occupait représentait l'antipode de la retraite qu'il s'était choisie, tant dans l'espace réel de l'atelier des machines et de sa chambre à l'ombre du séminaire que dans celui, abstrait, de ses pensées. Il ne fallait pas que je fasse intrusion dans ce monde qu'il voulait opposé au mien. J'avais d'ailleurs si peu partagé son enfance que je ne m'accordais pas le droit de m'approcher de lui. La distance intérieure qui vous sépare d'un frère peut être plus insurmontable que celle qui isole deux continents. Il n'y a pas de voyage qui mène de l'un à l'autre, même quand l'amour s'en mêle. Sans doute m'aimait-il comme un frère, mais cet amour ne faisait aucune différence entre moi et les autres car il aimait tout le monde, sans oser ou sans vouloir attirer l'attention sur l'émotion qu'il dégageait ou l'émoi qu'il aurait dispensé : il arrêtait l'épanchement avant que ce dernier eût acquis un caractère personnel et vous offrait un visage d'où ne transparaissait rien d'autre qu'une parfaite disponibilité. L'expression du visage d'Urbain était celle qu'on rencontre sur les effigies populaires des saints modestes de nos campagnes. Il ne devait pas apprécier la somptueuse extase de la contre-réforme baroque, qui étalait si généreusement ses fastes à Gand.
S'il m'avait préféré à d'autres, il se serait senti coupable d'égoïsme. J'appris par des tiers qu'il voulait entrer dans les ordres, et bien avant l'excitation qui précéda la révolution, il vint me faire ses adieux pour s'enfermer aux Carmes.
À l'époque, je me jugeais irrémédiablement différent de lui et ne pus ni comprendre ni m'appesantir sur la décision qu'il avait prise. Je déplorai l'existence recluse à laquelle il s'était condamné, j'eus pitié de lui, mais le regret n'alla pas plus loin. Il faut savoir qu'à l'époque dans les familles catholiques, l'aîné ou le second fils, tout naturellement, était destiné au sacerdoce. Et bien qu'au siècle dernier la famille Beaucarne, inspirée par l'esprit des Lumières, selon toute vraisemblance n'aurait pas produit de fils voué à l'Eglise, la conception de l'existence définie et gouvernée par l'homme lui-même et non par Dieu n'avait pas pénétré les campagnes, les propriétaires terriens y étaient restés attachés à l'ordre ancien, et Urbain, comme moi après lui, n'avait fréquenté que des fils de familles où la piété des aînés délivrait les cadets du choix d'un état peut-être peu recherché. Jeunes et vieux vénéraient celui qui révélait des aspirations altruistes. Ajoutons à cela que l'empereur autrichien Joseph II et la Révolution française, par leurs persécutions, avaient ressuscité une ardeur qui vingt ans plus tôt était en voie de disparaître.
Je laissai partir Urbain comme mes frères le firent : dans le plus profond silence. Sans doute pensions-nous à lui à certains moments privilégiés.
Plus tard, je reconnus sa tristesse. Je compris l'influence qu'avait eue sur lui la solitude de notre vieux père. Le géniteur avait choisi de perpétuer le deuil de ma mère, délibérément, pour se séparer de la réalité et du bonheur de vivre. N'avais-je pas, moi aussi, choisi un départ? N'avais-je pas en moi, hérité d'un ancêtre inconnu, ce trait de caractère qui me distanciait de l'ambition?
À mon arrivée à Eename, la commune me conféra les modestes fonctions d'échevin. Je ne comptais pas rester sur les lieux de mon enfance, occupés par mon frère aîné Louis-Maur, qui en se mariant avait repris la maison familiale. Mais comme j'y avais encore mes quartiers et que c'était de notoriété publique que je désirais quitter Gand, je ne pus refuser la charge offerte, ne fût-ce que par piété pour la mémoire des deux Beaucarne, bourgmestres avant la révolution française. Oncle Joseph, frère aîné de mon père, avait succédé à notre grand-père Jacques, mais n'avait pas survécu de beaucoup la date fatidique de 1794. J'avais la réputation d'avoir déplacé des montagnes dans une lutte héroïque, alors qu'ici les concitoyens n'attendaient de moi que de menus services. Un peu d'attention suffisait, et l'autorité d'un homme rompu aux affaires publiques… C'étaient les paroles de l'émissaire, Charles-Isidore, instituteur communal, chargé lui aussi d'un mandat d'échevin.
Je me serais bien passé de renommée, pensai-je alors.
J'aurais dû savoir que la réputation est précieuse, souvent plus que la personne elle-même. Estime et renommée me valurent d'être invité dans le monde. J'étais à peine rentré à Eename, que je quittai le lieu. Dès mon départ de Gand, mes anciens condisciples se rappelèrent à mon attention. Je les avais perdus de vue depuis plus de trois ans…
Nous n'avions jamais eu de relations suivies. Il y avait tout d'abord les inséparables “Léon et Victor”, un duo que j'écoutais volontiers parce qu'ils avaient des sœurs et que leurs histoires de mères, de tantes, de cousines, de fêtes et de bals me rappelaient vaguement le temps où mon père parlait encore, une fois l'an, dans un salon réanimé par quelques visiteurs venus de loin pour présenter leurs vœux de Nouvel An et mendier quelque obole. Ces moments rares qui jalonnaient le passage des années, avant de disparaître définitivement, avaient acquis une force magique dans mon imagination d'enfant et réveillaient un passé merveilleusement habité par des gens qui non seulement avaient réellement existé, mais qui avaient été les sœurs de mon père, ses cousines, ses frères, sa mère, ses tantes. Ils me permirent de rêver de l'univers perdu du bonheur familial que j'essayais d'interpeller dans la galerie de tableaux, et voilà que des années plus tard, face au duo qui ne se doutait pas de l'origine de mon attention, dans ma solitude que je cachais sous les dehors de l'élève studieux, j'apercevais mes morts se relevant d'un sommeil de conte de fées et s'animer dans le brouillard du passé. Les histoires du duo, en passant par moi comme par une machine génératrice d'énergie, irrésistiblement ensorcelaient mes défunts, les tirant tout ravigotés de leur léthargie, le temps faisait un saut, et les deux scènes de vie — la Beaucarne de jadis et celle des Andelot et des Hoogvorst contemporains — se confondaient. Léon et Victor me rendaient mes origines. Ils ne s'en doutaient pas. On me savait orphelin. Je n'étais pas intéressant.
Je le devins grâce à la presse.
Léon fut le premier à réapparaître. Les ruines de l'abbaye d'Eename préoccupaient les esprits, ainsi que le sort des moines qui, près de quarante ans auparavant, avaient dû fuir les Jacobins. Certains s'étaient réfugiés en Allemagne. Les plus jeunes, septuagénaires, vivaient peut-être encore. Léon m'apprit qu'il se rendait parfois à Cologne, qu'il connaissait le problème des archives éparpillées et qu'une place m'attendait dans sa voiture. Je l'accompagnai une première fois. Décidé à ne plus m'occuper ni de journalisme ni de politique, je comptais me vouer à l'étude, voyager, ne pas vivre sur nos terres mais déménager à Bruxelles, ou alors, y prendre un pied-à-terre une partie de l'année. J'y rencontrerais Bartels, mes amis du gouvernement, je verrais bien ce que l'avenir me réserverait… Lorsqu'on a vingt-six ans, la vie semble vous promettre bien plus qu'une seule existence : j'avais l'avenir devant moi, je n'étais pas pressé de savoir quelle serait ma destinée.
Malgré d'alarmantes menaces de guerre, vue d'Eename, la nation semblait jouir de sa liberté conquise. Dans nos premiers ministères, les acteurs de la révolution, artisans de l'histoire, apprenaient à gouverner. Le pays formait une grande famille et nous étions tous des compagnons. Dans ce monde feutré des années trente, n'ayant qu'à assumer une fonction d'échevin peu exigeante, je pouvais prendre de longues vacances. Je me mettrais ensuite au travail.
L'occasion se présenta. Fin 1832, Léon vint me trouver à la veille d'un nouveau départ. Les hostilités diplomatiques concernant le territoire belge et les frontières entre la Hollande et la Belgique préoccupaient les pays de l'Alliance, de sorte que les puissances étrangères se méfiaient des voyageurs de mon genre. Une traversée d'agrément, comme en avaient faite Gœthe et les romantiques anglais, n'était pas encore réalisable. Cette réserve ne frappait pas Léon ni ses amis, tous fils de familles impliquées de longue date dans les relations extérieures entre les États.
Léon désirait passer l'hiver à Vienne et à Berlin et m'offrit de l'accompagner. Pour ne pas trop m'obliger et me pousser à accepter son invitation aussi surprenante qu'imprévue, comme si l'inspiration lui en était venue au moment même de notre rencontre fortuite, il me fit sur la paume de sa main un dessin de l'itinéraire et me conta monts et merveilles des amis que nous rencontrerions, parmi lesquels deux anciens condisciples. Je ne compris pas immédiatement ce que ces condisciples faisaient à l'étranger, mais Léon m'expliquerait tout ça en temps et lieu. La feuille de route lui avait été remise par Warnkönig, professeur de droit à la faculté de Gand. Le voyage serait long, et si j'accompagnais, il ne serait jamais seul, ce qui diminuait les risques des grands chemins. Je ne me fis pas prier. Il avait été chargé de deux missions fort agréables, me confia-t-il, et nous traverserions Cologne à l'aller, qui m'intéresserait peut-être, et puis, pour l'agrément du paysage, Mayence, Munich et Salzbourg. Nous passerions un mois à Vienne. De Vienne à Berlin, on longerait la forêt de Bohême vers Karlsbad et Prague, on passerait en Saxe par la jolie ville de Dresde, dont le souvenir nous conforterait pendant la traversée du Brandebourg qui manquait de beauté. Mais Potsdam se trouvait sur notre passage, et à Berlin, nous verrions bien… Le retour s'effectuait par Brunswick et Hanovre, Gœttingue et Cassel, enfin, Düsseldorf.
C'est pendant ce voyage que débuta une idylle, qui me prit fort au dépourvu.
À Munich résidaient les Hoogvorst, parents de Victor, le second du duo “Léon et Victor”. Je croyais faire office de compagnon, pour la sécurité personnelle de Léon, il n'en était rien, Léon n'en avait nul besoin. Il avait annoncé notre arrivée pour que nous soyons invités “partout où il se passerait quelque chose”, et ce fut à un après-midi de château que je fis la connaissance d'Hortense, sœur de Victor. Je dois avouer qu'avant ce jour, je fus non seulement fasciné par la beauté d'un voyage dont jamais je n'avais imaginé le charme, la vie que menaient Léon et les jeunes auxquels il me présenta m'éblouit par son faste et sa légèreté. Était-il possible de passer ainsi ses jours — et ses années —sans la moindre gravité? Je découvrais une fois de plus, avec un étonnement tout neuf, qu'au même moment, dans une même circonspection, plusieurs mondes se chevauchaient, totalement différents les uns des autres, habités par des contemporains uniquement occupés à ce qui les concernait étroitement, si étroitement qu'ils ne connaissaient pas, ne désiraient pas connaître ou ne pouvaient pas connaître ce qui dépassait leur propre existence. Pour ma part, j'avais traversé plusieurs univers après le silence et la solitude dans la maison paternelle : j'avais deviné celui, plus attirant, des domestiques et des fermiers, j'avais découvert Alost et l'étude, puis Gand et le travail. Rien ne les reliait entre eux, si ce n'était moi, le passant, le voyageur malgré lui. Il manquait une note légère à l'ensemble.
Il est certain que la somptuosité du voyage et des expériences qui précédèrent le premier coup d'œil échangé avec Hortense, prédisposa ma réceptivité.
La mémoire ne retrouve ni l'extase ni l'enivrement de la passion politique, mais du cœur touché par l'amour, de l'attente secrète et de l'espoir fou le souvenir perdure, prêt à en ressusciter les félicités et ravissements passés. L'amour qui ne s'avoue pas, l'amour sans espoir, l'amour raté, cette passion si dérisoire de l'homme qui n'obtient pas les faveurs de la femme qu'il idolâtre et pour cela attend indéfiniment et s'accommode de l'amitié qu'elle lui offre en échange, ce feu sans bois, ce foyer de brindilles et de cendres, cette flambée de fougue inutile… s'accroche au fond du cœur et s'inscrit, indélébile, dans le souvenir de l'émotion. L'avenir fut incertain, le désir inexpérimenté, son ardeur trop patiente, mais l'attachement qui nous lia acquit la qualité de l'exaltation platonique, dès lors digne de figurer au rang des passions capitales.
Nous voici donc Léon et moi, à l'avant-veille de Noël de l'an 1832, prenant la route vers la frontière. Dès le lendemain, la presse allemande signala notre passage. Durand, ancien rédacteur du Messager de Gand, orangiste et solidaire du gouvernement déchu, avait dû quitter la Belgique et travaillait depuis peu pour Le Journal de Francfort. Il annonça : “Aix-la-Chapelle, 24 décembre. — Le comte d'Andelot et M. Beaucarne, attachés à l'ambassade de Belgique, sont passés par ici ce matin, porteurs de dépêches pour Berlin.” Je n'étais pas attaché à l'ambassade, et à notre retour, nous apprîmes que ce communiqué avait été l'objet d'une interpellation à la Chambre. Fort ombrageux, les députés de la jeune nation désiraient connaître le dessein de notre mission. Or, Léon s'était muni de lettres d'introduction et de recommandation en grande partie pour voyager avec plus de sécurité, sous la sauvegarde du gouvernement belge. Le ministre des affaires étrangères, Jean-Baptiste Nothomb, lui avait confié des dépêches pour Berlin et pour Vienne, mais la mission la plus impressionnante était celle du roi, qui lui avait remis un message pour sa sœur, la comtesse de Mensdorf, que nous rencontrerions à Mayence. Son mari, le comte Emmanuel de Mensdorf, chambellan et feld-maréchal autrichien, y était gouverneur de la forteresse.
Nous y fûmes très bien reçus.
Quelques jours plus tard, après la traversée de paysages dont la magnificence éleva mes pensées, m'incitant à mesurer l'insignifiance des préoccupations humaines face à l'immensité du ciel qui nous dépasse, Dieu, l'infini, l'insondable nature du commencement de tout…, je redescendis sur terre grâce aux cahots de la voiture sur les premières rues pavées de Munich. Un des cousins de Lalaing de Léon, Maximilien, nous attendait à un lieu dit et nous fit conduire dans la cour d'un immeuble où nous guettait Victor. Une heure à peine après notre arrivée, nous étions déjà quatre. Maximilien, Victor, Léon et moi devions nous rendre, l'après-midi même, chez les Hoogvorst.
Il fallait se décrotter sans plus tarder.
— Je mets ce que j'ai de plus seyant, me souffla Léon, d'Hoogvorst a la réputation d'inviter tout ce qu'il y a de gracieux dans la capitale bavaroise. Comme par enchantement, j'en oubliai mes années d'adulte et me laissai entraîner par le passé redevenu réel : des amis du collège avaient songé à moi pour participer à leurs plaisirs improvisés.
À notre entrée au salon, les femmes levèrent le regard sur nous. Quatre jeunes gens de vingt-cinq et vingt-six ans, nous nous sentions de jeunes rois. Dans le groupe des filles, dix paires d'yeux nous examinèrent. Tout autre que moi aurait été charmé par l'abondance. Elle fut de courte durée. Pour moi, il n'y eut qu'un seul regard.
Nous nous dispersâmes après les salutations d'usage. Des groupes se formèrent dans les galeries, à la bibliothèque, au salon de musique. On apporta du thé et des gâteaux, des rafraîchissements, des liqueurs, de l'eau de vie frappée qui givrait le cristal. Je ne pus résister à l'envie de rechercher la proximité de celle qui déjà occupait mon attention. Le long du trajet que je m'étais proposé de suivre, je bavardai à gauche et à droite pour répondre aux salutations, mais je n'étais plus moi-même, mon double se tenait debout à lui tout seul, mon esprit avait quitté le monde des apparences et suivait un itinéraire parmi les toilettes et les coiffures pour retrouver celle qu'il cherchait. Ce n'était pas facile. J'étais trop éloigné pour saisir le détail des physionomies. D'où vient l'inspiration d'un premier coup d'œil? Quelle est cette inclination subite et foudroyante qu'il communique? L'onde d'une électricité nerveuse, que la sagesse populaire appelle un ensorcellement? Je ne vis ni ne reconnus la jeune femme aux traits de son visage, ni à sa toilette que je n'avais pas examinée, mais je pus néanmoins immédiatement la distinguer dans le groupe où elle avait été assise. Plus que les contours de sa silhouette, c'était sa présence qui de loin m'inspirait une émotion violente, comme s'il y avait eu — sans nom, sans apparence, sans même de premier contact — un lien de prédestination entre nous, ou plutôt, de parenté. Comme si nous avions été faits de la même pâte, dans la nuit des temps, déposés dans le même panier. Perdus l'un pour l'autre par des siècles de civilisation. Elle bougeait moins que ses compagnes et cette paix la détachait des autres. C'était un signe.
Laissons l'analyse qui essaye de traduire mon émotion se passer de logique, il n'existe pas d'explication raisonnable pour l'attirance à distance que je subissais. Je n'ai saisi le détail de ses traits que bien plus tard et, ensemble, nous avons mis beaucoup de temps à découvrir les affinités qu'à ce moment précis nous avions pressenties.
Finalement, je m'arrêtai à la bergère dans laquelle elle était assise. N'ayant pas l'habitude du monde, j'attendis qu'elle parlât la première. Une conversation reprit à sa gauche. Son regard croisa le mien, elle me sourit, puis tourna la tête. De la journée, je n'eus plus l'occasion de lui adresser la parole.
À notre retour, Léon me nomma la jeune fille. Il s'agissait de la sœur aînée de Victor, Hortense d'Hoogvorst. Sa mère avait profité du voyage de son fils pour montrer ses filles en tournée européenne. Nous les reverrions chez le comte d'Argenteau, un curieux personnage : archevêque de Tyr et nonce du Pape, autrefois colonel des hussards dans l'armée des Pays-Bas. L'ancien officier habitait un immense palais. Ce palais intéressait moins nos amis que les filles de la veille, qu'ils firent passer en revue une à une. Ils jugèrent mon élue “une personne d'esprit”, ils exaltèrent le raffinement de sa pensée, le discernement de son goût. Je ne remarquai pas qu'ils étaient plus diserts que d'habitude.
L'effet régénérateur de la compagnie si différente de celle que j'avais côtoyée dans l'exercice de mes fonctions, persista, je ne vieillis pas pendant la nuit. Léon et les siens m'avaient adopté, et personne n'attendait rien de moi. Je n'étais plus en cause. Ce qui me permettait de participer aux conversations en observateur, mieux encore, en spectateur qui oublie ses propres opinions et perd sa volonté. Je me laissais guider. Mes compagnons n'avaient rien de ces enragés d'ambition qui fréquentent les rédactions. Personne ici ne croyait à de grandes causes, personne ne défendait une idée jusqu'au bout. Avec un feu tout intérieur, d'ailleurs joliment dominé, Maximilien et Victor se divertissaient en discourant et en réfléchissant pour le plaisir de s'entendre et de rire. Avec Léon, ils parlaient d'un tas de gens qu'ils semblaient fort bien connaître, dont ils disséquaient le caractère, les manières et les goûts, improvisant des situations des plus excitantes pour pallier à leur manque d'information précise. Et lorsqu'il s'agissait de choses sérieuses, même la guerre et la diplomatie ne chassaient pas l'ironie. Ils élaboraient en tous sens d'assez jolies utopies sans pour cela se combattre l'un l'autre. La véhémence leur était inconnue. L'éducation avait si fortement influencé leur pensée, qu'ils acceptaient sans mépris ni amertume, comme pour compléter leurs propres opinions, les vues parfois divergentes que l'un d'eux avançait. Ils faisaient par plaisir ce que d'autres font par nécessité professionnelle ou politique. Ils avaient déjà des manières de diplomate. Dans leurs discours, comme dans les conciliabules importants entre délégations étrangères, le but à atteindre, tout en guidant leur pensée, ne les concernait pas personnellement. J'ai découvert dans les meilleures conditions possibles, puisque je participais moi-même au jeu, que la haine et la jalousie sont des fruits cueillis dans la rue, à l'arbre, en plein vent, sous un ciel souvent menaçant, tandis qu'il est aisé de se distancier avec élégance du remous vulgaire lorsque celui-ci vous est présenté sur un plateau d'argent. Je me reposais des batailles livrées. La nouveauté de la camaraderie me fit oublier mes désillusions encourues au contact des hommes.
Chez d'Argenteau, les réjouissances avaient été prévues selon un déroulement précis : dîner champêtre d'après-midi, dans les salons et autour de la pièce d'eau, boissons fraîches, promenades et danse. On avait fait appel à quelques orchestres tsiganes et à d'étonnants musiciens viennois. Il y en avait pour tous les goûts. Quant au piano, un architecte avait conçu un trottoir roulant de petites planchettes parfaitement parallèles qui en se déroulant et se rebobinant supportaient allègrement le poids de l'instrument et le déplaçait de l'estrade de la salle des banquets à la terrasse, pouvant même, le cas échéant, le long d'une rampe mécanisée, descendre les escaliers du perron vers l'allée centrale menant au bassin d'eau.
Autour de ce piano se rassemblaient alors des groupes campagnards aux accordéons mal accordés, des chanteurs populaires en tablier et chapeau, ou, à l'autre extrémité de l'échelle sociale, des virtuoses en tenue de gala, de Vienne, de Milan ou de Berlin, invités par amitié et alléchés en la lointaine Bavière par la généreuse réputation de l'hôte et de ses invités. Le palais était en effet de dimension impressionnante. Les visiteurs y disparaissent comme des perles dans un écrin trop grand et la démesure du décor creusait les distances. La situation facilita grandement mes premiers pas. Une colonnade circulaire formait entre le mur du premier salon et la pièce elle-même une sorte de galerie donnant sur le parc par de grandes portes vitrées. Hortense regardait dehors. Elle n'était pas entourée. Enfin! je pourrais l'écouter. Sa voix me plairait autant que ses gestes. Je m'avançai droit vers elle. Je lui récitai ma joie de la revoir. Lui rapportai tout le bien que ses amis avaient dit d'elle. Je remerciais la providence qui me procurait l'occasion de m'assurer moi-même de son caractère et de ses vertus.
Elle rit d'un petit éclat.
Le flot de paroles inutiles brusquement interrompu, je crus sentir la vague de chaleur que je dirigeais sur elle, et — oh! miracle — qu'elle me retourna après l'avoir captée. Nous étions à l'arrêt devant une fenêtre donnant sur l'eau et j'avais sous les yeux, en pleine lumière, un regard que je ne connaissais pas encore, dont je ne voyais que le bleu des yeux, l'iris très pâle moucheté de plumetis marrons.
Je n'avais toujours pas salué notre hôte, nous étions à l'écart. Hortense n'avait pas répondu à ma tirade d'accueil, et pour reprendre le thème de mon discours, — j'ignore ce qui me prit, sans doute me sentis-je à l'abri des curieux derrière notre colonne — je confessai sans ambages :
— Je n'ai jamais vu de près les yeux d'une femme. La combinaison du dessin des vôtres est aussi ensorcelante que l'invraisemblable jeu de la création sur les ailes de certains papillons.
Par petits groupes, les invités se promenaient dans le palais, pour admirer les perspectives monumentales des majestueux appartements. Déambulant côte à côte, Hortense et moi pûmes ainsi soutenir la conversation rien qu'en exprimant à tour de rôle l'effet que nous faisait le prodigieux agencement. Hortense comparait le sentiment du beau produit par l'architecture et les œuvres d'art à cet autre émoi, modeste et banal mais noble et solennel lui aussi, créé par la beauté plus timide des aménagements discrets.
— Qui répondent à notre sens intime du beau, disait-elle. L'attendrissement qu'ils provoquent n'en est pas moins sublime.
Cette première remarque coïncidait avec mon propre sentiment, un argument de plus pour croire que nous étions destinés l'un à l'autre. Je ne songeai pas un instant, comme je le fais aujourd'hui, que la jeune femme me croyant peu mondain, voulut me plaire en se rapprochant de mes goûts. Ses paroles me semblèrent extraordinairement subtiles, je m'étonnai de rencontrer chez une femme une pensée pénétrante. Au collège, Eve nous avait été dépeinte tout différemment. Notre dialogue, constatai-je, allait au fond des choses… L'âme se sentait revivifiée lorsqu'elle pouvait se refléter dans les propos d'autrui.
La magie de l'écriture stylise les balises du souvenirs. Notre premier entretien, aujourd'hui, pourrait faire office de parodie. De l'éducation dont avait joui Hortense, qui n'était que science du beau et de la bonté. De l'intention de sa mère de la marier au plus tôt, avant qu'elle n'ait atteint sa 28e année. Enfin, de la promptitude avec laquelle je réagis. Cependant, tout fut vrai pour les deux acteurs, et l'étonnement de la jeune femme qui me découvrit ne fut pas moindre que mon plaisir d'innocent à goûter pour la première fois la saveur féminine de l'intelligence et de la sensibilité.
— Il suffit de la perspective d'un petit bois, d'un chemin de campagne ou d'un versant de montagne pour célébrer la richesse de ce monde, reprit ma compagne devant une autre fenêtre.
Nous choisîmes deux tabourets, comme si nous attendions quelqu'un. Personne ne vint. On nous laissa derrière notre colonne. À notre droite, un guéridon portait un éventail de nacre perlée, qui, selon moi, résumait tous les arts et artifices. Un bouquet rappelait, selon Hortense, l'inégalable mystère de la création, et nous nous engageâmes sur la voie philosophique de l'insignifiance originelle des choses, vouées à l'oubli et à la destruction, si elles n'étaient pas comprises et animées par l'homme.
— Il faut les yeux de l'homme pour que la beauté existe, conclut-elle.
— Vous êtes trop modeste, répliquai-je.
Je rougis le premier.
—Si nous n'étions pas tous là, remarqua-t-elle pour neutraliser ma confusion en décrivant un large geste en direction des groupes dont nous nous étions distanciés, à exiger de l'art, il n'ornerait pas nos palais. Dieu sait s'il pourrait être créé!
Je n'avais pas de réponse à ce défi oratoire.
Après les choses fondamentales que nous venions d'effleurer, il était temps de nous entretenir de nous-mêmes. Nous nous racontâmes nos vies, nos lectures, nos projets. Je n'entendis rien qui eût pu me faire croire que son avenir fût engagé. Elle apprenait l'anglais et les mathématiques. Sa famille n'avait pas souffert des armées et des bouleversements politiques.
L'agrément de cette conversation fut tel que sa résonance acquit aussitôt une force magique. L'après-midi se prolongea; le va-et-vient, le service du café et du chocolat, puis des boissons rafraîchissantes et des liqueurs entrecoupèrent notre dialogue, mais personne ne nous sépara. L'un comme l'autre, nous fûmes entraînés entraînés par notre compagnie habituelle, et après chaque petit écart, déposés face à face. Nous nous retrouvâmes comme si rien d'étranger n'avait accaparé notre attention ou diminué notre désir de poursuivre notre tête-à-tête.
À ce moment-là déjà, nos propos ne faisaient que confirmer l'entente mutuelle que nous voulions nous prouver. L'examiner sous ses aspects divers devenait une occupation délicieuse et inépuisable. Nous nous quittâmes comme se séparent des amis de longue date qui se comprennent parfaitement.
Le départ de Munich ne me causa pas de peine, j'étais transporté par ma nouvelle amitié, si étrange et si familière. Le voyage continuait, d'autres expériences nous attendaient, les nouvelles de Belgique restaient rassurantes et j'étais si absorbé par le sentiment que la jeune femme m'avait inspiré, que je ne rêvais même pas de retrouvailles. Je l'aimais, cela ne faisait aucun doute, et j'ignorais que son absence pût devenir une souffrance.
À Vienne, Maximilien et Léon se lancèrent dans un tourbillon de sorties et d'aventures. Dans les cafés du Graben, dans le jardin de la Hofburg, le long de l'étang où nous épiions les jeunes filles et leurs mères en ayant l'air d'examiner les passants ou de suivre le jeu des enfants gardés par d'importantes matrones, notre groupe discourait et je découvris l'existence sans but immédiat. Je pouvais me taire et sourire, ce qui me donnait un faux air de sagesse. Nous riions beaucoup. Le rire volatilise les propos. S'il me reste de nos charmantes réunions quelques propos tangibles, c'est qu'ensuite, à intervalles réguliers, dans les circonstances les plus diverses, des bribes m'en sont revenues à l'esprit. Je nous revois alors, élégants et légers, moi-même un peu double, comme je l'ai toujours été, séduit pas l'abondance et le faste, la surabondance même, alors que dans l'obscurité au fond de moi vivait un ascète. Cet ascète était d'une patience inébranlable lorsqu'il s'agissait de permettre à son double de faire une escapade. En vérité, même à Vienne, j'étais un troisième personnage, frère cadet des deux autres, plus sobre, plus stable et moins excessif, un être social conscient de l'état réel du monde, avec ses innombrables indigents, victimes des maux inévitables de l'existence. Dans notre tourbillon, ce troisième se taisait. J'écoutais son discours quand il n'y avait vraiment rien d'autre à faire.
Mon premier s'habillait avec soin. Il se dandinait sur le trottoir en arrondissant d'une ébauche de courbette le passage qu'il laissait aux femmes. Il se cabrait avec ses compagnons, raides, longs et minces au milieu de l'allée centrale du parc impérial, d'accord de vivre sans arrière-pensée le temps d'une promenade, s'amusant de l'ostentation avec laquelle tous, simples ou grands seigneurs, emboîtaient le pas pour entrer dans la danse. Un quatrième personnage me suivait comme une ombre, dans le plus grand secret, l'amoureux, le rêveur, l'homme pour qui l'avenir venait d'ouvrir de larges portes et les écluses du sentiment des torrents d'émotion.
J'honorais du regard le plaisir quotidien, charmé et séduit par les spectacles de tout genre, musique militaire ou marché de bienfaisance. J'acceptais le luxe des bienfaiteurs, les joyeuses bandes, le gaspillage et la débauche de fausse magnanimité, car un autre regard, intérieur celui-là, suivait le pas d'une femme unique, Hortense, imaginée à mes côtés, participant comme moi au jeu de la gaieté, aux visites, au bavardage et aux taquineries. Vienne m'apprit le flegme dont a besoin le sentimental touché à vif qui doit cacher son état irréel pour pouvoir fonctionner normalement aux yeux de tous. Ce fonctionnement n'est pas dénué d'agrément. La conscience qui d'habitude reste muette durant l'action, confrontée à la personne aimée qu'on imagine à ses côtés, s'anime, et tout ce qui se passe devient l'objet d'un dialogue suivi. La juxtaposition de deux univers relativise admirablement, sans blesser le penseur.
C'est aussi grâce à Léon, Maximilien et aux gens que nous saluions un peu partout que, plus tard, je n'ai pas eu dans le monde l'apparence d'un indécrottable ignare. La même société cosmopolite tient le haut du pavé dans toutes les capitales. De temps à autre, l'apprentissage que Léon me fit faire à Vienne eut tout d'une initiation forcée, car je n'étais plus tout entier désireux de m'instruire en matière de débauche. J'étais déjà captif de la perspective d'un amour sûr, d'un amour partagé, qui répondrait aux aspirations de ma nature et de mes traditions familiales.
Nous ne pouvions pas prolonger indéfiniment notre séjour à Vienne. Léon devait partir pour Berlin. Il voulut savoir si je désirais organiser une dernière escapade avant notre départ. De Munich, les Hoogvorst nous rejoindraient en passant par les forêts de Bavière tandis que nous, au lieu de prendre la route du nord en montant sur Prague, nous pourrions, par un détour insignifiant, longer la même forêt en Bohème, vers Karlsbad, cela ferait une excursion magnifique, nous reverrions une dernière fois Victor, Maximilien et les jeunes filles. Les mères seraient ravies de les chaperonner.
— Ne changeons pas notre première intention, dis-je. On t'attend à Berlin, et la route est longue. J'étais sûr de revoir Hortense en Belgique, je crus que Léon voulait m'être spécialement agréable et je ne désirais pas abuser de sa bonté.
Il fut de fort méchante humeur les premiers jours de notre second voyage. Je l'avais contrarié, car il était amoureux lui aussi, ce que je ne compris qu'un an plus tard, lorsqu'il annonça son mariage avec une des amies d'Hortense. J'ignorais que les Hoogvorst espéraient me voir revenir…
Je ne me suis jamais débarrassé du remords rétrospectif envers Léon. Tous étaient prêts à m'accueillir, je faisais un candidat honorable pour leur sœur et amie. L'excursion en Bohème aurait uni trois couples de jeunes vivant une idylle romantique. La honte me paralyse.
En route vers Prague, nous ne nous arrêtâmes pas plus qu'il ne le fallait dans le paysage dont la beauté ne m'échappa pas. Comme j'ignorais l'origine de l'humeur de Léon et que je ne me sentais nullement coupable, je profitai du silence pour rêver d'Hortense. Elle fut du voyage, aussi réelle que si elle avait été là en personne. Je l'avais entièrement à moi dans nos propos imaginaires. Projetée sur la banquette de la voiture, elle disait ce que je voulais qu'elle dise et je répondais, ravi et flatté. À l'étape, elle descendait du marchepied et fuyait devant moi dans la nature. Elle se retournait alors pour m'apostropher, et ses découvertes étaient les miennes. La femme qu'on rêve est la décalque exacte de nos désirs. Pour cette raison, le premier amour et le désir qui ne s'accomplit pas laissent le souvenir d'un bonheur complet. Peu de choses ont perturbé l'harmonie supposée, et les entrevues encore rares ne fournissent pas matière à contestation. Aucun désaveu, aucune opposition ne détruisent les illusions. Je vivais dans l'euphorie. Que m'importait que Léon eût l'air indécis et maussade! Nous examinâmes l'étrange capitale de Bohême sans beaucoup d'empressement. Prague nous sembla ensevelie sous les débris et la poussière de ses souvenirs. Dresde nous séduisit. En six jours seulement, nous passâmes de Leipzig, où nous suivîmes la trace du Faust de Gœthe dans la cave d'Auerbach, à Wittenberg où Luther avait affiché ses 95 propositions, à Potsdam et à Berlin, qui me parut belle, puissante et moderne. J'y admirai la nouvelle porte de Brandebourg, reconstruite sur le modèle des Propylées d'Athènes. Un projet avait été mis en chantier, de faire partir de la porte, seul vestige des anciens remparts, une avenue bordée de tilleuls en direction de l'université, du dôme et de l'ancien Schloss. Léon ne boudait plus, nous avions déjà quelques soirées de plaisir et de libations dans les jambes. La veille, je l'avais entendu repartir dans la nuit, et comme j'avais annoncé que je désirais lire, je ne m'étais pas montré. À l'ambassade de Belgique, Léon fut accueilli comme le fils d'un roi : ces messieurs Serruys, Cornelissen et Mercx avaient rarement l'occasion de recevoir des compatriotes et souffraient de nostalgie. Au musée sur l'île de la Sprée, le guide enthousiaste avait provoqué ma stupéfaction face à mon ignorance. Je jouissais d'une réputation d'homme instruit… On est toujours un peu plus éclairé que celui qui ne se meut pas exactement sur votre terrain. Le voyage en Allemagne m'ouvrit les yeux. À part le monde ancien, les lettres et l'histoire qu'on enseignait dans nos écoles, à part le remue-ménage incessant de l'actualité à Paris et à Bruxelles, d'autres peuples avaient d'autres passés, d'autres dévotions, d'autres dévouements. Ils m'étaient totalement étrangers. Comment ne m'étais-je pas rendu compte que je ne savais rien de ce qui occupait d'innombrables contemporains…? Ce Humboldt avait un frère géologue, mondialement connu, m'apprit l'ambassadeur. Je pressentis un curieux vide, mais ne parvins pas à l'expliquer à mon compagnon. Pour Léon, une visite en calèche et un arrêt au musée servaient tout au plus à se reposer des fastes de la veille. Que nous importait ce qu'on disait ici sur des choses qui ne nous concernaient pas?
Notre voyage se termina le 25 mars 1833. Je ne revis pas Léon aussitôt, nos adieux furent pourtant des plus cordiaux. De temps en temps, des amis communs me transmirent des nouvelles : la famille d'Hoogvorst était à Bruxelles. Timide et romantique, je rêvai d'Hortense au lieu de me déclarer.
Fabulateur impénitent, je la projetais à mes côtes. Je fis quelques voyages à Oxford, pour consulter des documents à la bibliothèque Bodléenne et visitai l'Angleterre tout entière, jusqu'en Ecosse et en Irlande. La jeune femme m'accompagna, objet de mon amour et partenaire de mes occupations. Mes contemporains ne remarquèrent pas que sous les apparences de l'homme sérieux que j'étais sensé être, un romantique invétéré prenait beaucoup de place. Ce sentimental vivait dans un monde imaginaire. Même au quotidien, dans ma tour, l'aimée avait conquis une place de choix.
Ma tour.
Il faut que je m'explique :
Mon frère Louis-Maur habitait la maison paternelle avec sa jeune épouse Baudouine. Un premier enfant était né. Dès mon retour d'Allemagne, je trouvai donc à Eename une situation familiale tout à fait différente du souvenir de ma jeunesse. Louis-Maur, comme notre père receveur des droits provinciaux et toujours mandataire à Bruxelles, se faisait conduire en ville au moins deux fois par semaine. Quant au reste du temps, il s'enfermait dans le bureau, comme s'il voulait encore plus parfaitement ressembler au père qui l'avait précédé. Le majordome manquait au tableau. Jean-Baptiste-François-Ursulain n'était plus.
Notre frère Urbain, qui m'était plus proche que mes autres frères, à cause de sa présence à Gand la première année du Catholique des Pays-Bas, s'était retiré du monde pour vivre loin des disputes publiques. Il ne viendrait plus à Eename.
Jean-Baptiste par contre, troisième fils Beaucarne et notaire de la place, était installé en face de la grande maison. Je ne l'avais jamais rencontré, il n'était pas à Eename lorsque j'habitais la maison de mon père. En entrant au collège d'Alost, j'avais hérité de ses livres et de ses cahiers, de sorte qu'il m'était familier par l'écriture de son nom et par ses annotations au crayon. À mon retour, j'avais vingt-six ans et lui avait atteint la trentaine. Je fis sa connaissance presque sans paroles, sans effusion de sentiments fraternels : il me traita avec l'amabilité de ceux qui se sont habitués à considérer tout — objets, humains, animaux, habitudes ou événements — avec la même bienveillance. Il ne vous dévisageait pas, n'avait pas l'air d'observer vos manières, d'examiner votre vêtement ou votre allure, d'étudier vos paroles, d'épier vos faiblesses, non, tout était suave à cet homme, bien que le qualificatif “suave” implique trop de participation à l'amabilité concédée, il s'agissait plutôt d'une absence d'activité affligeante. Quittant sa fonction de notaire, Jean-Baptiste passait au moins deux fois par jour chez Baudouine pour retrouver son jardin et l'orangerie, qu'il affectionnait tout particulièrement. Il y cultivait des orchidées et chauffait lui-même l'atmosphère en manipulant de grosses bassines d'eau bouillante dont la vapeur, en embuant le verre des vitres, dessinait de mystérieux motifs sur des fonds de lumière toujours changeants, comme si l'air de la serre et le ciel dehors accompagnaient l'inlassable travailleur en projetant à leur façon l'ombre de l'homme et de ses ustensiles, garnie des silhouettes de ses fleurs. Comme il n'adressait la parole à personne si ce n'était, par politesse, un murmure incompréhensible, affectueux et inattentif, il me rappelait Urbain au Catholique, ce frère également absent de mon enfance qui avait fait souche à Gand dans le sillage des abbés. Je le rencontrais peu puisqu'il travaillait à l'imprimerie, mais lorsque le hasard croisait nos chemins, il se dirigeait dans ma direction l'air étonnamment absent. Urbain était, disait-on alors, excellent mécanicien, il s'entendait à merveille avec les ouvriers. Comme les ouvriers et lui ne parlaient pas le même langage, tout ce monde appliqué s'entendait sans paroles. Jamais je n'avais vu ni entendu Urbain parler des lèvres pour exprimer un avis, quelques onomatopées, quelques gestes d'approbation ou d'ajustement suffisaient amplement. De son côté Jean-Baptiste, qui par son métier devait user de la voix pour lire ses actes dans son cabinet de travail, ou pour vérifier des mesurages et des fossés sur le terrain, le reste du temps se reposait de ce douloureux effort en supposant que tout serait dit et compris sans son entremise. Il avait choisi la vie des fleurs.
Depuis mon retour, les deux Beaucarne, c'étaient Louis-Maur et moi, le premier des fils et le quatrième, le vieux et le jeune. J'étais “le jeune Monsieur”.
Comme mon père, Louis-Maur avait épousé une femme à peine sortie de l'adolescence. Baudouine était de six ans ma cadette.
Seule présence lumineuse dans une maison d'hommes, elle régnait en maîtresse absolue du logis. Dans son esprit, Baudouine devait veiller au bien-être des deux frères célibataires de son mari toujours absent. Elle m'aimait comme un frère. Lorsque dix ans plus tard le bourgmestre que j'étais devenu dut recevoir des étrangers de passage, elle entoura mes invités de prévenances dignes de la meilleure intendance. La vigilance et le zèle qu'elle apporta aux affaires de la commune, des domestiques, des marchands et des fermiers, suscitaient mon admiration. Louis-Maur lui avait confié l'entière responsabilité du quotidien. Il s'occupait du pays, du gouvernement, des lois et de l'administration fiscale de la province, cela suffisait à son bonheur. On l'entendait discuter dans le fumoir, derrière la porte vitrée close.
Au début de mon rêve, persuadé d'avoir trouvé en Hortense la femme que j'introduirais dans ma vie, Baudouine incarna l'absente. Ma belle-sœur joua le rôle de ma future épouse. Un mouvement de Baudouine, une odeur, un objet manipulé ou regardé, une pensée que je reconnaissais parce que nous l'avions exprimée à Munich, à peine ces trésors traversaient-ils ma conscience, que la magie opérait. La maison Beaucarne acquit sous Baudouine le caractère qu'elle a encore de nos jours. Qui tirait la cloche de la rue entendait les pas venant de la cuisine. Ils avançaient tout au long du couloir et s'arrêtaient derrière la porte, qui lentement glissait à l'intérieur. Le visage qui vous reconnaissait était toujours souriant, la cuisinière expliquait où se tenait Baudouine et ce qui l'occupait, commentaire totalement superflu car la maîtresse apparaissait déjà. La table dans la salle de gauche était couverte, les portes du salon de musique ouvertes, celles du fumoir, réservé aux discussions sérieuses, fermées. Suivant sa trace, nous étions entourés de bonnes, de cuisinières, de curieux. Toute l'année, des enfants et des vieux traversaient la cour ou s'y asseyaient, pour prendre le pâle soleil d'hiver ou au contraire, fuir celui de la canicule. Dans le jardin, immanquablement, un jardinier se redressait sous son chapeau de paille, pour faire des commentaires sur la terre, le temps, les semailles et les fleurs. Les outils sentaient bon dans la remise, les fruits dans les celliers, et selon la saison et l'heure du jour, l'air sucré des confitures, la lessive chaude dans son étuve, ou encore, si nous étions matinaux, nous nous faisions accueillir par l'odeur du pain qui envahissait la maison par la véranda ouverte et le corridor. Lui seul, pain quotidien, par sa qualité essentielle pour tous, avait le droit de traverser les murs jusqu'au vestibule.
Au fond du jardin de la maison familiale, personne n'avait tracé de limite bien définie entre la propriété et les champs. Une promenade gravissait une légère pente et passait par une vieille tour fortifiée, en ruine, que la nature avait recouverte de terre et de verdure. Dans la tour, des amoureux avaient improvisé un belvédère et quelques poètes s'étaient aménagé un coin solitaire, fort délabré en 1833. Comme les murs étaient épais, qu'on pouvait y faire du feu et qu'il y avait de l'eau à proximité, j'avais décidé d'y bâtir un nid provisoire et d'y entreposer mes caisses de livres et mon matériel. Baudouine s'occupa de l'aménagement de ma modeste demeure. J'y installai ma bibliothèque et un bureau.
À Düsseldorf, le baron Clock possédait les coffres en chêne emportés par le moine Ferdinand Ernest Joseph von Stein, lorsqu'en 1795 il avait quitté Eename pour se réfugier à Cologne. Le moine y était décédé un peu avant Waterloo. Je courus à Düsseldorf. Un cartulaire de l'abbaye avait été retrouvé à la bibliothèque de Berlin et envoyé par le gouvernement de la Prusse au gouvernement belge. J'allai le copier. Ainsi, après mes années d'agitation à Gand, l'occasion me fut donnée de m'occuper du passé. J'avais la conviction irrationnelle, que la pensée de nos ancêtres devait à tout prix être sauvegardée. Nous devions rester à l'écoute de leur message. Depuis, la notion ne m'a plus quitté. L'appel des ancêtres ressenti par l'historien doit être la dernière empreinte d'une intuition originelle perdue, celle qu'on retrouve dans certaines croyances primitives, où non pas Dieu décide de la vie, mais les ancêtres. Eux connaissent ses mystères et passent aux plus réceptifs des vivants le moyen de les sonder. Ils acquièrent ainsi le pouvoir de patronner les événements sur terre et aident les mortels à lutter contre les forces maléfiques. Toutes proportions gardées en ce XIXe siècle civilisé qui ne trouvera pas plus que les précédents et ceux qui suivront les formules magiques qui rendront les nations plus prudentes et plus sages, le témoignage de ce que fut la pensée et le mode de vie des détenteurs d'une tradition presque oubliée me semblait un patrimoine digne d'étude. Pour le rapatriement des documents perdus sous l'occupation française, les mois qui suivirent mon retour d'Allemagne furent des plus fructueux. Ils me permirent d'organiser l'étude de sept siècles de vie monastique. Je découvris les origines du Brabant en Lotharingie, ainsi que les droits et coutumes de notre commune plus que millénaire.
Et Hortense dans tout cela?
Des mois s'étaient écoulés, je ne l'avais pas oubliée.
Un jour, j'appris qu'elle s'était mariée. Je fus atterré. Mon avenir s'écroulait.
Je ne pus croire la nouvelle, et lorsqu'elle pénétra ma conscience en toute évidence, je constatai avec horreur la distance que j'avais laissé grandir entre Hortense et moi. Je compris l'épouvantable abandon dans lequel j'avais laissé la jeune femme. Si Hortense avait espéré me revoir, je l'avais cruellement fait souffrir. Il ne suffisait pas de croire en la volonté divine, j'avais rêvé, je n'avais rien entrepris pour resserrer un lien qui n'avait rien eu de solide. De dépit et de honte, je tombai malade.
Je m'accusai de vanité. Comment avais-je pu supposer que la famille Hoogvorst ferait les premiers pas!
Depuis, je sais que mon caractère est ainsi fait que je ne convoite pas ce qui ne m'est pas donné. D'autres ambitionnent des fonctions, des biens. Pour ma part, je n'ai jamais sollicité la moindre charge qui ne me soit présentée. Je préfère ma position de retrait. Je ne désire pas m'approprier ce dont d'autres peuvent jouir. Le respect du prochain et de la liberté individuelle que j'ai hérité de mon père est fondamental et inconditionnel. Je refuse d'influencer les gens et les circonstances à des fins personnelles. Je n'ai agi que lorsqu'on m'y a poussé, ou alors, pour le bien d'autrui. Même mes démarches historiques répondent à cet appel de ma conscience, il fallait que j'aille à la recherche des témoignages perdus. Quant à mes carnets, qui comme tous les carnets intimes peuvent sembler inutiles, eux aussi, ont eu leur utilité immédiate : pour agir à bon escient, je devais retenir, résumer, analyser, fixer certaines balises. Ils étaient mes documents de travail, mes brouillons. Dans le cas d'Hortense, face au bonheur que j'avais entrevu, je n'ai pas osé réclamer de la Providence ce qui peut-être ne m'était pas dû. Le sentiment était si fondamental que si Hortense avait essayé de me revoir, j'aurais été sûr de son désir de poursuivre notre relation. Sans ce souhait, je n'aurais jamais su si je ne lui avais pas forcé la main. Je la voulais maître de son destin. Scrupules superflus, issus d'une éthique fort éloignée de la réalité! J'avais perdu la femme qui aurait été ma compagne idéale. Je m'abandonnai au désespoir, et le désespoir dérégla ma constitution.
Il est certain que les circonstances de notre rencontre avaient été préparées, Hortense n'étant plus toute jeune. Comme je ne cherchai pas à la revoir au cours de ce même voyage, alors que tout avait été prévu pour que la chose fût possible, et qu'ensuite, je n'entrepris aucune démarche pour la revoir et me présenter à ses parents, sa famille me crut indifférent. Si j'avais eu une mère attentive, ou au moins des sœurs, qui eussent deviné mon état, qui m'auraient questionné, puis immédiatement conseillé! Non, j'étais seul entre trois frères aussi ineptes que moi à comprendre les femmes. Nous n'avions pas appris à vivre en famille. Chacun de nous menait sa propre vie, à l'ombre d'un père statufié.
Toute ma vie, j'ai maudit ma bêtise et mon aveuglement. L'innocent qui joua le rôle si ridicule du rêveur n'avait que l'apparence de l'adulte. On m'avait enseigné le latin et l'histoire, j'avais hérité la prudence en affaires et fréquenté beaucoup de monde, dirigé des hommes, mais je ne savais rien des choses de la vie.
La maladie fut longue.
Au collège et sporadiquement comme adulte, lors de mon arrestation en 1830 ainsi qu'après mon départ précipité du Journal des Flandres, j'avais été atteint d'une curieuse névrite, que je mettais sur le compte de la souffrance morale, d'un excès de déboires et d'échecs. Violent au point de me faire sursauter de mal au moindre contact de ma peau avec un corps étranger, intolérable au moment même, l'ennui passait promptement, sans médecine. Le désespoir que me causa le mariage d'Hortense fut plus difficile à surmonter. La douleur s'était réfugiée dans mon organisme, comme si mon orgueil, contraint d'admettre qu'il souffrait atrocement, préféra me détraquer la santé plutôt que d'avouer ma défaite et mon incapacité à en dominer les conséquences. Le subterfuge se passa de mon entremise. Qui décida ici que le traumatisme corporel fût préférable à l'affection de l'âme que je ne parvenais pas à étouffer?
La détresse absolue, à force de sévir, réduisit progressivement la virulence de ses attaques, ce qui permit à ma raison de se remettre à fonctionner. L'idée me vint que Léon et Victor avaient organisé mon voyage pour me présenter Hortense, que tous l'avaient su sauf moi. Et bien que la découverte occasionnât de nouvelles tortures, d'humiliation cette fois, pour supporter la honte, elle me força à reprendre le travail. J'ai de cette époque le souvenir confus d'une grande obscurité, mais aussi, d'une première pensée positive. Je me surpris à songer qu'Hortense ne pouvait ni se tromper ni agir à la légère. Elle avait accepté le mari qu'on lui avait proposé — après moi. Elle l'aimerait, elle était trop bonne pour ne pas s'y forcer et trop intelligente pour gâcher les promesses de sa situation. Comme je l'aimais toujours, mes rêves reprirent, très différents, moins fréquents et plus distants. Je la projetai belle, aimée, aimante. Une deuxième Baudouine.
Ce ne fut qu'un début. Le rêve évolua.
À certains moments privilégiés de détente, en voyage ou à deux pas de ma tour, je me complaisais à imaginer en détail l'intimité du couple. Je dédiais à Hortense toute la tendresse qu'un amant peut vouer au bonheur de la femme adorée. La nuit, en cherchant le sommeil, ma fantaisie se révélait moins prudente. Ici aussi, ma raison se défendait contre ma passion dans une lutte inégale. Me rappelant vaguement qu'en réalité un autre que moi officiait dans les scènes de mon imagination, je me secouais de ma torpeur. Mais mon esprit critique, dès qu'il avait enregistré que mon rêve n'était qu'un rêve, me cédait de plus belle à mes songes, sans désespoir et la conscience en paix.
J'étais sorti de l'abîme. Mon amie désormais inaccessible avait repris sa place dans mon discours intérieur, comme si nous n'avions pas été séparés. Je priais pour qu'elle fût heureuse. Elle était ma sœur, ma confidente, en même temps que l'objet de mon ardent amour. Le désir est volontiers incestueux. Mes peines devinrent douces, alliées à ma tendre affection. J'oubliai le soupirant désespéré que j'avais été et reléguai ma détresse à l'état de souvenir, comme un rôle que j'aurais joué jadis, dans une pièce. Le malheureux n'était pas moi, c'était un autre.
Il ne fallut pas beaucoup de temps pour en arriver au stade suivant. Je me glissai dans le rôle du mari. Il suffisait de choisir un village près de Munich, son château, les allées vertes, l'esplanade, une salle à manger pour ponctuer les heures du jour et échanger les propos indispensables. Les soirées préludaient aux délices secrets de la tendresse et de l'épanchement, que je connaissais mal. Mon rêve s'arrêtait, bloqué devant la porte de la chambre à coucher, je n'arrivais même pas au pied du lit. Il me fallut donc un autre rôle, celui de l'ami en visite pendant les absences du mari. Il m'était soufflé par la situation dans la famille Beaucarne. Baudouine et moi partagions plus d'heures et plus de préoccupations que ne le fit Louis-Maur avec son épouse. Dans mon rêve d'Hortense, j'étais alors le témoin invisible de l'épouse esseulée, à ses côtés comme son ange gardien. Je l'observais, charmé par les tracas féminins qui l'occupaient. À la longue, je comprenais fort bien la cuisine, les achats, l'organisation du travail et la susceptibilité des domestiques. Mon frère ignorait tout de ces choses, et j'appris combien est généreux le partage des soucis et combien ces derniers comblent la pensée et les talents des femmes. Que serions-nous sans elles?
La providence croisa mon chemin. Je revis Hortense au château de Berlegem. M'apercevant, elle quitta son mari, le baron de Nantheim, un homme d'excellente mine, pour venir me prendre par le bras et me conduire à la place qu'elle venait d'abandonner. Elle me présenta et s'enquit de mes activités comme si entre Munich et Berlegem aucun événement n'avait troublé notre entente. Je lui avouai que son bonheur me remplissait d'aise et que j'essayais de m'imaginer son rôle de maîtresse de maison.
—Et bientôt de mère, me confia-t-elle, dans les yeux, un instant, le feu qui m'avait lié à sa vie.
Il ne fallut pas plus pour entraîner une nouvelle série de rêves. En esprit, j'assistai à la naissance de son premier enfant, je vis l'enfant lui-même, observai les caresses et les jeux qui amusèrent la mère et l'enfant. Au fil des jours et des semaines, je fis d'Hortense une femme d'intérieur, prête au sacrifice de ses plaisirs pour servir autrui. Ma belle histoire m'accompagnait partout. Je ne m'évadais pas vraiment des occupations auxquelles le devoir m'astreignait, au contraire, je m'y appliquais avec une vivacité redoublée, une présence d'esprit absolue, comme si je partageais ma tâche avec elle, en compagnon. Le travail ne perturbait pas mon soliloque. J'exposais mes problèmes à une oreille attentive. L'imagination faisait des bonds de mille lieues, je sentais mon amie toute proche, j'entendais sa voix. J'avais si souvent essayé de prévoir ses réflexions qu'elles faisaient irruption d'elles-mêmes, comme si chaque chose était comprise non seulement par moi, mais par mon double féminin.
Après ce jour à Berlegem, nous nous étions revus. Lorsqu'Hortense était en Belgique, le baron de Nantheim la faisait conduire jusqu'à Eename. Le prétexte donné était que la baronne, toujours très occupée, profitait de l'occasion pour reprendre une habitude de jeunesse, celle de parcourir la campagne en sauvageonne. Ma demeure surplombait des hectares et des hectares de terre de labour dont je connaissais chaque ruisseau, chaque fossé, les barrières infranchissables et les gués. Pas un marécage, rien que de l'excellente terre. Quelques bosquets que nous n'avions pas défrichés offraient leur richesse aux paysans ingénieux. Les femmes, initiées aux secrets des plantes, y trouvaient ce qu'elles cherchaient, les gamins taillaient les joncs et les branches pour s'en fabriquer des armes, des outils et des jeux. Lorsqu'il pleuvait ou que la tempête assombrissait trop les champs et la plaine, la baronne venait pour des après-midis de lecture dans sa langue maternelle.
— Si au moins elle venait aux nouvelles, riait le baron en me serrant cérémonieusement la main, le pied sur le marchepied de sa voiture.
— Je ferai de mon mieux, lui promettais-je, fanfaronnant comme de mise puisque je savais qu'il appréciait le ton railleur plus que la plaisanterie.
— Il se passe pas mal de choses…, ajoutait-il pour bien spécifier ce qui l'intéressait, les ragots de Bruxelles qu'il pourrait rapporter à son retour.
Hortense et moi ne parlerions pas du gouvernement, mais je comptais sur l'ingéniosité de mon amie pour assaisonner quelques miettes dans le récit qu'elle lui ferait de son après-midi. En réalité, nous nous promenions d'abord en silence. Je lui jetais des regards amoureux. Notre amitié était devenue si formelle que je n'étais plus obligé de cacher ma tendresse. Lorsque je la rencontrais, je m'adonnais au plaisir du regard défendu. Pendant ma convalescence, Baudouine m'avait passé pas mal de romans, et quelques épouses d'amis, apprenant que j'appréciais les belles lettres, me firent parvenir leurs livres préférés, m'adressant au surplus un volumineux courrier de commentaires. Romans et commentaires m'apprirent qu'avec Hortense, si je ne parcourais pas toutes les étapes de l'amour, au moins, j'en savourais la première, à l'écoute de sa voix, interprète secrète des plus intimes émotions. Ainsi, je lui offrais mon bras pour la conduire dans le jardin, d'un geste apparemment mondain pour le spectateur qui n'entend rien aux résonances du cœur. Notre marche contenait le souvenir des paroles et des choses qui nous avaient rapprochés, mais aussi, l'écho de mes émois de solitaire et peut-être les siens, inavoués? Une légère tristesse timbrait les vibrations de certaines phrases. J'en souffrais, mais son chagrin nous rendait solidaires. J'avais l'illusion qu'elle le sentait. Nos pas rythmaient nos confidences et lorsque nous nous arrêtions pour nous asseoir sur un banc, sous l'ombre accueillante d'un arbre bien fourni, nos présences si proches l'une de l'autre abreuvaient nos sens, merveilleux complices de l'esprit et de l'âme. Existe-t-il, pensais-je, enlacement plus parfait de deux natures?
L'euphorie des sens se maintenait pendant que nous traversions l'herbe haute, bordée par des rubans de fleurs qui trahissaient la présence de l'eau, immobile et noire au fond des vieux fossés. Les chemins se traçaient d'eux-mêmes, sous le pas de ceux qui croisaient les prés et les champs, toujours pour le même trajet de la maison Beaucarne jusqu'à ma tour. À part Hortense et moi-même, ce n'étaient que trois femmes fidèles, Baudouine, la femme qui faisait le ménage chez moi et la paysanne qui me fournissait en lait, en pain, en fruits et en légumes pour les potages et les pots-au-feu. Enfin, il y avait un raccourci où Hortense et moi devions enjamber des touffes plus encombrantes. Mon amie levait ses jupes, prenait de grands pas et posait le pied à terre après l'avoir retenu en l'air, le temps, pour elle, de choisir un endroit sûr et pour moi, de déséquilibrer la stabilité de mes humeurs. Le sentier sauvage descendait vers le puits et la dalle oblique du lavoir. Nous nous y assoyions.
Lorsque la piste s'élargissait suffisamment pour que je pus inviter Hortense à passer devant moi, pendant quelques vingt mètres, avant d'ouvrir la grille de ma tour, nous marchions côte à côte, laissant voguer notre regard, à droite sur la campagne ondulante, à gauche vers l'horizon lointain. Dans mon souvenir, nous faisions les cent pas sur cette voie royale, discourant dans le vide que créait le vaste panorama, nous effleurant mutuellement du regard sans devoir se l'avouer, puisque nous étions devenus des objets de transparence dans la perspective infinie. Nos pensées s'accommodaient au décor. Nous ne disions rien de neuf, Hortense me racontait sa vie et celle des enfants, je la comparais à celle de Baudouine. Des visiteurs étaient passés à Nantheim. Elle me les décrivait à la façon du narrateur qui introduit quelques personnages secondaires. Nous poursuivions nos lectures, dont nous échangions les thèmes. Je lui exposais mes travaux, lui rendais compte de mes faits et gestes. Nos messages ressemblaient fort au contenu d'une relation épistolaire, mais ils présentaient l'avantage d'être entrecoupés de remarques tout à fait spontanées sur la promenade elle-même et sur notre présence réelle. Hortense exprimait ses sensations pour rendre hommage à ce qui la charmait, les fleurs, le vent ou l'absence de vent, le froid qui ravigote, la tiédeur de l'été, la force musculaire ravivée par l'exercice, le cœur qui bat, l'effort… Tout y passait, en observations brèves qui n'attendaient aucune réponse de ma part.
La réponse vint. Un jour, Hortense m'avait semblé mélancolique. Et son lourdaud de mari-baron plus disgracieux, plus bruyant que d'habitude. Il m'était défendu de remarquer la peine de mon amie. Je ne pouvais pas essayer de la consoler. La moindre parole d'encouragement aurait suggéré que j'avais deviné son malheur. Je ne pus même pas exprimer une pensée qui aurait soulagé l'inconfort de sa situation, à savoir qu'il n'était pas certain que l'union à laquelle un jour nous avions aspiré et que nous nous représentions encore comme l'exemple de la perfection absolue, ne soit pas devenue elle aussi la décalque piteuse de notre idéal. Qu'advenait-il en réalité des plus belles espérances? Qui de nous se croyait capable de compenser les déceptions inévitables du quotidien? Les personnes vraiment fortes étaient celles qui ne s'étaient fait aucune illusion et qui, au jour le jour, se félicitaient de tout ce qu'elles entreprenaient, de l'effort fourni et des circonstances dans lesquelles elles vivaient. Baudouine me semblait un exemple vivant de cette solidité de caractère. Hortense était plus littéraire, donc moins réaliste. Elle avait acquis la fragilité de la matière travaillée, du raffinement.
Voulant prouver que je la comprenais, que je désirais la consoler, que nous étions des âmes sœurs vouées à la solitude, je pris Hortense dans mes bras et la pressai contre moi. D'abord légèrement, puis de plus en plus tendrement, la tendresse étant — à ce moment de langage sans paroles — le seul moyen de m'exprimer et de l'atteindre. Le contact de nos cœurs passait par son corps contre le mien, et nos chairs s'ouvraient, doucement, dans un délice sans égal, pour se fondre l'une dans l'autre, dans un amalgame qui dépassait les sensations personnelles et unissait nos âmes. Pour la première fois de ma vie, je sentis que j'avais une âme. Mais elle ne m'appartenait pas, nous la partagions, Hortense et moi. Et même si tout à l'heure, nous nous séparerions, la sienne resterait nichée dans la mienne, la mienne peut-être dans la sienne.
J'avais tendu les bras vers elle pour pouvoir la soulager, mais j'avais pris dans les mains une femme qui connaissait le désir de l'homme. Qui sentait et comprenait le mien. Qui n'était plus la jeune fille de 1833. Qui n'avait d'autre vocabulaire que celui de la femme mûre, qui d'innombrables fois avait dû interpréter son affection par la souveraineté du corps. Je la sentis vibrer, d'une vibration lente et violente, comme si ses membres sanglotaient. Sanglotaient d'émotion, juste avant un épanchement total. D'innombrables fois, je l'avais déshabillée et explorée en pensée. Mal explorée. Pour la retenir, la soutenir, la coucher, je la portai sur les dalles sèches du lavoir, et fébrilement, au lieu de la réconforter et d'assoupir son tourment, je parcourus ses formes, perdant tout jugement et m'enfonçant, nous enfonçant, dans une bacchanale de gestes, rituel d'une exploration subitement devenue absolument inévitable. Ce furent des retrouvailles. Nous nous agrippions l'un à l'autre comme s'accroche à son radeau un rescapé. Mais en même temps, j'étais caressé par toute sa tendresse accumulée et refoulée. Les gestes que j'inaugurais pour que nous ne soyions plus qu'un, dorénavant et à jamais, me vinrent de la nuit des temps, paradisiaques et justes. Ils nous emportèrent dans de larges vagues, si pleines et si amples que la dernière s'étala, immobile, dans le sommeil éveillé, en plein jour, comme sous une clair de lune cosmique. La méditation transcendante surgissant des corps! Nous étions terre et vie, pouls et conscience.
Je détachai Hortense de notre étreinte, de peur qu'elle fût la première à se retrouver dans l'ornière de notre existence insignifiante. Je redoutai sa conscience et sa probité. En dénouant notre lien, nous ne nous séparâmes pas, car je refis en sens inverse tout ce qui nous avait rapprochés. Après l'avoir relevée, je la tins immobile devant moi, aussi loin de moi que mes bras me le permirent, gardant dans les mains la souplesse de ma première effusion. La distance entre nous était à peu près celle qui sépare d'un tableau de maître l'amateur d'art perdu dans sa contemplation. J'ai dû sourire du sourire qu'imprime sur nos traits la radiation de l'admiration. Dans le langage physique, cette expression est un signe d'amour. Je fis du doigt le contour de sa bouche, comme pour sceller, en le sacrant, le trésor auquel je renonçais. Je revis de près, dans un long regard dont je n'ai toujours pas saisi le sens définitif, les iris bleus mouchetés de plumetis marrons.
Le moment ne se répéterait pas. Nous ne nous verrions plus. Nous n'exprimâmes pas ce que nous savions tous les deux. Ce fut un adieu sans l'être. J'en souffris lorsqu'elle eut disparu à l'horizon, escortée par moi en ami fidèle, du pas de ma porte à sa voiture, qui l'attendait.
Celui qui s'en retourna chez lui, après le dernier salut, faible geste du bras contre le ciel infini, présage des distances insurmontables, était, une fois de plus, un homme fini.
Peut-être n'existait-il personne qui ait aimé autant que moi.
L'horizon était jaune. Les nuages bas laissaient à ras du sol une étroite traînée de cuivre, sur laquelle se découpait la silhouette noire de sa voiture. Hortense devait disparaître de mon univers. Désormais, je garderais d'elle une seule image, qui rendait les autres définitivement chimériques. J'avais trente-deux ans. Nous étions en 1839. [à suivre]
Copyright © Nicole Verschoore, 2002
|